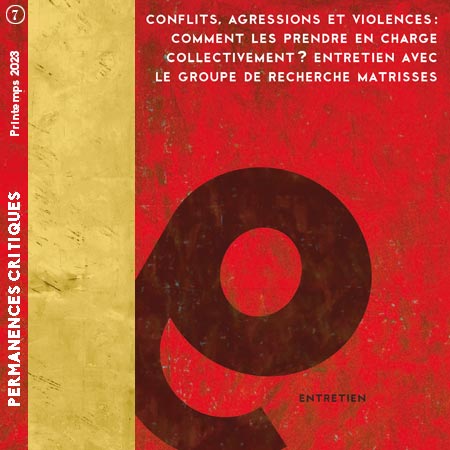En guise d’introduction, pour les lectrices et les lecteurs qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous présenter matrisses ? Qu’est-ce qui vous a amené à vous constituer en collectif ?
On se définit aujourd’hui comme un groupe de recherche sur la prise en main collective des situations de conflits, agressions et violences. Nous sommes une douzaine de bruxelloises et nous proposons, dans le cadre de nos recherches, des accompagnements destinés à l’entourage de personnes victimes ou auteurices d’agression. Pour l’instant, ces accompagnements consistent en une simple mise à disposition d’informations et de moments d’écoute.
Au départ on s’est rassemblées avec l’envie d’outiller nos collectifs, nos lieux et nos luttes face aux situations d’agression. On voulait se donner plus d’options que celles de soit fermer les yeux, soit d’exclure l’auteur, et réaffirmer que ces situations d’agression ne sont pas des problèmes individuels mais concernent aussi l’entourage des protagonistes, et plus largement les rapports de domination systémiques. On s’est d’emblée tournées vers les principes de la justice transformatrice pour appréhender ces questions, parce qu’ils tiennent justement compte de la nécessité de changer les dynamiques dans la communauté et la société.
Après de premières discussions en cercle restreint, nous avons lancé un appel plus large début 2021 en contactant des groupes alors identifiés comme « collectifs militants bruxellois ». Nous avons proposé une note d’intention, et la première assemblée a concentré une bonne cinquantaine de personnes intéressées par la démarche, en « mixité choisie sans mecs cis ». Au fil des mois, on s’est collectivement heurtées à beaucoup de questions : à quels groupes militants bruxellois avons-nous fait appel en premier lieu et qu’est-ce que cela dit de notre position dans le monde militant belge francophone ? Qu’est-ce qui fait communauté entre ces groupes ? Nous concentrons-nous sur les situations d’agressions sexistes, ou estimons-nous pouvoir penser des outils valables dans des situations impliquant d’autres types de violences structurelles ? L’objectif de départ était de concevoir ensemble un guide de base pour aider les groupes à intervenir face à une situation d’agression, où figureraient des questions à se poser, des stratégies possibles et des précautions quant aux biais connus.
Finalement, après quelques assemblées, nous nous sommes retrouvées à une douzaine de personnes pour entamer un travail de recherche sur ces questions et sur les outils de justice transformatrice, sans adopter de note d’intention ni inclure formellement des collectifs tiers. Nous avons commencé par remonter aux origines du concept de justice transformatrice ; discuter des termes utilisés (agression, conflit, violence, victime, communauté…) ; enquêter sur les mises en pratique existantes à Bruxelles ; explorer les ressources disponibles en ligne ; rencontrer des collectifs ou associations qui cherchent ou pratiquent des voies de responsabilisation qui sortent des logiques punitives.
Pouvez-vous nous expliquer le but de votre action ? Quel est votre rapport à la justice pénale ?
Ce sont des questions qui reviennent souvent dans nos discussions, et elles ne se recoupent pas forcément.
Il est clair pour nous que la justice pénale protège le statu quo de la domination raciale, capitaliste et patriarcale. Mais nous ne produisons pas pour le moment d’analyses ou de stratégies contre le système pénal qui nous permettraient de nous positionner en actes. Si certaines d’entre nous sont en lutte contre ces institutions, individuellement ou à travers d’autres initiatives collectives que matrisses, nous ne le sommes pas en tant que groupe. Se réclamer de l’abolitionnisme pénal engage politiquement. Or à quelles luttes nous rendons-nous disponibles collectivement ?
Notre but principal est de contribuer à la responsabilisation collective ou communautaire des situations d’abus ou d’agression. Nous désirons participer à la construction de pratiques de justice qui sortent des logiques punitives, et de pratiques de réappropriation du potentiel de transformation des conflits. Nous ne pensons pas que cela constitue en soi une stratégie ou un positionnement contre le système pénal. Et s’attribuer une étiquette politique n’y change pas grand-chose non plus, a priori. S’attaquer aux logiques pénales se fait de plusieurs manières, depuis des fronts multiples, parfois complémentaires, parfois contradictoires, où les questions des priorités de lutte sont très impliquantes politiquement, stratégiquement et en termes d’alliances.
Concernant les étiquettes politiques de « féminisme anti-carcéral », « abolitionnisme », etc. la question que nous nous posons pour le moment (printemps 2023) est : à quoi cela nous engage collectivement ? Et comment ?
Nous avons souvent le sentiment d’être associées au féminisme anti-carcéral. Ceci est dû aux engagements féministes individuels de la plupart d’entre nous, mais aussi à la popularisation de la justice transformatrice par des autrices comme Gwenola Ricordeau, et à la primauté des situations d’agression sexistes et sexuelles dans notre viseur. Or, pour matrisses, ce féminisme n’est pas l’unique grille de lecture possible. De plus, il est parfois critiqué au sein même du mouvement anti-carcéral pour avoir déplacé démesurément le focus sur certaines victimes du système pénal (femmes, personnes racisées, minorités de genre), alors que les cibles principales du système pénal sont les jeunes hommes pauvres issus de l’immigration post-coloniale, comme l’a fait remarquer le philosophe Norman Ajari[1] par exemple. Tout cela est encore l’objet de débats entre nous. Quelque part, nous sommes encore en train de nous rencontrer…
Donc, notre priorité est d’abord de mettre en place la transmission, entre nous et au-delà de nous, de pratiques de prise en main collective des situations d’agression de la manière qui nous semble la plus juste possible, et de partager ces outils et nos questionnements à travers différentes pratiques : des interventions auprès de groupes confrontés à une ou plusieurs situations d’agressions, des présentations publiques, des supports papier, un site internet… C’est notre raison d’être première, et ça représente déjà beaucoup de temps et d’énergie. Tant que ce travail n’aura pas atteint un certain seuil, nous ne serons pas en capacité de nous mobiliser collectivement de manière conséquente et cohérente contre le système pénal, en portant des revendications, en produisant des analyses stratégiques, en organisant ou rejoignant des actions, en contribuant à divers fronts de lutte, en signant des tribunes ou des cartes blanches ; bien que ce ne soit pas le désir qui manque.
Comment envisagez-vous la justice transformatrice et sa mise en application à plus grande échelle ? Comment celle-ci se distingue-t-elle, selon vous, de la justice restaurative ?
En fait, la justice transformatrice est déjà en application à grande échelle, en ce que ce concept recouvre des processus foisonnants aux origines très diverses que beaucoup de groupes et de personnes pratiquent au quotidien sans se poser la question d’un nom ou d’un label qui viendrait catégoriser leur pratique. Parmi les exemples publicisés dont nous avons pu nous saisir, on trouve Generation Five[2], une asbl basée à San Francisco qui recoure depuis 1999 à ce type de dispositifs dans le but de mettre fin aux abus sexuels sur les enfants. On trouve aussi les « cercles de paix » réinstaurés dans la réserve d’Hollow Water au Canada pour adresser un phénomène d’inceste généralisé au sein de la communauté[3]. Nous envisageons la justice transformatrice, dans sa conceptualisation, comme un support pour penser et construire des pratiques de justice et des cultures du conflit non clivantes, créatives et transformatrices, et non pas comme une fin en soi. Cet ensemble de pratiques s’articule autour de quatre principes :
- la prise en compte des besoins des victimes/personnes ayant subi un préjudice
- la responsabilisation de l’auteur ou de l’autrice du préjudice
- la transformation du collectif/de la communauté
- la transformation plus générale des rapports de domination dans la société
Nous utilisons ces principes comme une boussole, nous nous refusons aux méthodes clé en main, et nous intéressons à beaucoup d’autres pratiques, théories et clés de lecture, comme l’analyse institutionnelle, le processus de domination conjugale, etc.
A plus grande échelle, il s’agirait donc plutôt d’un essaimage, d’un partage, d’une circulation et d’une diversification des pratiques, avec des processus de justice qui restent ancrés très localement, situés culturellement, réappropriés collectivement et autonomes, vis-à-vis des institutions. C’est là que nous nous situons : au croisement de multiples outils, pour résoudre un problème qui nous appartient. C’est notamment là que la justice transformatrice se distingue de la justice restauratrice[4] qui, en s’institutionnalisant, est devenue un complément plutôt qu’un remplacement de l’incarcération ou d’autres peines infligées. En s’inscrivant dans le système pénal, elle a dû dépolitiser les situations qu’elle prenait en charge, dépolitiser leur contexte. La responsabilisation s’arrête à l’auteur de l’infraction, implique assez rarement l’entourage, et presque jamais les responsabilités politiques des violences structurelles, qui sont pourtant les plus massives et qui reproduisent la violence et son lot de souffrances.
Nous sommes dans de sérieux questionnements quant à l’articulation de notre démarche au principe de transformation sociale qui sous-tend la justice transformatrice, et à ce que ça implique en termes d’échelle de pratiques et d’impact. Aussi, nous ne pensons pas que la justice transformatrice soit adaptée à toutes les situations de conflit et d’agression, car elle exige beaucoup de ressources et de temps. En cas de déni total de la part de l’auteur – ce qui arrive fréquemment – ces pratiques peuvent être rendues compliquées. Par ailleurs, nous ne souhaitons pas faire de cette piste une nouvelle injonction aux personnes ayant subi des agressions.
Avez-vous pour objectif ou pour visée de vous exprimer publiquement sur des questions de justice ? Ou d’agir sur la place publique ? Souhaitez-vous devenir des interlocutrices des pouvoirs publics ?
D’une certaine manière, nous nous exprimons déjà publiquement sur des questions de justice. Nous avons déjà donné des ateliers et présentations publiques, notre contact circule et nous avons maintenant un site qui présente nos positionnements et nos actions. Dans le partage et la création de savoirs et pratiques, nous sommes publiques.
La question du plaidoyer politique, comme elle a été abordée plus haut, est plus complexe et, tant que nous n’avons pas réglé ces questions entre nous, nous ne nous positionnerons pas en tant que groupe sur l’actualité. Heureusement, nous ne sommes pas seules et de nombreuses actrices et acteurs, collectifs et associations se mobilisent sur de multiples fronts pour plus de justice sociale. Quant à notre relation aux pouvoirs publics, elle se définit encore au cas par cas et n’a jusqu’ici pas fait l’objet d’une discussion collective.
Faites-vous le choix de vous limiter à des situations ayant lieu uniquement dans un cadre militant ? Avez-vous pour but de vous cantonner aux questions de violences sexistes et sexuelles ? Ou alors voudriez-vous étendre les problématiques traitées à d’autres types de « conflits » ou « situations-problèmes » ?
Nous intervenons principalement par bouche à oreille pour le moment, et nous sommes au contact de groupes militants dans un sens très large : un collectif en lutte, les habitants d’un lieu de vie commune, les membres d’un collectif d’organisation de soirées indépendantes… Une des conditions essentielles est qu’il y ait l’envie d’agir collectivement. Nous ne sommes pas outillées en revanche pour répondre aux demandes de personnes isolées, que nous réorientons vers des organisations plus spécialisées.
Nous restons en effet concentrées sur les situations d’agressions sexistes et sexuelles, mais celles-ci mobilisent souvent d’autres enjeux et d’autres types de rapports de pouvoir, s’inscrivent dans des conflits plus larges, ou peuvent recouper plusieurs rapports de domination. Nous avons des angles morts (du fait que nous sommes situées culturellement et socialement) que nous mettons au travail et dont nous tâchons de minimiser l’impact à travers les choix de modes d’accompagnement que nous avons fait.
Nous avons fait le choix de garder une position de troisième ligne dans ces interventions. Schématiquement, la première ligne ce sont l’auteur et la victime (ou « personne cible »), et la deuxième ligne c’est l’entourage de ces personnes, constitué en groupe, que nous allons accompagner. Nous ne nous retrouvons donc jamais au sein d’une assemblée qui prend en charge un conflit ou une agression mais sommes présentes « en back-up » pour débriefer, conseiller, filer de la documentation… Ce choix de la troisième ligne vise à préserver l’autonomie de ces groupes mais aussi à nous protéger de l’épuisement militant et des difficultés émotionnelles que pourraient amener une plus grande implication.
Toujours dans l’idée de minimiser l’impact de nos angles morts, nous parlons de travailler la posture de non-savoir pour ne pas plaquer indifféremment nos cadres de référence sur n’importe quelle situation. Le non-savoir consiste en une posture d’humilité couplée à une technique de non directivité dans l’accompagnement. Ce concept est issu d’une série de praticiennes et de penseuses des années 60, en psychologie et pédagogie[5], qui remettent en cause les normes en place et leur légitimité à intervenir auprès des personnes à « soigner » ou à « éduquer ». Se développe alors l’idée d’apprentissage et de soin réciproque, d’aller-retour dans la construction des savoirs. Malgré ces postures de troisième ligne et de non-savoir, l’élargissement de notre champ d’intervention au-delà des situations de violences sexistes et sexuelles n’est pas encore à l’ordre du jour.
Comment vous distingueriez-vous d’autres groupes de justice transformatrice, comme le collectif Fracas ? Ou d’un site d’information ? Quel intérêt d’avoir un groupe comme cela en Belgique ? Est-ce qu’il en existe d’autres ?
Le collectif Fracas existe depuis plus longtemps, et revendique clairement un ancrage militant féministe et queer. C’est aussi un collectif qui pratique la médiation et qui intervient souvent directement auprès des personnes qui ont commis ou subi le préjudice.
Comme nous le disions, pour notre part, nous ne faisons pas de médiation, nous nous préoccupons avant tout de la responsabilisation collective et de l’autonomisation de l’entourage des personnes concernées, et nous nous identifions davantage à un groupe de recherche qu’à un groupe d’intervention. Un peu à l’inverse de nous, les membres du collectif Fracas ont commencé par des interventions, avant de produire des documents théoriques sur leurs différents réseaux et de se renseigner plus précisément sur les principes de justice transformatrice. Avec matrisses, nous partons d’un travail de recherche assez conséquent sur la généalogie de la justice transformatrice, ses principaux auteurices, praticiens, expériences… Les interventions sont beaucoup plus récentes dans notre pratique.
Quant aux sites d’information, on s’en différencie encore plus clairement étant donné qu’ils communiquent à sens unique et produisent beaucoup de contenu. Nous produisons encore très peu et cherchons davantage à partager ou agréger des analyses et expériences existantes, à en extraire des pistes et des questionnements[6].
L’intérêt de notre démarche réside dans le partage de savoirs et l’expérimentation de pratiques, ce qui se joue dans les accompagnements ou dans les discussions publiques, à Bruxelles ou au-delà. Il y a là une dynamique plus enrichissante que dans une communication top down.
II existe probablement une multitude de groupes aux objectifs ou aux modes d’action proches des nôtres aujourd’hui en Belgique, qui n’ont pas ou peu d’existence publique et que nous ne connaissons pas encore. Nous avons déjà eu l’occasion d’échanger avec des collectifs qui nous étaient similaires en ce sens, que nous ne nommerons pas ici. L’intérêt de tels groupes est de contribuer à une autonomisation vis-à-vis des institutions pénales, qui renforcent les violences. De réapprendre à traiter les abus qui traversent nos groupes, communautés, familles… sans avoir pour seuls horizons la punition, l’exclusion et le recours à la prison.
Que pensez-vous de la possibilité d’avoir ou de former des spécialistes ou des professionnelles de la justice transformatrice ? Comme c’est parfois le cas de la justice restaurative. Est-ce une éventualité que vous redoutez et dont vous essayez de vous prémunir, ou au contraire, une possibilité intéressante ?
En étudiant les évolutions de la justice réparatrice, son institutionnalisation et son intégration au sein du système pénal, nous sommes plus déterminées à ce que les pratiques de la justice transformatrice ne suivent pas la même voie. En effet, les intérêts du système pénal et ceux de la justice transformatrice sont contradictoires et un auteur n’a aucun intérêt à faire preuve de réflexivité, de remise en question et d’honnêteté – qualités que demande la justice transformatrice – s’il est poursuivi dans le cadre d’un procès. En cela, la justice transformatrice n’a aucun intérêt à s’institutionnaliser. Par ailleurs, ses pratiques visent à autonomiser les personnes qui la pratiquent et non pas à former des professionnels, seuls habilités à prendre en charge ces situations, comme c’est le cas pour la justice restauratrice.
Historiquement, la création du concept de justice transformatrice était une manière de contrer la professionnalisation de la justice restaurative au sein de l’institution pénale. Donc si elle s’institutionnalise et se professionnalise, ce n’est plus de la justice transformatrice… ça redevient de la justice restaurative. L’engouement qu’il y a autour de la justice transformatrice pourrait bien ajouter de la confusion dans tout cela et dépolitiser ou libéraliser cette tentative de nommer et partager la réappropriation collective des préjudices par les communautés qui les subissent. À surveiller, car nous soupçonnons qu’une professionnalisation impliquerait un appauvrissement collectif, et freinerait le partage et la co-construction de savoir-faire.
Côté matrisses, quand nous avons commencé à nous former collectivement, mais aussi individuellement, nous avons craint de prendre une position de surplomb vis-à-vis de nos interlocuteurs·trices. Nous redoutons la posture d’experte, car nous sommes persuadées que les personnes sont les expertes de leur propre situation. Elles seules sont en mesure de comprendre finement dans quels faisceaux de pouvoirs elles sont prises. Simplement elles n’ont pas toujours un cadre adéquat pour prendre suffisamment de recul sur leur situation. Et arriver en croyant savoir (mieux qu’elles) peut avoir des conséquences néfastes sur leur vie.
Nous nous transmettons un maximum de nos apprentissages entre membres de matrisses, pour éviter que chacune ne se spécialise trop rapidement par rapport aux autres. Quelque part, et cela transparaît à travers nos choix de formations et dans nos parcours politiques, nous apprenons à désapprendre une bonne partie de ce que l’on nous a mis dans la tête et le corps depuis l’enfance… Notre objectif est d’autonomiser les groupes démunis vis-à-vis de leurs conflits, pas de créer une dépendance à nos connaissances. C’est pour cela qu’une grosse partie de notre travail consiste à partager des outils, cultiver des modes de présence ouverts, et que nous tenons à garder notre position de troisième ligne dans les interventions. On veut éviter tant que possible de prescrire.
Pour terminer, avez-vous des revendications ? Comment voyez-vous à long terme l’existence de votre collectif ?
Pour nous, la question des revendications recoupe celle de notre difficile positionnement dans le mouvement social. Un outil peut-il porter des revendications au-delà de lui-même ? A suivre !
L’horizon le plus lointain qu’on puisse imaginer à ce stade est une mise en réseau du groupe avec d’autres initiatives du même ordre, dans un rapport clarifié aux luttes anti-carcérales, avec des outils riches et nombreux qui font leur chemin et inspirent d’autres pratiques de justice.
- [1] Ajari Norman, « Phallicisme et abolition. Repenser la justice transformatrice à partir des Black Male Studies », Multitudes, 2022/3 (n° 88), p. 87-93.
- [2] TRANSFORMHARM. generation FIVE. TransformHarm.org [en ligne]. 2023 [consulté le 20 avril 2023]. Disponible sur : https://transformharm.org/resource_author/generation-five/
- [3] Hackso Viciss, « La justice transformatrice en action : abus sexuels à Hollow water – Hacking social », Hacking social (en ligne). 1 février 2021 (consulté le 20 avril 2023). Disponible sur : https://www.hacking-social.com/2021/02/01/jr6-la-justice-transformatrice-en-action-abus-sexuels-a-hollow-water/
- [4] Les termes de justice restaurative et justice restauratrice sont tous deux en usage.
- [5] Rancière Jacques, Le maître ignorant, Fayard, 1987.
- [6] Le site www.matrisses.bruxxel.org, prochainement en ligne, présentera notre travail et un formulaire de contact.