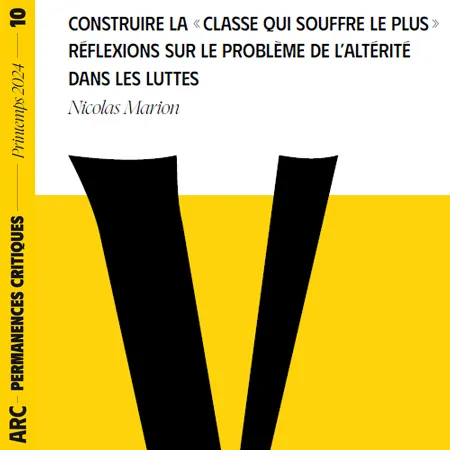Dans le Tympan d’ouverture de ses Marges de la philosophie, Derrida écrivait
Tenir à penser son autre : son propre autre, le propre de son autre, un autre propre ? À le penser comme tel, à le reconnaître, on le manque. On se le réapproprie, on en dispose, on le manque ou plutôt on manque (de) le manquer, ce qui, quant à l’autre revient toujours au même[1].
Cette reconnaissance du sujet comme divisé entre l’autre du propre et le propre de l’autre, ou cette pensée d’un autre qu’on s’efforce de manquer dès lors qu’on le pense comme autre définit une attitude qui, politiquement, conditionne et interroge les conditions transcendantales du devenir-révolutionnaire propre aux sujets du capitalisme : comment concevoir une lutte commune à partir d’individus d’autant plus disparates que le système capitaliste entretient et accentue – notamment par la division sociale du travail – leur disparité, leur isolement, leur distinction ? À plus forte raison au sein d’un champ social où l’ethos politique nécessaire pour engager ce qui sera désigné et reconnu comme une lutte légitime est détenu par les intellectuels et les militants de gauche, dont on identifiera le propre à la façon dont ils s’approprient et définissent l’altérité des autres groupes sociaux : tant de leurs ennemis politiques que de ceux à qui ils réfèrent directement leur politisation, c’est-à-dire à ceux que le capitalisme opprime dans son procès d’exploitation.
À la façon du tympan derridéen, la subjectivité politique de l’intellectuel/militant de gauche semble en effet devoir toujours être pensée comme une toile tendue entre l’oppresseur et l’opprimé, le bourgeois et le prolétaire, comme une peau destinée « à équilibrer les pressions frappantes du typtein, entre le dedans et le dehors[2] ». On peut se demander, non sans cynisme, si il n’y a pas un potentiel réactionnaire actif dans une telle disposition subjective ? Ce potentiel est lié au fait que le militant/intellectuel de gauche est souvent amené à se penser comme le dépositaire exclusif de cette position d’équilibre qui le définit en propre : d’être en quelque sorte le centre des luttes, seul à même de savoir comment lutter adéquatement, c’est-à-dire de poser ses limites propres comme devant être celles de tout autre et de toute forme de lutte. De rarement se laisser « frapper » par ceux qu’il tend pourtant à vouloir représenter et organiser. De penser son autre comme toujours déterminé, et jamais déterminant. Si bien que, dès lors que la subjectivité de l’altérité visée résiste à cette appropriation et aux cadres de sa mobilisation, elle induit une sidération qui déstabilise les schèmes cognitivo-subjectifs de celui-là même qui entendait « en disposer » : à la lettre, cette altérité devient une violence du dehors qui fait problème à la pensée.
Là est, précisément, la problématique que nous voudrions poser à travers cet article : comment la question de la subjectivité militante doit être reposée à partir de la critique de cet habitus appropriatif qui la caractérise, c’est-à-dire à partir des pratiques réelles de résistance aux injonctions à la subjectivation (« reconnais-toi comme militant ! », « sois digne ! », « il faut s’émanciper ! », etc.) que le capitalisme impose aux dominés et que cette subjectivité médiane de l’intellectuel/militant est, souvent, incapable de percevoir ? Comment ce que suppose la resubjectivation d’un processus d’émancipation (sur le mode d’une ouverture de la subjectivité opprimée à un processus d’émancipation) est une question qui, précisément, empêche de voir comment, quotidiennement, la victime de l’oppression oppose déjà au capitalisme des stratégies de contre-subjectivation rendant impossible cette clôture totalisante d’un sujet normalisé (au sens où personne n’est, en fait, totalement passif face à sa propre réalité) ? Il nous semble que, précisément, ce sont ces stratégies qui devraient polariser les luttes portées par les militants de gauche, et non l’inverse. Notre problème sera donc pragmatique : suivant quelle méthodologie peut-on, depuis ce que font les catégories sociales opprimées, crever le tympan du militant « et continuer à se faire entendre de lui[3] ? » La question est d’autant plus urgente que, c’est notre hypothèse, si ce caractère dogmatique de la subjectivité de gauche n’est pas interrogé dans ses effets, il a toutes les chances de générer des oppressions inconscientes très dommageables pour les sujets les plus précarisés du capitalisme.
En effet, si, à l’échelle sociologique du capitalisme, l’altérité sociale est une notion aussi élastique que le référentiel politique présidant à son identification, elle s’ancre pourtant nécessairement dans ce qui oppose – tout au long de ce qu’il faut bien désigner comme un continuum de la précarité (partant de la plus grande précarité jusqu’aux plus nantis) – les individus dont la plus grande misère matérielle conditionne la subjectivité et ceux qui, de cette misère, n’ont que le spectacle lointain. À l’intersection de cette distribution sociale bipolaire existent, de même, ceux que Bourdieu pointait comme occupant au sein de « l’espace des points de vue » une misère de position, souvent relativisée à tort :
[elle concerne] tous ceux qui, comme le contrebassiste [de Suskind] au sein de l’orchestre, occupent une position inférieure et obscure à l’intérieur d’un univers prestigieux et privilégié, expérience d’autant plus douloureuse sans doute que cet univers, auquel ils participent juste assez pour éprouver leur abaissement relatif, est situé plus haut dans l’espace global[4].
Cette « petite misère », qui est souvent aussi celle des militants et des professions « qui ont pour mission de traiter la grande misère ou d’en parler, avec toutes les distorsions liées à la particularité de leur point de vue[5] », entretient donc un rapport singulier avec la grande misère, celle des personnes touchées par le sans-chez-soirisme. Que ce rapport soit biaisé et lui-même enserré par les diverses forces sociales qui le déterminent n’importe que dans la mesure où ces mêmes biais et paradoxes (ceux de la petite bourgeoisie nouvelle, à la fois bourgeoise et désireuse d’une société plus égalitaire) sont l’occasion de repérer le potentiel de marges de manœuvre qui, pour ces opprimés, demeure en excès à leur appropriation et à leur mise à disposition de cette construction de l’altérité dont ils sont l’objet (et qui, pour reprendre les mots de Derrida, « revient [pour eux] toujours au même »).
C’est à ce titre que nous nous intéresserons à la population sans chez-soi et à l’intérêt, eu égard à la « résistance » (nous aurons à préciser en quel sens) que cette population oppose au réel et aux populations qui s’adressent à eux, qu’il y a à polariser toute subjectivité politique non pas à partir de ce que l’autre aurait à devenir et à produire (donc à partir de la façon dont on entendrait disposer de lui), mais bien à partir de ce que, en acte et déjà en excès, cet autre produit, même impersonnellement, comme stratégies et devenirs pour contrecarrer et se soustraire aux multiples assignations qui le visent. De cette façon, si, classiquement, « l’étude de la question SDF est […] un prisme pour apprécier les évolutions d’une action publique unilatérale et centralisée[6] », elle sera ici le prisme au travers duquel nous évaluerons en quoi résister à l’appropriation subjective[7] est un acte qui, aujourd’hui, est porteur d’une radicalisation du sens de la lutte politique. Cette approche fournira l’occasion de repenser le problème de la méthodologie critique d’une action politique devant se faire « à partir de la base » : si le projet d’une éducation populaire visant l’action politique doit avoir un sens, c’est en tant qu’il rend possible une éducation des militants par le peuple et les opprimés (et non l’inverse) ; en tant, donc, que son dispositif modifie et renverse les rapports de domination actif entre les opprimés et leurs alliés objectifs.
Par-delà le mépris du lumpenproletariat
Le mépris et la sous-hominisation de ces catégories subalternes qu’incarnent les sans-chez-soi, bien qu’ordonnées à des motifs variables, sont des opérations communes aux deux grandes orientations politiques de l’Histoire moderne : tant la gauche que la droite tiennent ces populations pour être impropres à l’humanité politique. Ce célèbre passage du Manifeste du parti communiste en témoigne : « Quant au lumpenprolétariat, ce produit passif de la pourriture des couches inférieures de la vieille société, il peut se trouver, çà et là, entraîné dans le mouvement par une révolution prolétarienne ; cependant, ses conditions de vie le disposeront plutôt à se vendre à la réaction[8]. » L’ensemble caractéristique d’épithètes adressées à ces sous-Hommes issus de cette sous-classe prolétaire ne manque pas, dans ces mots de la gauche radicale originelle, d’offrir la plus pure collection des stéréotypes à partir desquels le bourgeois (qu’il soit petit bourgeois ou non) circonscrit, encore aujourd’hui, l’oisif non-travailleur, le vagabond : d’être un pur produit, passif et inférieur, d’être vendu – et d’ailleurs très probablement réactionnaire. Le prolétaire en haillons, souvent réduit à de la racaille, n’est pour ainsi dire, à tort ou à raison, jamais ou rarement perçu comme porteur d’une puissance politique ou d’une capacité d’organisation : il pourrait, voire devrait, être abandonné à l’inanité complète du néant de son existence, quitte à survivre par la charité des plus riches que lui. Dans Les luttes de classes en France, lorsque sont décrits les bataillons du Gouvernement provisoire, on peut lire sous la plume de Marx ce complementum à l’extrait du Manifeste, précisant combien – même mobilisés – ces sous-prolétaires seraient incapables de renier leur fondamentale sauvagerie :
Ceux-ci appartenaient pour la plupart au lumpenprolétariat, qui dans toutes les grandes villes constitue une masse nettement distincte du prolétariat industriel, pépinière de voleurs et de criminels de toute espèce, vivant des déchets de la société, individus sans métier précis, vagabonds, gens sans feu et sans aveu, différents selon le degré de culture de la nation à laquelle ils appartiennent, ne reniant jamais leur caractère de lazzarones[9].
Si certains auteurs ont pu relever que les propos de Marx désignaient une catégorie sociale qui, aujourd’hui, connaît – sous l’impulsion des effets de la précarité diffuse spécifique au capitalisme contemporain – un « rapprochement objectif[10] » avec le prolétariat, il n’en demeure pas moins vrai que la figure du sans-chez-soi occupe toujours aujourd’hui une position, issue de la division des pauvres, pour laquelle la possibilité d’une autonomie subjective n’est qu’un projet suspendu. Si la brutalité du langage usé par Marx tend à s’être modifiée au cours du temps, si des « termes nouveaux et des nomenclatures élaborées peuvent être produits », il n’en demeure pas moins, en effet, qu’aujourd’hui encore « les pratiques cognitives individuelles du policier ou du travailleur social consistent toujours à séparer la population en deux, pour déterminer qui ou quelle situation doit impliquer une intervention[11] » : en d’autres termes, on continue d’opérer une distinction entre le bon prolétaire insérable et mobilisable et le mauvais pauvre marginalisé et irrécupérable, entre l’animal docile et la bête immonde, entre le sujet digne et l’objet social.
Dans la configuration néolibérale du capitalisme, la division prolétarienne autant que le rapprochement objectif des populations opprimées tendent à imposer une perception sociale où le fait même de parler de prolétariat semble être devenu purement insensé, la fin du prolétariat devenant l’un des lieux communs omniprésents de la gauche contemporaine :
Si l’existence même du prolétariat s’inaugure dans sa lutte contre la bourgeoisie, alors le jour où cette lutte s’affaisse pour se réduire à une (courte) série de conflits corporatistes et épars, il n’y a plus de prolétariat. Mais alors, que reste-t-il ? Quelque chose comme un monde de cauchemar pour tout véritable démocrate. D’un côté, une classe dominante qui devient ou redevient seul sujet de l’Histoire, et donc en sécession plus ou moins complète avec le reste de la société. Et de l’autre, […] une classe dominée qui « retombe hors du processus dialectique vivant », et finit par se dissoudre entre ses deux (non-)classes frontières : d’un côté, le Lumpenproletariat, c’est-à-dire le sous-prolétariat ou « prolétariat en lambeaux » constitué des plus basses couches sociales, désorganisées, individualisées, sans conscience de classe, et donc au service du plus offrant ; de l’autre côté, les blancs-manteaux du prolétariat, la petite-bourgeoisie ou le prolétariat embourgeoisé, alliages contre nature de fonctionnaires et de petits-boutiquiers, de petits calculateurs aux intérêts « sordides » et de « rêveurs de l’absolu » (c’est à chaque fois Marx qui parle). Autrement dit, s’il n’y a plus de prolétariat, il n’y a plus, d’un côté, que des acheteurs et, de l’autre, à la fois des individus achetables (la « racaille », suivant la traduction actuelle et signifiante de Lumpen) et des individus achetés (les fonctionnaires, les clercs, les petits commerçants et artisans)[12].
Qu’est-ce à dire sinon que reviennent ici les difficultés que nous énoncions en introduction concernant le procédé par lequel, devant instituer son altérité comme un potentiel appropriable (faire, en somme, du pauvre un « camarade »), l’intellectuel-militant de gauche se condamne à la manquer précisément parce qu’il ne la perçoit que dans ce qui, d’elle, peut résonner par lui et à partir de ce qu’il possède en propre : la conscience de classe, la légitimité de lutte, les principes moraux, l’hygiène de corps comme de vie, la supériorité, la capacité. L’altérité du militant/intellectuel de gauche, quand elle n’est pas celle du plus dominant que lui mais celle des pauvres non-mobilisés, n’est pas un ensemble humain autonome mais, souvent, une masse « achetable » que seul un processus éducatif long, un retour à la dignité, permettrait d’élever au niveau de la conscience critique de classe. Ce mépris social, transcendantal en ce qu’il touche aux conditions de possibilité même du rapport de classe, nous semble s’intégrer dans ce que le capitalisme néolibéral lui-même produit comme mode de subjectivation spécifique : une perméabilité sociale strictement construite sur l’expérience différenciée d’un spectre de précarité qui, précisément, distribue avec fluidité l’humanité sur un continuum s’étendant depuis la quasi-animalité, celle des grands précaires qui survivent, aux seuls sujets de l’Histoire que sont les vrais « dominants », c’est-à-dire aux détenteurs du grand capital qui, au sein du même monde, hyper-vivent.
Sortir de ce prisme subjectif spécifique suppose alors un dessaisissement qui, dans le procès d’autolégitimation de la gauche, permet d’empêcher sa forclusion, sa fermeture sur elle-même – sur ses propres références, sur ses attendus sociaux spécifiques autant que sur ses objectifs supposés communs. Cette entreprise de dessaisissement subjectif par le changement de regard sur l’extrême marginalité et ses modes de vie et de résistances propres fut, notamment, l’objet d’une œuvre majeure de la bibliographie de Georges Orwell : Dans la dèche à Londres et à Paris. Y détaillant avec précision la vie de vagabondage dans le début des années 1930 en Angleterre et en France, l’auteur consigne – outre une description remarquable de toutes les stratégies du quotidien que doivent élaborer les personnes réduites à l’indigence et maintenues par les lois dans cet état – un ensemble de réflexions sur la critique nécessaire à la compréhension de ce que montrent et font les sans-abris. Cette critique, précisément, s’ancre dans l’effort que seule rend possible l’expérience de la grande pauvreté : celui de sortir du mythe de la fracture subjective propre à l’opprimé, c’est-à-dire se rendre capable de suspendre le doute fondamental et ontologique sur la capacité des sans-chez-soi (doute faisant donc de tout sans-chez-soi un pur incapable).
C’est une idée que l’on nous a inculquée dès l’enfance, si bien qu’il existe aujourd’hui dans notre esprit une sorte d’archétype mythique du vagabond : un être abominable et plutôt dangereux qui préférerait mourir plutôt que de travailler ou de se laver, et qui passe son temps à mendier, à boire et à voler […][13].
Cet effort de dessaisissement ne repose pas tellement sur un choix volontaire de celui qui se rapporte à cette altérité incarnée par le sans-chez-soi, mais bien plutôt sur sa capacité à voir dans celui qui se présente comme SDF/sans-chez-soi/immense/grand précaire qu’il est le produit d’un effort à être ce SDF/sans-chez-soi/immense/grand précaire, c’est-à-dire à s’être, à la fois, intégré dans le mythe opératoire de ceux auprès de qui il pense pouvoir bénéficier de cette reconnaissance et d’avoir conquis une existence, même si fragile, lui permettant d’être, au moins, reconnu comme SDF/sans-chez-soi/immense/grand précaire. Non pas, bien entendu, que la précarité soit un effet recherché, mais l’expérience même du sans-chez-soi est, aussi, toujours déjà celle d’une déconstruction du mythe produisant son stigmate – déconstruction permettant à celui qui en subit les effets d’opposer, çà et là, des stratégies de survies et de résistance. C’est là la puissante intuition de Goffman quant à la particularité des stigmatisés :
Le normal et le stigmatisé ne sont pas des personnes mais des points de vue. Ces points de vue sont socialement produits lors des contacts mixtes, en vertus des normes insatisfaites qui influent sur la rencontre[14].
Cette question perspectiviste du point de vue est, précisément, ce par quoi la « question SDF » peut être interrogée à partir de la problématique de la production de subjectivité politique dans le capitalisme néolibéral.
De l’exclusion coupable : l’autre schème de la déviance
Le travail, absolument crucial, de Patrick Declerck et de son ouvrage Les Naufragés portant sur la population sans-chez-soi a mis à jour toute l’étendue problématique des complexes définissant le mal nommé « sans-abrisme », parmi lesquels celui de l’importance de la correction subjective qu’impose aux acteurs sociaux le fait même de la grande pauvreté.
Un des aspects les plus caractéristiques de la question SDF est l’indépassable confusion mentale qui semble affecter les responsables étatiques et associatifs aussi bien que les médias. Tous font preuve d’une incapacité tenace à constituer l’objet SDF. […] Qui sont-ils ces errants, ces voyageurs de l’étrange ? D’où sortent-ils ? Que veulent-ils[15] ?
Cette sidération, récurrente dans les secteurs sociaux en charge du phénomène, est presque omniprésente dans la recherche intellectuelle ayant le sans-chez-soirisme pour objet, tant la circonscription du phénomène est, c’est là notre hypothèse, celle d’une réalité dont le caractère brut, la violence pure et la pleine permanence entraînent un besoin de voir du potentiel et de l’évolutif dans cet intolérable : le fond fuyant du SDF ébranle, à la lettre, le seuil subjectif d’une foi fondamentale dans une altérité appropriable encore possible depuis la grande pauvreté.
À travers l’omniprésent espoir caractérisé de la gauche, celui de voir dans l’oppression la puissance d’une révolte, d’une dignité arrachée au réel du marché écrasant, d’une émancipation de l’hétéronomie de la domination, le sans-chez-soi n’est jamais aussi bien nié : ce que montre la vie en rue, dans ses stratégies de survie autant que dans le témoignage de ses « habitants », c’est l’inanité de la sacralité de la pauvreté, c’est-à-dire la non-urgence absolue d’être mobilisé par ceux qui fantasment et édifient la valeur de la pauvreté. Parlant, dans une correspondance, de son ouvrage Les naufragés, Declerck dira :
Les pages de cet ouvrage le montrent bien : la pauvreté est une abjection qui, loin d’élever l’homme, l’écrase et le nie, en l’enchaînant à l’épuisante et itérative obligation de tenter désespérément de satisfaire, jour après jour, heure après heure, ses besoins les plus élémentaires. […] Je constate, en outre, que l’exaltation misérabiliste semble sévir le plus souvent chez les biens nourris ; les pauvres, eux, sont sur le sujet, d’une manière générale, étrangement moins lyriques. A croire que ce qui est édifiant dans la misère, c’est surtout la misère des autres[16] …
Si bien que s’expose ici une fiction de la grande pauvreté, un point de vue sur le sans-chez-soi répondant à une fonction spécifique qu’il faudrait ici mettre à jour et peut-être renverser si l’on veut en tirer une puissance critique.
Nous discuterons ici et à cette fin les thèses de Declerck sur les motifs expliquant cet état de chose. L’appréhension du « phénomène SDF » serait, selon lui, souvent symptomatique du maintien d’un statu quo arbitraire permettant l’exploitation de cette violence de la misère aux fins d’une organisation sociale visant à appuyer l’idéologie dominante propre au contexte néolibéral contemporain. L’appropriation subjective dont les sans-chez-soi sont l’objet serait le produit de la nécessité de circonscrire le rapport aux sans-abris à la relativité des opinions et à l’équivalence de leurs diagnostics variables, intimant à la société de ne rien devoir faire, de considérer le sort des sans-chez-soi comme une pure fatalité : en d’autres termes, il s’agirait de maintenir intacte la tolérance à cette mort lente qu’est, souvent, le sans-chez-soirisme.
Si, en effet, le SDF est toujours épistémologiquement ailleurs, impalpable, inassignable, la réalité, alors, n’existe plus. Tout savoir devient impossible. Si le SDF est trop fugace pour être objet de savoir démontrable, c’est-à-dire objet de science, comme l’est le cardiaque ou le schizophrène, alors, en dernière instance, tous les discours se valent et tout est permis. Nous sommes ainsi condamnés à la tiède et confortable médiocrité du règne de la doxa, de l’opinion où, par définition, celle-ci, mon Dieu, vaut bien celle-là[17].
La vie toute entière des sans-chez-soi est celle d’efforts permanents, confinant leur survie à la souffrance quotidienne qu’induit, outre l’extrême rigueur corporelle et psychique imposées par de telles conditions d’existence, le vécu d’un être en charge d’exprimer, de la norme, le devoir et la volonté de la rejoindre et de s’y conformer s’il ne veut pas, purement et simplement, en mourir. Ce que Declerck désigne comme la « stupidité systémique » de cet état de chose, où tous ruminent une diversité d’opinions qui, bien que toujours accordées sur la dénonciation de l’inadéquation des solutions proposées au problème et des prises en charge soutenues, n’aboutissent jamais à la mise en place de dispositifs et de luttes capables d’enrayer le phénomène ou, au minimum, d’entendre ce qu’en disent les principaux concernés ; cette stupidité, donc, intervient dans la fonction idéologique du processus « d’exclusion incluante » caractéristique de la division sociale du capitalisme.
Pourquoi donc tant d’imbécillité ? Parce que contrairement à ce qui est annoncé, proclamé, revendiqué à grands cris déchirants, effets de manche solidaires, et déclarations immortelles qui sont de purs sanglots… Contrairement à ces tombereaux de foutaises, ce n’est pas de l’aide aux hommes, femmes et enfants de la rue dont il s’agit ici. Ce dont il est question, avant tout, dans ce dosage non pas de l’aide, mais de l’oppression, est, non pas le soulagement des souffrances, mais bien la gestion des limites de la tolérance générale au scandale public[18].
Et cette tolérance est – bien qu’à des degrés variables – aussi bien celle des institutions publiques et privées en charge de cette précarité que de la gauche dans son ensemble, cette dernière n’ayant jamais pu véritablement outrepasser le prisme du lumpenprolétariat comme sous-prolétariat.
Conclusion
Si, pour l’organisation du capital et la mobilisation qu’il suppose, « il est, à la réflexion, assez salutaire que souffrent et meurent dans la rue et sous nos yeux quelques-uns de ces insupportables oisifs[19] », il n’est pas certain que cette exclusion nécropolitique ne soit pas aussi, au bénéfice inconscient du tympan de la gauche militante/intellectuelle. Jusqu’à quel point cette exclusion fondamentale dont les sans-chez-soi sont à la fois le nom et le spectacle n’offre-t-elle pas une sanction infigurable à ceux que l’oppression subie ne conduit pas à « se mobiliser » et « à lutter » mais plutôt à cette transgression fondamentale que représente l’acte de se détruire sous nos yeux, à demeurer une altérité possiblement immobilisable et inappropriable, à ne pas être seulement de pures victimes socio-économiques d’un système opprimant mais bien des survivants allant jusqu’à s’opposer à l’amélioration de leur état ? Cette irréductibilité du phénomène SDF « à sa seule dimension socio-économique est encore soulignée par l’immense résistance au changement souvent opposée par les clochards à toute amélioration durable et structurelle de leur état[20] ». Elle génère ainsi, dans la position subjective de l’opposition politique de gauche, cet indicible qu’est l’atteinte psychique de la pauvreté quand elle touche à la possibilité même de la socialisation (sur laquelle repose la conscience de classe) : celui d’une résistance à la dignité, d’une liberté qui – à la lettre – ne s’obtient qu’en y renonçant. Pour reprendre notre vocabulaire initial, est-ce que cette résistance à la mobilisation (par les motifs de dignité, d’autonomie, de révolte, etc.) que présentent parfois les sans-chez-soi n’induit pas, dans la subjectivité des militant·e·s et des intellectuel·le·s de gauche, une sidération telle que ciels-ci préfèrent presque les abandonner à la catégorie d’une exclusion pure et dure, intouchable et indépassable, à une mort possible et, finalement, tolérable ? Et, en ce sens, ne faudrait-il pas, pour en finir avec la prétendue « fatalité » du sans-chez-soirisme, reconsidérer profondément la façon dont la gauche militante et intellectuelle construit ses altérités politiques, ses sujets mobilisables, ses fantasmes d’émancipation ?
- [1] Derrida Jacques, Marges de la philosophie, Paris, Minuit, 1972, p.II.
- [2] Ibid., p.III.
- [3] Ibid.
- [4] Bourdieu Pierre, « L’espace des points de vue », dans BOURDIEU, P. (Dir.), La misère du monde, Paris, Seuil, 1993, p.16.
- [5] Ibid., p.17.
- [6] Damon Julien, « 1. Déclin de la coercition et montée de la thématique de l’exclusion », dans La question SDF. Critique d’une action publique, Paris, Presses Universitaires de France, 2012, p.62.
- [7] A la manière, par exemple, de l’éducation permanente qui, par son intérêt spécifique à travailler avec des « publics populaires », ne manque pas de s’approprier à ses fins propres ce que peut bien signifier la subjectivité « populaire ».
- [8] Marx Karl, Engels Friedrich, Le Manifeste du parti communiste, Paris, Messidor/Éditions sociales, 1986, pp.70-71.
- [9] Marx Karl, Les luttes de classes en France, Paris, Gallimard, 2002, p.30.
- [10] Carlino Fabrizio, « Autonomisation de la catégorie de Lumpenproletariat et pratique de la violence », Cahiers du GRM [En ligne], 2 | 2011, §56. Mis en ligne le 05 août 2010. URL : http://journals.openedition.org/grm/245, consulté le 06 décembre 2018.
- [11] Damon Julien, « 1. Déclin de la coercition et montée de la thématique de l’exclusion », Loc.Cit., p.29.
- [12] Zaoui Pierre, « Le prolétariat hors la lutte ? », dans Cités, vol. 35, no. 3, 2008, p.57.
- [13] Orwell Georges, Dans la dèche à Londres et à Paris, Paris, Ivréa, 1982, p.257.
- [14] Goffman Erving., Stigmates. Les Usages sociaux des handicaps, Paris, Minuit, 1975, p.161.
- [15] Declerck Patrick, Le sang nouveau est arrivé, Paris, Gallimard, 2005, pp.99-100.
- [16] Declerck Patrick, Les naufragés, Paris, Plon, 2001, p.427.
- [17] Declerck Patrick, Le sang nouveau est arrivé, op. cit., p.101.
- [18] Ibid., p.102.
- [19] Ibid., p.103.
- [20] Declerck Patrick, Les naufragés, op. cit., p.286.