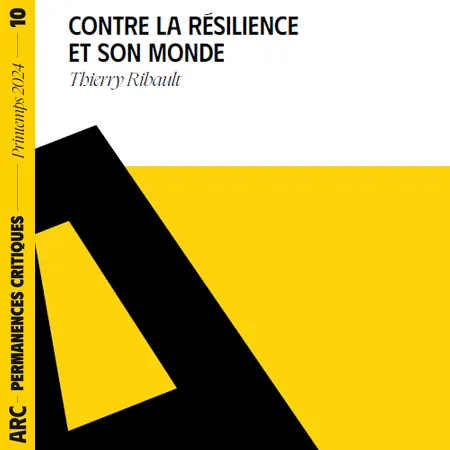Petite histoire de la notion de résilience
La résilience tire son héritage sémantique et cognitif de la science des matériaux. Le bois, pour les traverses de chemin de fer, au début du XIXe siècle, puis les métaux, notamment pour la guerre, au début du XXe, étaient dits « résilients » pour leur capacité à absorber de l’énergie sous l’effet d’une déformation ou d’un choc, avant de revenir à leur état initial. La résilience sera mobilisée dans la psycho-sociologie positive, à partir des années 1940, pour caractériser le comportement « non délinquant » de jeunes issus de milieux pauvres et porteurs de caractéristiques rédemptrices : constituant des familles peu nombreuses, avec des naissances espacées, et bénéficiant de l’attention d’une personne bienveillante et détenant les ferments d’ « une profonde foi religieuse ». On retrouve quatre-vingts ans plus tard cette dernière conviction pseudo-scientifique chez le neuropsychiatre et éthologue Boris Cyrulnik, pour qui « la neuro-imagerie confirme l’effet thérapeutique de Jésus et nous explique comment ça marche ». Il en conclut que la « foi est donc bel et bien un facteur de résilience[1] » et confirme l’idée que le champ cognitif de la résilience, proche du religieux, se prête aisément à une utilisation manipulatoire.
L’importation en écologie de la notion de résilience se fera officiellement dans les années 1970, après que les frères Eugene et Howard Odum, biologistes dépêchés au milieu des années 1950 par l’US Atomic Energy Commission pour étudier l’irradiation par les essais atomiques américains des atolls coralliens micronésiens situés au centre de l’océan Pacifique, ont élaboré un modèle d’écosystème structuré et autorégulé. L’écologie systémique a donc émergé du champ de l’« écologie des radiations» (ou radioécologie), et de son intérêt morbide pour l’étude de la capacité du vivant à s’adapter à sa propre destruction et à en tirer parti. Dans les années 1970, l’écologue Crawford Holling développera un programme de « sécurité écosystémique » qui prendra le nom explicite de « résilience », désormais revêtue de ses atours contemporains et définie comme étant non seulement « la capacité d’un système à supporter l’impact de chocs déstabilisateurs » mais lui permettant aussi de « se réorganiser rapidement et efficacement afin de capitaliser sur des opportunités émergentes ».
Durant les décennies 1990 et 2000, aux États-Unis et en France, le recours à la notion sera généralisé à de nombreuses « expériences douloureuses » – cancer, sida, perte d’un proche, captivité, catastrophes naturelles et industrielles, attentats, maltraitance –, autant d’épreuves que les êtres humains sont censés accepter en leur trouvant un sens, en conservant leur dignité morale et le respect de soi et, accessoirement, en n’y laissant pas leur vie. Ce baume de la réparation est désormais appliqué aux divers champs scientifiques, allant de l’écologie jusqu’aux sciences sociales, en passant par l’ingénierie et, plus récemment, la neurobiologie s’en est emparé pour définir les capacités physico-chimiques de chacun à résister au stress.
Se voulant être une thérapie censée soigner, entre autres, les rescapés des camps de la mort, dans lesquels ils étaient exploités en tant que matières premières pour la production et comme matériaux d’expérimentations en tous genres, et où tirer vertu de l’endurcissement et apprendre à vivre en affrontant la mort étaient les funestes règles d’or, la résilience, qui n’a jamais renié ses principes fondamentaux issus de la science des matériaux, s’inscrit dans une redoutable recherche de surhumanité, considérant « l’expérience du camp de la mort comme chemin initiatique et procurant une force de vie[2] ». De la résistance et la déformation de la matière, à la résistance et la déformation des êtres humains et du vivant en tant que matière, il s’agit d’explorer les mille et une manières de faire plier l’objet concerné sans le rompre, afin de le rendre conforme à son milieu et aux pressions subies, et d’éventuellement sortir renforcé de l’épreuve. « Sans rompre » signifie, pour les « objets humains » concernés : produire pour consommer, être un bon citoyen en se soumettant sans cesser de vivre – donc en survivant – autant dire : être résistant sans opposer de résistance.
Loin d’une simple rhétorique à la mode, la résilience est une technologie du consentement. À la fois un discours tenu sur la technique et une technique elle-même, dont la finalité est d’amener les populations en situation de désastre à consentir à la technologie − à Fukushima il s’agit du nucléaire, mais il peut aussi s’agir de consentir aux technologies de surveillance durant le Covid − ; à consentir aux nuisances, en rendant incontournable le fait de « vivre avec » ; à consentir à la participation, à travers la cogestion des dégâts qui déresponsabilise les responsables ; à consentir encore à l’ignorance, en désapprenant à être affecté par ce qui nous touche au plus profond, notre santé notamment, ou notre liberté ; à consentir, enfin, à expérimenter de nouvelles conditions de vie induites par le désastre.
La résilience nationale : du Japon à la France, prétendre clore l’impossible
Durant la décennie consécutive à l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi en mars 2011, la menace n’a pas fléchi. Le début du chantier de récupération des barres de combustible dans les piscines suspendues des réacteurs a été sans cesse repoussé, les niveaux de radioactivité y étant trop élevés. Si l’une des piscines a été vidée, les deux autres, non protégées, présentent un danger considérable en cas de nouveau tremblement de terre de forte magnitude. Quant aux cœurs de trois des six réacteurs de la centrale, dont un contenant du plutonium, ils sont entrés en fusion suite à la perte du système de refroidissement, laissant 900 tonnes de corium constitué de matières fissibles, de béton et de ferraille, inaccessible à tout être humain d’ici le prochain demi-siècle, et probablement au-delà. L’injection continue d’eau et les débordements d’origine souterraine constituent toujours des menaces majeures : le stockage sur site est saturé et les eaux radioactives partiellement filtrées sont désormais rejetées dans l’océan.
Côté humain, les efforts sans fin engagés depuis treize ans pour limiter la radioactivité entraînent l’irradiation des travailleurs mobilisés. Les conséquences sanitaires sont d’autant plus invisibilisées qu’une grande partie des 60 000 liquidateurs qui sont intervenus sur le site de la centrale depuis le début de la catastrophe, était sans dosimètre durant les premiers mois ayant suivi l’accident, et, soucieux de ne pas perdre leur travail dans la sous-traitance du nucléaire qui entretient des liens notoires avec les yakuzas, ont triché sur leur dose cumulée. Par ailleurs, trente mille décontaminateurs aux conditions de sécurité tout aussi discutables ont été mobilisés sur l’ensemble du département. Dans ces conditions, les possibilités d’établir des liens entre les pathologies cancéreuses et non-cancéreuses développées par ces travailleurs et leur activité sur les sites contaminés sont pratiquement réduites à néant. Ainsi comprend-on mieux l’infâme imposture du bilan officiel de la catastrophe nucléaire de Fukushima : « zéro mort ».
Parmi les 370 000 personnes du département ayant moins de 18 ans au moment de l’accident, le nombre total de cas de cancers de la thyroïde suspectés ou confirmés est à ce jour de 270, à comparer à un taux moyen se situant au Japon entre 2 et 3 cas pour 1 million d’enfants. Les autorités invoquent un effet lié au « surdiagnostic », tandis que certains épidémiologistes parlent d’ « épidémie de cancers de la thyroïde ». La catastrophe est donc en cours.
Malgré ce bilan accablant, et sur la base du triple déni – pas de mesure, pas d’enquête, pas de victimes – il s’est très vite agi, au Japon, de réussir la reconstruction et, dans les mégalopoles, relancer la machine à profit dare-dare, chacun à son poste, consommateur et producteur, afin de nourrir l’illusion d’achèvement du désastre, qui est un refoulement de son inachèvement. La catastrophe, un impossible non résolu, serait close, comme on clôt un dossier dans une affaire criminelle. Or comment peut-on raisonnablement prétendre clore l’impossible ?
C’est précisément toute la frauduleuse ambition de la résilience et de ses adeptes. Face à cet impossible non résolu, des outils politiques centrés sur la notion de résilience ont été développés afin de rendre la contamination socialement acceptable. Un ministère de la « construction de la résilience nationale » a été mis en place. Un programme de décontamination encourageant les populations à prendre part à celle-ci pour ne plus craindre la radioactivité a été développé. Une injonction est faite aux gens de Fukushima à être des contaminés satisfaits. Ainsi selon le professeur Shinichi Niwa, responsable du volet psychiatrique de l’« Enquête de gestion sanitaire de la population » à l’université médicale de Fukushima, « les gens peuvent se sentir en sécurité lorsqu’ils exécutent eux-mêmes les travaux de décontamination plutôt que de les laisser faire par d’autres », ce qui est une manière de fabriquer du consentement en transformant une pression externe en motivation interne. Le décontamino-thérapeute poursuit : « Il est très important, pour calmer la peur, d’être exposé aux radiations », consacrant de ce fait, sans rougir, l’inversion logique à laquelle préside la résilience lorsqu’elle entreprend de faire de la maladie un symptôme de guérison.
Second volet de cette politique de résilience, une politique d’incitation au retour des populations évacuées mettant fin à l’aide aux réfugiés, supprimant les allocations de relogement ou la mise à disposition d’habitats provisoires, et subventionnant la reconstruction d’écoles dans les communes désertées, a été instaurée. Le recours à la notion de résilience permet de substituer à la question fondamentale des effets biologiques irréversibles induits par une exposition au rayonnement ionisant, d’autres sujets, tels que l’état mental et l’habilitation des individus, l’« empowerment », et la « reconstruction » des communautés dans lesquelles ils vivent. Le désastre nucléaire n’est donc plus un moment objectif inscrit dans l’histoire des sociétés industrielles, mais un phénomène subjectif essentiellement psychologique, voire psychiatrique, au sein d’une population que l’on enjoint de sortir de sa « dépression » en misant sur ses qualités individuelles et sur les opportunités de son nouvel environnement, dans le but d’en revenir à un état « pré‑traumatique » par la grâce combinée du « rebond » et de la « résistance au choc »… accessoirement, de l’amnésie.
En matière de résilience nationale, la France n’est pas en reste. Pour la mission parlementaire d’information sur la résilience nationale créée en juin 2021, face à l’impossibilité de s’attaquer aux causes des catastrophes, il ne resterait plus qu’à rendre « nationale » la résilience, autrement dit à apprendre à chacun à faire face aux « risques », à se préparer à « vivre en mode dégradé », à « s’adapter en continu » et à « développer des représentations mentales » pour « mieux rebondir » et atteindre « une quiétude de l’esprit »[3]. Si l’on se réfère au rapport final[4] de cette mission placée sous l’égide de la Commission de la Défense nationale et des forces armées et visant à la présentation d’un projet de loi « Engagement et résilience de la nation » au début de la prochaine législature, il s’agit d’ « envisager les chocs de toute nature auxquels le pays doit se préparer » et d’éduquer les citoyens à être des bons soldats au service d’une « défense totale » de la nation, concept qui « combine et exploite l’intégralité des ressources militaires et civiles de la société, afin de prévenir et gérer une crise, un conflit armé ou une guerre ». Dans un contexte de « conflictualité généralisée à tous les espaces » et de « compétition stratégique » entre grandes puissances, ces élus en appellent à un engagement en faveur d’un durcissement de la nation qui ne peut passer que par un endurcissement des individus. Ils s’inquiètent du fait qu’ « auparavant, alors que l’effort de guerre et ses répercussions sur la population française étaient considérables, ils étaient [néanmoins] acceptés par la société », tandis qu’aujourd’hui, « l’acceptabilité sociale des crises et des difficultés est devenue plus faible »[5]. Comment les adeptes de cette « résilience nationale » envisagent-ils de nous permettre de nous adapter aux désastres ?
Gouverner dans la fatalité des désastres
La résilience participe d’une religion étatique du malheur qui justifie le désastre – dont la guerre – comme le pendant inéluctable du progrès, au point d’en faire sa source. Le coup de force eugénique de la résilience et de ses promoteurs – experts en communication du risque, scientifiques et politiques – est de soutenir que la catastrophe n’est pas ce qui survient, mais l’impréparation individuelle et collective à ce qui advient, déplaçant ainsi sensiblement la cause originelle des dégâts perpétrés. La loi « Climat et résilience » s’inscrit bien dans cette fuite devant le naufrage. L’impératif de préparation – par l’éducation, par « l’accélération de l’évolution des mentalités » et la responsabilisation individuelle – est aussi un impératif de dépassement, cette autre manière de nommer la vaste opération de refoulement diamétralement opposée à toute forme de prise de conscience, qui renvoie les origines des désastres à la fatalité ou à la contingence. Dans la même lignée, pour toute réponse au « dérèglement climatique », les résilients en marche précités, en bons dirigeants de la fatalité, se rabattent sur une énergie nucléaire dont ils reconnaissent pourtant qu’« elle comporte inévitablement des risques industriels, sanitaires et environnementaux », et « s’accompagne d’exigences supplémentaires de prévention des accidents et de résilience en cas de survenue de ces derniers », substituant la fatalité des « risques » liés à l’atome à celle des risques liés au réchauffement. Dans ce monde où chaque catastrophe est une catastrophe d’essai, « résilier » signifie gouverner dans la fatalité des désastres, sans jamais se demander si l’adaptation est véritablement adaptée.
Gouverner par la peur de la peur
Être inquiet et terrorisé, et dans le même temps faire preuve de trempe et de courage, voilà ce que loue la résilience, à l’instar de ce que toutes les guerres ont toujours loué. Ainsi lit-on dans le rapport parlementaire précité : « Nous avons tous le devoir de faire prendre conscience à nos concitoyens que le monde qui les entoure est un monde violent et qu’ils vont être rattrapés par cette violence très rapidement, quoi qu’il arrive ». Et une fois ce vent de panique semé, les rapporteurs prescrivent d’« éviter que s’immisce au sein de la population des jeunes une peur du futur », car « si ce futur est perçu comme hostile, comme menaçant, cela devient très problématique (…) la propension à l’anxiété et à la frustration des générations actuelles tend à réduire notre capacité de résilience collective dans une situation de crise grave ». Dans cet édifiant exercice de double-pensée, où il faut simultanément avoir peur et cesser d’avoir peur, il s’agit donc d’évacuer cette anxiété que craignent tant les dirigeants, pour mieux se préparer au pire plutôt que se révolter contre les causes de cette violence. L’objectif est de nous faire intérioriser la menace et de transformer la réalité physique et sociale du désastre en une nécessité à laquelle on ne peut se soustraire, amenant chacun à faire l’impasse sur ce à quoi il est contraint de se soumettre pour tenter de répondre à cette menace.
On se souvient du « On n’en finira pas avec le Covid-19, mais il faut en éradiquer la peur » de Michael Ryan, le directeur des opérations d’urgence de l’OMS, pour qui il faut « apprendre à vivre avec le virus ». Le rapport français de la mission sur la résilience nationale s’inscrit dans la même prophylaxie participationniste, en demandant aux citoyens de cogérer les catastrophes avec des bouts de ficelle et faire en sorte qu’ils se calment : « Votre rapporteur estime qu’il est indispensable qu’en France, les populations soient mises en position d’acteurs plutôt que de consommateurs, comme lorsque nous avons été incités à fabriquer nous-mêmes des masques sanitaires. Cette implication pourra, en retour, réduire le sentiment éprouvé d’anxiété, voire d’angoisse »[6]. Alors qu’elle est un moment indispensable pour prendre conscience des causes qui nous amènent à l’éprouver et qu’elle peut stimuler en nous la colère et la nécessité de bouleverser une organisation qui se nourrit du désastre qu’elle génère, la peur est devenue le symptôme d’une maladie de l’inadaptation, que la résilience est censée soigner. Car la morale de la fable de la résilience est toujours la même : rien ne sert de se fâcher, il faut résilier à point.
Éloge du sacrifice et israélisation du monde
Dans le culte de l’adaptation, l’incantation à la résilience peut aller jusqu’à l’éloge du sacrifice, sous couvert de solidarité, comme l’atteste le rapport parlementaire précité : « Des centaines d’exemples d’héroïsme civil et militaire montrent la résistance collective des peuples face aux épreuves – famines, invasions, exils – qu’ils traversent, illustrant que les membres d’une société humaine peuvent être habités par un sentiment ou des idéaux qui leur paraissent plus élevés que leur propre vie »[7].
On lit encore : « Chez de nombreux jeunes et moins jeunes, l’abondance inhérente à la société de consommation a fait oublier la possibilité du manque matériel ; l’habitude du confort a fait perdre l’aptitude à la rusticité » aboutissant à « une société qui assimile moins le risque et le danger, et perd en résilience face à l’adversité »[8]. Nous serions en quelque sorte des sous-femmes et des sous-hommes appelés à se tenir prêts à rallier héroïquement l’espace canonique de la résilience sans cesse en expansion.
De fait, la militarisation de la société préoccupe visiblement les parlementaires qui préconisent dans le même rapport, notamment la généralisation du service national universel et du port de l’uniforme dans les écoles, ou encore la création d’une « journée nationale de la résilience consacrée à la défense citoyenne et à la protection civile ». Le 13 octobre 2022, la première édition de cette journée a été inaugurée à Rouen, en commémoration de la catastrophe Lubrizol, ambitionnant de nous rendre « tous résilients face aux risques naturels et technologiques ». Invité du forum Normandie pour la paix le 24 septembre 2022, le ministre des Armées Sébastien Lecornu avait déjà livré sans ambage toute la teneur sacrificielle – il s’agit, bien entendu, du sacrifice des autres – de la résiliomanie à laquelle il nous commande de prendre part, soulignant la nécessité d’une « capacité de résilience collective » pour faire face simultanément à « une pandémie, un attentat terroriste et une guerre aux portes de l’Europe, ainsi qu’aux effets du dérèglement climatique », et n’hésitant pas à déclarer en parfait promoteur du survivalisme d’État : « La leçon de l’Ukraine, c’est que c’est un peuple résilient. C’est autre chose qu’une facture de chauffage. Le don qu’ils font, c’est celui de leurs fils »[9].
Décidément, pour les précepteurs de résilience, pour qui on ne souffre jamais en vain, dans ce « monde en guerre » dans lequel nous sommes projetés et auquel il nous faut nous accommoder à tout prix, la quête effrénée de résilience nationale prend les allures d’une rhétorique de nationale-résilience. On est ici au cœur de la dystopie de l’antifragilité, où, face à une société qui s’endurcit avec brutalité, les dirigeants vantent l’endurcissement des individus. Plus concrètement, il s’agit de garantir l’engagement des corps. De fait, la préoccupation centrale actuelle des dirigeants, c’est la crainte d’un déficit de troupes mobilisables dans un conflit éventuel à venir. Le conflit russo-ukrainien rappelle le caractère crucial de la disposition d’une matière première humaine destinée au combat et à la destruction. Le grand plan de natalité annoncé par Emmanuel Macron en janvier 2024 est d’ailleurs censé contribuer à la réponse à cette inquiétude : la notion de « réarmement démographique » renvoie en effet à une vision où les femmes et les hommes sont considérés comme des machines à (se) reproduire, et à fournir de la chair à canon pour les conflits à venir. Car si, selon le Président Macron, « l’ordre va avec le progrès », on ne peut désormais plus nier que le progrès va avec la destruction.
Outre l’Ukraine, parmi les « modèles » de résilocraties mis en avant, on retrouve des régimes démocratiques aussi exemplaires que la Russie avec son prototypique « ministère des situations d’urgence », la Chine « qui met en place un système unique », Singapour, « une démocratie hybride » où « la défense totale est présente dans tous les aspects de la vie des citoyens », ou encore Israël dont la « politique de résilience robuste et opérationnelle » permet de « préparer les esprits et les populations au spectre d’un conflit ouvert, ce qui se traduit dans la réalité par des exercices pratiques »[10]. Sans aucun doute, l’actualité récente nous en fournit un exemple éloquent.
Rappelons qu’alors qu’il passe pour un modèle de résilience, Israël est en réalité l’archétype d’un monde faux : un monde où tout menace, mais où il faut tenir malgré tout, en s’endurcissant à tout prix. Et la résilience et ses sous-produits idéologiques comme le « réarmement civique » invoqué en France par exemple, sont bien, en ce sens, des outils d’israélisation du monde. Car ce que l’on ne dit pas assez, c’est combien les Israéliens sont victimes de la résiliomanie de leurs dirigeants, qui leur demandent d’être endurants et de vivre au quotidien avec le pire. D’apprendre à vivre dans un perpétuel état de catastrophe. De s’endurcir en se mobilisant indéfiniment dans la lutte contre « l’ennemi ». Ce programme est également, désormais, celui auquel les dirigeants français nous enjoignent de nous conformer.
Le « réarmement civique », sous-produit de la résilience nationale
Les dirigeants français entretiennent le fantasme de la création, dans la société toute entière, d’un continuum d’engagement – encore appelé « réarmement » – qui irait de la procréation et la lutte contre l’infertilité, au militaire de carrière, en passant par l’embrigadement des élèves de collège, et qui couvrirait les formes de combat les plus variées, de la tranchée au cyberespace (le ministre des armées affirme avoir besoin de « cybercombattants »). Il faut bien faire rêver la jeunesse… et les appels à la résilience nationale passent aussi par des ordres qui lui sont adressés. C’est une façon de l’enjoindre à ne surtout pas s’autonomiser et à rester dépendante. Voire même à accroître cette dépendance vis-à-vis des puissants, dans les temps de catastrophe.
Plus que la « confirmation d’un virage droitier, aux accents conservateurs », le discours récent sur le « réarmement civique » est une nouvelle contre-offensive étatique face à la montée des aspirations d’une jeunesse qui, pour reprendre la formulation de Jacques Philipponneau, manifeste une détermination croissante « à critiquer l’ensemble du système économico-politique, non seulement au nom de l’évidence d’un péril imminent, mais de plus en plus au nom d’une autre conception de la vie »[11]. De fait, les pouvoirs publics entretiennent une confusion entre les deux champs sémantiques de la résilience, arme d’adaptation massive, et de la résistance parce qu’ils ne veulent surtout pas résister, c’est-à-dire remettre en cause le système techno-capitaliste et industriel qui est à l’origine des catastrophes. À travers cette sidération, qui consiste à nous dire qu’il n’y a pas de quoi être anxieux mais qu’il faut tout de même se préparer au pire à tous les niveaux de la société, l’objectif des gouvernants est de perpétuer l’existant et d’y soumettre les populations. C’est en ce sens que le réarmement civique est un sous-produit idéologique de la doctrine de la résilience nationale élaborée par les dirigeants macronistes. Une phase préparatoire à un réarmement militaire et à une mobilisation nationale de la jeunesse.
L’idée d’un réarmement civique s’inscrit dans la liste des technologies du consentement au désastre et à l’addiction au désastre, dont le triple objectif est de : ne pas s’attaquer aux responsables ; ne pas remettre en cause le système ; éviter la révolte contre ce qui règne, gouverne, et agonise en ce moment. Cette idée de réarmement civique fait partie de la quincaillerie idéologique survivaliste du gouvernement, qui nous empêche de faire notre tentative de représentation de ce qui survient, de faire l’expérience de notre échec, et d’ainsi opposer à l’ogritude en expansion une résistance effective. Une ogritude que l’on euphémise, aussi bien en parlant de « crise climatique » liée au réchauffement, qu’en parlant de « crise humanitaire » à Gaza, pour éviter de parler respectivement d’écocide et de génocide.
Ainsi, quand l’Élysée prétend à la fois répondre à « l’effondrement de la civilité » et à la « fragmentation croissante de la société », on est en droit de se demander ce qu’il en est de l’effondrement de solidarité et d’humanité auquel on assiste à Gaza et ailleurs ? Qu’en est-il encore de la fragmentation de la société que le chef de l’État et d’autres précipitent en interdisant l’expression des solidarités avec les Palestiniens emmurés vivants ?
La résilience au service de l’empire de la production
La dissonance cognitive, cette forme de double pensée, est le leitmotiv de la résiliocratie. Ainsi, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, n’hésite pas à affirmer que « nous devons agir comme si tout dépendait de nous », tout en répétant que « nous devons nous adapter en mesurant que tout ne dépend pas de nous »[12]. Or, prôner simultanément l’atténuation et l’adaptation au changement climatique est une tromperie, car elles ne relèvent ni du même registre cognitif, ni du même type d’action ou du même registre politique. C’est comme si pendant la Seconde Guerre mondiale, on nous avait enjoint à nous adapter à la présence de l’ennemi sur notre sol tout en lui résistant. La résiliocratie consiste à mener une politique d’anti-résistance en cherchant à nous adapter au capitalisme vert et à son cortège de fausses solutions : le nucléaire pour sauver le climat dans un monde tout-électrique, les technologies biosécuritaires pour préserver l’agriculture industrielle de précision, la géo-ingénierie pour réparer la nature. Ce faisant, nous voici précipités vers des voies de non-retour qui aggravent encore la catastrophe.
Considérer que l’opposition entre adaptation et lutte contre les causes est stérile ou dépassée, est un leitmotiv prétendant faire consensus qui permet d’occulter le fait que le choix de la résignation face au désastre a été fait dès la fin des années 1970[13]. On n’est donc pas étonné de voir réapparaître la vieille lune de l’inéluctable adaptation, toute rutilante de résilience. De toute part, il s’agit bien de faire rebondir l’économie sur le trampoline de la lutte climatique, et c’est bien là le cœur des politiques de résilience. Elles sont au service du principe selon lequel il y a toujours une filière à défendre. De la betterave sucrière au nucléaire en passant par l’automobile électrique, l’industrie touristique ou le glyphosate.
Quant aux périodes de transition écologique et énergétique dont nous avons les oreilles rebattues, elles ne sont, pour reprendre la formulation d’Anders, rien d’autre que « ces moments sur lesquels tu passes parce qu’ils passent sur toi. Ce sont donc des périodes pendant lesquelles l’ennemi exerce sa domination »[14].
La résilience est une anti-résistance
Quels sont les processus sur lesquels s’appuient la mise en place de ces politiques de résilience ?
La résilience fait la promesse d’une réparation individuelle et collective qui ne peut être portée que par un appel à la participation de chacun, autrement dit par une cogestion générale du désastre et de ses suites, entretenant ainsi la confusion pour le sujet entre son accomplissement et les nécessités que lui impose sa survie en milieu catastrophique. Rendue subjective, la catastrophe devient une question à régler avec soi-même, un dépassement et une victoire à remporter sur la peur, une responsabilisation et une prise en main autonome de son propre destin. Nous voici face au nouvel avatar de la raison catastrophique qui nous trouve toujours de bonnes raisons de tirer parti du pire, au nom du pire. Fondée sur l’intériorisation de la culpabilité et, ce faisant, de la domination, la cogestion des désastres est une congestion de la liberté et du refus du fait d’en être privé. Privatisation du risque et collectivisation de soi faisant excellent ménage, jamais la nationalisation du peuple n’a été aussi criante.
Un des piliers de l’économie politique du consentement réside dans son régime affectif qui estampille, privilégie et promeut certains registres émotionnels comme étant appropriés et désirables – l’espoir, le bonheur, la responsabilité, l’anticipation, l’aspiration à un avenir meilleur, la solidarité et l’auto-assistance – au détriment d’émotions jugées intempestives – le tempérament fougueux, l’irritation, le ressentiment, la colère, l’inquiétude, l’effroi, le stress et l’affliction. Dans cette ségrégation des émotions, celles censées contribuer au consentement à une vie dans un environnement contaminé seront placées au plus haut dans la hiérarchie, tandis que les émotions jugées négatives, mais pourtant susceptibles d’aider à concevoir et de soutenir un questionnement sur le bien-fondé de l’accommodation, seront classées tout en bas de l’échelle et appréhendées comme des maladies nécessitant d’être soignées.
Comme on l’a évoqué plus haut, affectant de contribuer à mettre les populations à l’abri de leur anxiété, la résilience et ses apôtres réduisent au silence la liberté pour ces dernières d’avoir peur. Or, si l’on reprend ici l’analyse proposée par Günther Anders, cette liberté renvoie à la capacité d’une population donnée d’ « éprouver une peur à la mesure du danger qui pèse sur elle, de ressentir la quantité d’angoisse qu’il faut que nous ressentions si nous voulons vraiment nous libérer du droit d’être libéré de la peur, et avoir peur afin d’être libre »[15]. La peur contribue à la prise de conscience que nous menons une existence dans un monde faux, qui nous enferme dans une vie calculée que l’on passe à qualifier les risques, à évaluer nos chances de survie, à organiser cette survie en optimisant nos comportements et en nous endurcissant pour faire front face au pire. Le monde faux est un monde que le sujet ne peut faire sien, dont il est exclu et où il ne peut se sentir chez lui, sauf sous la contrainte. Il ne s’agit plus alors de liberté, mais de se rendre disponible pour un monde dont on ne peut disposer, mais qui dispose de nous. Un monde dans lequel l’existence est transformée en un processus sans fin de gestion des menaces, où elle est mutilée, car elle est « une vie qui ne vit pas », pour reprendre l’expression d’Adorno, tant elle est soumise à une organisation intégrale fondée sur la technologie et au contrôle permanent d’une rationalité instrumentale. Dans un tel monde où le sujet est structurellement placé sous la menace permanente, la peur lui permet surtout d’opposer son refus d’être l’objet d’un ajustement indéfini au nouvel environnement, et ainsi de pouvoir s’attaquer aux causes réelles de cette menace. La peur est ici salutaire car elle permet la représentation de ce que l’on est en train de faire. Or, en codifiant la peur sous forme de risques, la résilience constitue un outil central dans la fabrication du consentement reposant sur l’apprentissage de la peur de la peur elle-même. Consentir, c’est certes vivre dans l’obéissance, mais en étant soulagé de son poids intrinsèque par des affects de joie.
Libres d’obéir et condamnés à résilier, tel est le mot d’ordre des administrateurs du consentement aux désastres. Il est vrai qu’à force d’obéissance, on peut devenir martyr dans cette société qui a tant besoin de héros et de premiers de cordée. Voici donc clairement énoncées les leçons de résilience de « Fukushima » et d’ailleurs : initier la population à l’attiédissement de son appréhension des menaces qui pèsent sur elle, sur sa santé ou sur son environnement, et lui fournir ainsi les meilleures raisons de s’adapter à sa survie – fut-elle contaminée – et de patiemment et docilement apprendre à se sauver par elle-même. Car la résilience est une anti-résistance.
Se solidariser dans la lutte contre la solidarité avec la production en tant que telle
La résilience est aussi une technologie de consentement à des interdépendances néfastes, dans lesquelles les victimes sont sommées d’agir pour sauver le monde faux qui fait pourtant d’elles des victimes. C’est pourquoi s’opposer à ce qui nous engage dans l’irréversibilité est notre devoir. Selon G. Anders, « il n’y a “progrès” que lorsqu’à chaque pas de l’homme, correspond un pas vers une ré-humanisation possible »[16]. Sinon c’est l’aliénation et l’obscurcissement du décalage entre ce que nous fabriquons et notre capacité à nous le représenter. Le principe est de se dégager de toutes les routes à sens unique qui n’inventent pas en même temps leur possibilité de retour. Mais dans l’économie de guerre à laquelle on nous exhorte de prendre part, l’augmentation de la performance qui est requise est inversement proportionnelle à celle des chances de retour. D’autant plus que cette économie de guerre est désastro-dépendante, puisqu’elle se nourrit de la destruction. Il y a donc nécessité de se dégager de situations où l’humanité est incapable de revenir au point de départ, c’est-à-dire à l’état dans lequel sa pérennité lui est encore garantie.
Or la résilience c’est précisément ce qui nous fait accepter les transformations irréversibles dans lesquelles nous sommes engagés. Le sens que peut alors prendre le commun et son faisceau potentiel d’interdépendances « choisies », est celui consistant à cesser de partager la souffrance, le sacrifice et la condition de survivant, pour commencer à partager la santé, la vie, la liberté (dont celle d’avoir peur), le refus et la fureur, et à résister afin de rendre ce partage effectif. La seule robustesse qui vaille devient ainsi celle de notre capacité de résistance à l’empire de la production. Résistance encore au bonheur palliatif que nous offrent les voleurs de nuages de la climato-ingénierie, bonheur palliatif qu’ils prétendent éternel et indiscutable.
S’il y a une interdépendance à défendre aujourd’hui, c’est celle qui consiste à se solidariser dans la lutte contre la solidarité avec la production en tant que telle – produire pour produire, y compris pour produire des catastrophes, tel est l’impératif – solidarité qui rend obsolètes toutes les autres solidarités. Car aux yeux des producteurs tombés dans l’addiction au désastre, et n’ayant pour toute réponse à lui opposer que celle consistant à nous y précipiter chaque jour un peu plus en nous en rendant citoyennement responsables et cogestionnaires, la catastrophe est elle-même une production avec laquelle la résilience nous commande d’être solidaires. C’est pourquoi à l’économie devenue un sabotage de la vie, va donc probablement, et ce avec une fréquence et une détermination grandissantes, riposter une solidarité se définissant comme un sabotage de la production.
Thierry Ribault
chercheur en sciences sociales
Clersé-CNRS-Université de Lille
- [1] Delaisi de Parseval Geneviève, « Le remue-méninges de la foi selon Boris Cyrulnik », Libération, 1er novembre 2017.
- [2] Propos de Jean-Louis Rouhart dans « Paul Sobol et la résilience. Revivre après Auschwitz », ASBL Mémoire d’Auschwitz, 23 décembre 2016 https://auschwitz.be/images/expertises/2016-rouhart-sobol_resilience.pdf.
- [3] Extraits de l’audition à laquelle l’auteur a pris part le 22 juillet 2021 : https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11094908_60f92e5125b4d.resilience-nationale–table-ronde-reunissant-enseignant-chercheur-et-professeur-22-juillet-2021
- [4] Rapport du 23 février 2022 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/resinat/l15b5119_rapport-information#
- [5] Ibid., p. 95.
- [6] Ibid., p. 97.
- [7] Ibid., pp. 140-142.
- [8] Ibid., pp. 93-94.
- [9] Turcat Alexandra, « Face aux menaces, la sécurité doit devenir “un enjeu collectif” selon le ministre des Armées », Ouest-France, 24 septembre 2022. URL : https://www.ouest-france.fr/normandie-pour-la-paix/face-aux-menaces-la-securite-doit-devenir-un-enjeu-collectif-selon-le-ministre-des-armees-a570728a-3c0d-11ed-aedd-505ee6f85a72
- [10] Mission d’information de la conférence des présidents sur la résilience nationale, 3 novembre 2021, Compte rendu n° 47.
- [11] Lowry Malcolm, Au-dessus du volcan, Paris, Éditions de l’Encyclopédie des nuisances, 2023, p.42.
- [12] « Climat : la France doit se préparer à un réchauffement jusqu’à + 4 °C, enjoignent élus et société civile », Le Monde, 4 mai 2023. URL : https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/05/04/climat-la-france-doit-se-preparer-a-un-rechauffement-jusqu-a-4-c-appellent-elus-et-societe-civile_6172128_3244.html
- [13] Voir notamment Fressoz Jean-Baptiste, L’Apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique, Paris, Seuil, coll. « L’Univers historique », 2012.
- [14] Anders Günther, La catacombe de Molussie, Paris, Éditions de L’échappée, 2021, p.259.
- [15] Anders Günther, L’Obsolescence de l’homme. Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle, Paris, Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances/Éditions Ivrea, 2002, p. 296.
- [16] Günther Anders, Vue de la lune – Réflexions sur les vols spatiaux, Genève, Éditions Héros-Limite, 2022, p.109.