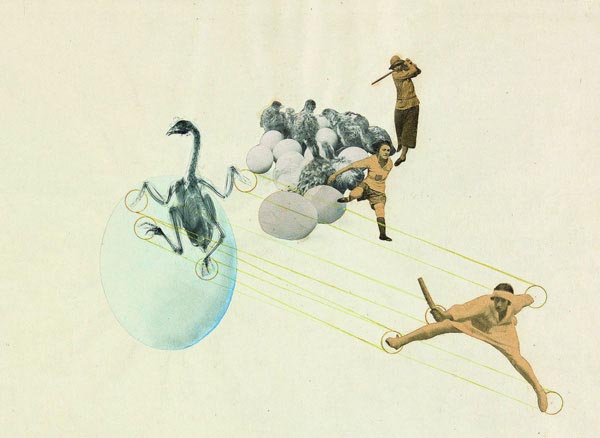Introduction. De la tragédie à la farce et vice-versa
Marx, dans son 18 Brumaire, eut cette célèbre formulation : « Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d’ajouter : la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce »[1]. Obsessivement mobilisée ensuite par différents auteurs et autrices pour exprimer tant bien que mal l’idée d’une décadence active dans le cours de l’Histoire, cette citation a toutefois l’intérêt suivant : elle encourage à identifier et à distinguer, dans chaque événement nouveau, la tragédie initiale et la farce qui la répète inlassablement. Initialement, Marx tentait de décrire cette propension des acteurs de l’Histoire (qu’il s’agisse de dirigeants, de révolutionnaires, de militants, etc.) à se parer systématiquement des attributs de ceux qui les ont précédés, statuant combien « [l]a tradition de toutes les générations mortes pèse d’un poids très lourd sur le cerveau des vivants »[2]. Cette incise de Marx suggère en effet au critique de déplacer son regard sur le caractère tragi-comique de ceux qui prétendent que ce qu’ils font aujourd’hui vaut bien ce que d’autres ont fait avant, dans des circonstances déclarées similaires.
Et même quand ils semblent occupés à se transformer, eux et les choses, à créer quelque chose de tout à fait nouveau, c’est précisément à ces époques de crise révolutionnaire qu’ils évoquent craintivement les esprits du passé, qu’ils leur empruntent leurs noms, leurs mots d’ordre, leurs costumes, pour apparaître sur la nouvelle scène de l’histoire sous ce déguisement respectable et avec ce langage emprunté.[3]
Si bien qu’à chaque fois que sont publiquement proclamées des « situations inédites » et des « états d’exception » qui justifient des « choix tout à fait nouveaux », on se demande s’il y a bien là une réelle tragédie nouvelle, ou si nous ne sommes pas devant la farce inlassablement répétée d’une antique tragédie, dont on ne sait même plus très bien à quelle époque elle put être déclarée « nouvelle ». Ce texte est motivé par le sentiment que nous avons besoin aujourd’hui, face au confinement induit par la pandémie de COVID-19 et à la gravité de cet événement, de trouver des moyens de déplacer notre regard, et de voir ce qui arrive avec la bonne distance, tant se mêlent partout la tragédie et la farce.
Une autre façon de poser la question est de partir du présupposé que, face à l’immensité de l’histoire humaine, les événements et les ruptures historiques sont, par définition, toujours des formes de farces dérivées : il est fort probable que, quoi qu’il arrive, il se soit déjà produit quelque chose de similaire dans le passé, chose avec laquelle nous pouvons comparer notre situation présente. Ce qui devient alors crucial, c’est de mesurer toutes les petites variations qui font de ce qui arrive un événement tout à fait singulier. Autrement dit, il s’agit de voir combien c’est en fait la banalité ou la récurrence d’une situation donnée qui lui rend toute sa gravité historique : plus on peut voir dans un fait qui se présente à nous combien il rappelle de tragédies passées supposées exceptionnelles, plus la farce semble être amère, insensée, grave et, par-là, absolument tragique. En effet, si le passé nous a déjà donné à penser et à vivre des choses similaires, comment se peut-il qu’elles parviennent à se répéter si facilement ? Si bien qu’on ne sait plus très bien, à la fin, si ce n’est pas toujours d’abord comme farce que se présente l’Histoire, pour s’amplifier ensuite en tragédie singulière, nouvelle, irréversible. Ainsi en va-t-il des récents ersatz de mouvements fascistes qui ressemblaient d’abord à une blague de mauvais goût voulant le retour des grandes heures du fascisme du XXème siècle, mais qui – dans leur « éternel retour » – finissent par revêtir le vêtement d’une nouvelle tragédie en devenir, celle d’un redéploiement de l’extrême droite à échelle de plusieurs nations européennes. Et, autant les tentations autoritaires sont présentes dans toute l’histoire de l’humanité, autant elles semblent chaque fois s’aiguiser au voisinage de grandes crises qui impactent la vie de tout le monde, semblant exiger que des solutions radicales soient prises, en dépit des principes qui, en temps normaux, sont censés nous protéger de ces mêmes tentations. Et parmi les craintes que suscitent les événements actuels se trouve bien celle-ci : qu’il ne soit même pas nécessaire d’en passer par l’extrême droite pour que la tentation autoritaire s’actualise davantage dans nos systèmes politiques.
Les vingt premières années du XXIème siècle se sont montrées généreuses en « situations d’exception » et en « inédits » : depuis 2001, on a vécu successivement les émeutes de Gênes, suivies de près par la chute du WTC, la « crise des banlieues » françaises de 2005, celle de l’économie mondiale en 2008 (dite des subprimes), celle des « printemps arabes » de 2011 doublée de l’accident nucléaire de Fukushima au Japon, les multiples attentats terroristes revendiqués par l’État Islamique depuis 2015 et le lot d’états d’urgence qui leur ont fait suite, les différentes « crises migratoires » (afghanes, syriennes, soudanaises, etc.), sans compter les multiples catastrophes naturelles telles que les ouragans Katrina (2005) ou plus récemment les incendies australiens, nous voilà maintenant en proie au dernier avatar des catégories de crise et d’exception : le gel mondial de l’économie et de l’activité humaine par la menace permanente d’une pandémie produite par coronavirus. Cette brève énumération est loin d’être exhaustive. De même – sur ces seules vingt années – nous listons ici des événements au titre d’un seul point commun les rassemblant : d’avoir systématiquement induit, au plus faible, des « choix politiques exceptionnels » et, au plus fort, des « gouvernements temporaires/spéciaux/d’urgence/d’exception/de crise ». Si bien que, en restant dans le ton, à chaque nouvelle tragédie, il est vite devenu difficile de ne pas anticiper le retour systématique de la farce qui, tendanciellement, la contre-effectue systématiquement : un peu comme on dirait « ils vont encore nous faire la blague de « la priorité aujourd’hui, c’est d’affronter cette situation imprévisible et tout-à-fait exceptionnelle », comme ils nous le disent à chaque fois ». Et puisqu’on se le dit à chaque fois, la farce en question devient chaque fois plus grave et plus tragique : elle devient en effet le mode d’expression privilégié de la gestion politique aujourd’hui. Faut-il en conclure que cette façon de gouverner par l’exception est, à terme, la vraie nouveauté proposée par le XXIème siècle ? Qu’il s’agirait, au fond, d’une spécificité du capitalisme tardif qui, poussé par la nécessité, en vient à devoir produire des crises pour justifier ses exceptions ? Rien n’est moins sûr. Notre analyse voudrait tenter dans ce qui suit de penser le concept de crise dans son lien avec des réorganisations du champ politique qui sont, quant à elles, vouées à demeurer et à durer, même quand la crise sera « passée ».
Peut-on prévoir une crise ?
Le Comité Invisible, à l’occasion du texte Merry crisis [4] and happy new fear(2014), nous fournit une excellente occasion d’entrer dans cette réflexion. Précisons qu’il s’agit, de fait, d’une perspective propre à l’orientation politique particulière des auteurs du comité que de lire les événements politiques à la lumière de l’idée d’une mise en crise permanente de la société capitaliste. Le Comité Invisible est un auteur ou un groupe d’auteurs anonymes connu pour avoir publié, aux éditions La Fabrique, une série de livres théoriques sur les politiques de l’insurrection et sur les formes critiques de l’opposition révolutionnaire à la société contemporaine, et plus particulièrement sur la société française. Le groupe, reconnu comme influent dans une certaine tendance de l’ultra gauche autonomiste et anarchiste, entretient des positions relativement critiques quant aux approches plus « traditionnelles » de la problématique révolutionnaire (marxisme, socialisme, etc.) et fonde une partie de ses positions sur l’idée d’une catastrophe globale qui ne serait pas « à venir » mais bien « déjà là », visible dans l’organisation présente du champ politique, social et économique. Il n’empêche que, parmi les propositions théoriques fournies dans le livre À nos amis (2014), se trouve une piste à notre avis pertinente pour interroger notre présent le plus immédiat. Le Comité allait en effet plus loin dans cette interrogation :
Les époques sont orgueilleuses. Chacune se veut unique. L’orgueil de la nôtre est de réaliser la collision historique d’une crise écologique planétaire, d’une crise politique généralisée des démocraties et d’une inexorable crise énergétique, le tout couronné d’une crise économique mondiale rampante, mais « sans équivalent depuis un siècle ». Et cela flatte, et cela aiguise, notre jouissance de vivre dans une époque à nulle autre pareille. Il suffit d’ouvrir les journaux des années 1970, de lire le rapport du Club de Rome sur Les limites de la croissance de 1972, l’article du cybernéticien Gregory Bateson sur « Les racines de la crise écologique » de mars 1970 ou La crise de la démocratie publié en 1975 par la Commission Trilatérale, pour constater que nous vivons sous l’astre obscur de la crise intégrale au moins depuis le début des années 1970.[5]
Bien entendu, la question chaque fois sous-jacente est bien celle de décider si, oui ou non, il put en aller autrement, dès lors que ces événements puissamment capables de mettre en crise des systèmes politiques, sociaux et écologiques aussi complexes ne dépendent a priori pas de nous et que, de fait, ils arrivent.
La question de se préparer à ce qui (pourrait) arrive(r) est aujourd’hui omniprésente, et – au fond – elle l’a été de tous temps. Pensons par exemple à l’organisme gouvernemental américain qu’est le Center for Disease Control[6](CDC), qui travaille activement et fournit depuis de nombreuses années des données visant à maximiser la « prévention » des risques que représentent les pandémies, les urgences chimiques, le bioterrorisme, et d’autres choses du même ordre. En 2011, le centre faisait campagne sur un singulier « état d’alerte préventive » visant à pouvoir faire face à une « Zombie apocalypse », statuant que nous serions heureux d’y être préparés si cela devait arriver et que « peut-être nous apprendrions même une chose ou l’autre sur comment se préparer pour une réelle urgence »[7]. En d’autres termes, l’idée défendue était que la population doit toujours se tenir prête à parer à toutes les éventualités, qu’il s’agisse d’une pandémie, d’une panne généralisée ou d’une insurrection, et qu’en ce sens, si elle est prête pour une invasion de zombies, elle est prête pour tous les autres risques. La préparation des nations pour affronter les événements que défend le CDC est donc celle de dire, comme le souligne le Comité Invisible, que « tout est bon pour faire en sorte que la population se tienne prête à se défendre, c’est-à-dire à défendre le système. Entretenir un effroi sans fin pour prévenir une fin effroyable »[8]. Par ailleurs, le site du CDC expose une quantité innombrable de recommandations pour anticiper les pires cas de figure et, cela va de soi, la littérature sur les pandémies y est pléthorique, depuis de nombreuses années. Le point clé de la démarche étant, comme nous pouvons l’imaginer, d’informer continuellement les gouvernements sur les risques que court le monde et de les analyser méthodiquement. Peut-on en conclure que nos gouvernements étaient, au fond, tout à fait prévenus et prêts à affronter une crise telle que celle que nous imposent aujourd’hui le COVID-19 et son florilège de morts et de malades ? Encore une fois, rien n’est moins sûr.
Pour répondre adéquatement à cette question, il conviendrait de distinguer celle de l’information préventive de celle de la préparation préventive. Parce qu’en effet tout montre que, dans le cas de la pandémie due au coronavirus, l’information sur la crise pandémique à venir ne manquait pas ou, du moins, qu’elle était disponible pour certaines personnes politiquement en charge de ces problématiques. L’expression emblématique de cela est illustrée par la « confession » d’Agnès Buzyn (à cette époque encore ministre des Solidarités et de la Santé du gouvernement français) au journal Le Monde, dans un entretien publié le 17 mars 2020[9]. Elle y détaille ses remords, dont celui d’avoir su, dès le mois de décembre 2019, que les élections municipales n’allaient pas pouvoir avoir lieu, et que l’épidémie chinoise n’allait pas tarder à devenir mondiale :
Je pense que j’ai vu la première ce qui se passait en Chine : le 20 décembre, un blog anglophone détaillait des pneumopathies étranges. J’ai alerté le directeur général de la santé. Le 11 janvier, j’ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j’ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein.[10]
Il reste difficile d’analyser précisément la portée d’une telle déclaration, tant elle remet en perspective la nature des choix et des réactions de l’État français face au virus et à sa menace. Bien plus, elle interroge indirectement l’agenda des réactions de l’ensemble des États européens face à la crise à venir tant on peut supposer que si Buzyn disposait de l’information en décembre, elle ne devait pas être la seule. Les protocoles du CDC montrent par ailleurs que les outils qui permettent d’anticiper ce type d’événement existent et s’activent même dans des temps réguliers, quitte à postuler des menaces aussi absurdes qu’une invasion potentielle de zombies. L’analyse est difficile parce que différents motifs peuvent expliquer que, nonobstant les informations disponibles, la réaction fut reportée jusqu’à l’extrême limite, sinon jusqu’au moment où il était déjà trop tard pour agir correctement : il peut s’agir d’incrédulité, de peur d’une réaction paniquée des populations, de lenteur du système à l’adaptation, de conflits des agendas politiques, économiques et sanitaires, de contradiction des actions à prendre avec les intérêts perçus comme prioritaires par les décideurs et décideuses en charge, de l’incompétence manifeste de ces derniers, etc.
Cela nous encourage, en revanche, à nous interroger sur la fonction objective de cet intervalle temporel très singulier entre la connaissance d’une crise à venir et son occurrence effective. Notre hypothèse est que ce décalage transforme inévitablement la crise à venir en une urgence sur la base de laquelle certains types de réaction gagnent leur légitimité. Cette transformation de la crise en urgence est bien illustrée par la dernière Adresse au peuple français d’Emmanuel Macron :
Alors, étions-nous préparés à cette crise ? À l’évidence, pas assez mais nous avons fait face en France comme partout ailleurs. Nous avons donc dû parer à l’urgence, prendre des décisions difficiles à partir d’informations partielles, souvent changeantes, nous adapter sans cesse, car ce virus était inconnu et il porte encore aujourd’hui beaucoup de mystères.[11]
Peut-on faire l’hypothèse que le politique a tendance à transformer toute crise à venir en un kairos, soit le « moment à saisir », l’instant de la bonne opportunité, le juste moment où agir ? En d’autres termes, peut-on penser qu’il y avait, dans la crise à venir de la pandémie, une opportunité politique ? Ou, de façon plus évidente, qu’il est nécessaire – à cause d’une logique propre à la politique pensée davantage comme exercice du pouvoir d’État que comme gestion du bien commun – qu’une crise devienne une urgence pour qu’il soit enfin opportun de la prendre en charge ? L’idée fait peur, mais la perspective de Marx nous rappelle qu’une farce n’est jamais bien loin de la tragédie. Il est d’ailleurs certainement trop tôt pour affirmer avec certitude ou de façon péremptoire de quelle opportunité le COVID-19 fut le nom. De plus, les analyses et les hypothèses sur les raisons qui motivent les réactions fortement autoritaires des États face à la pandémie ne manquent pas : nous voudrions ici envisager le problème à partir d’un autre point de vue en nous concentrant directement sur ce qui lie un système en crise avec la tentation autoritaire.
La « dictature » et ses fonctions
Si la situation politique française peut nous éclairer sur les modalités et les temporalités des réactions politiques aux crises qui surviennent, des éléments de la situation belge pourraient bien, quant à eux, nous fournir un éclairage différent sur les effets de l’urgence sanitaire en période de crise politique. En Belgique, à l’arrivée de la pandémie, la crise politique était déjà omniprésente et l’absence d’accord sur une majorité politique fédérale durait, au début du confinement, depuis déjà plusieurs mois. Condamnant le pays à fonctionner sur base d’un « gouvernement en affaires courantes », lui-même pur résidu de l’échec de la précédente majorité démissionnaire, cette faillite de la démocratie belge a pu, pour une part, exacerber son incapacité à affronter adéquatement la pandémie. Il n’empêche que la menace imposée par le coronavirus a, du coup, produit la mise en place d’un gouvernement fédéral disposant des pouvoirs spéciaux, comme cela avait par ailleurs déjà eu lieu en 2009 lors de l’épidémie de grippe A/H1N1[12]. Ces pouvoirs spéciaux confèrent au gouvernement le pouvoir de rédiger des « arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux » ayant le statut d’une loi votée au parlement, mais sans avoir à passer par le vote effectif de ce dernier. En peu de mots, à l’issue d’une validation démocratique opérée par la presque totalité des forces politiques en présence au parlement[13], ils confèrent au pouvoir exécutif le pouvoir exercé normalement par le législatif, et ce pour une durée de trois mois, prolongeable jusqu’à six mois d’exercice. Plus particulièrement, les pouvoirs spéciaux – bien qu’exceptionnels par nature – sont une modalité « régulière » de gouvernement qui, surtout pour des situations aussi graves que celle imposée par le COVID19, se présente comme un dispositif pensé pour maintenir l’État de droit malgré l’urgence qui impose des mesures exceptionnelles : comme l’on peut le lire dans la proposition de loi de mars 2020, « l’urgence de disposer d’un cadre légal adéquat est telle qu’il s’avère impossible d’attendre l’adoption de l’ensemble des lois nécessaires par le Parlement, raison pour laquelle il est proposé d’habiliter le Roi à prendre les mesures adéquates »[14].
À ce titre, certaines matières sont exclues de ce pouvoir législatif spécial, malgré une marge de manœuvre importante et étendue supposée lui permettre d’affronter au mieux la crise et ses risques : dans le cas du gouvernement Wilmès, les décisions prises sont supposées demeurer strictement à l’intérieur du périmètre de la gestion de la crise du coronavirus. Malgré cette restriction, et comme le souligne le CRISP,
[l]es mesures visées sont nombreuses et variées : elles concernent évidemment la protection de la santé publique, mais aussi notamment le soutien à l’économie et aux ménages touchés par la crise, la protection des travailleurs ou encore le bon fonctionnement de la justice, en ce compris de la justice administrative. On notera par exemple que le Roi [et donc le gouvernement, ndr] est habilité à prendre des mesures pour combattre la propagation ultérieure du coronavirus au sein de la population, y compris sur le plan du maintien de la santé publique et de l’ordre public, ce qui autorise notamment la fermeture des frontières. Il est également habilité à prendre des mesures destinées à garantir la « capacité logistique et d’accueil nécessaire, y compris la sécurité d’approvisionnement ou en prévoir davantage », ce qui vise notamment la possibilité d’effectuer des réquisitions.[15]
Ce champ d’exercice des pouvoirs spéciaux, qualifiés par les mêmes auteurs de « pouvoirs exorbitants »[16], a donc néanmoins les restrictions suivantes (visant à limiter les pouvoirs spéciaux eux-mêmes) :
il est interdit au gouvernement de « porter atteinte au pouvoir d’achat des familles et à la protection sociale existante » ou d’« adapter, abroger, modifier ou remplacer les cotisations de sécurité sociale, les impôts, les taxes et les droits, notamment la base imposable, le tarif et les opérations imposables ». Malgré les critiques formulées par la section de législation du Conseil d’État concernant ces dispositions – qui manquent, selon elle, de précision –, celles-ci sont restées inchangées par rapport au texte de la proposition de loi initiale.[17]
On peut donc comprendre que ce gouvernement d’exception est au centre d’une dialectique très complexe portant sur la nature d’un pouvoir aussi fort : si est tolérée aisément l’idée que des mesures spéciales fortes doivent pouvoir être prises pour contrer l’urgence, il s’exprime aussi dans les mesures limitatives toutes les craintes légitimes que suggèrent la centralisation et l’extension du pouvoir dans une seule instance. En outre, il est prévu que les arrêtés royaux édictés à l’occasion de ces pouvoirs spéciaux soient revotés plus tard, permettant ainsi au parlement d’éventuellement en annuler l’exécution. Cependant, toujours suivant le CRISP, « d’ordinaire, les débats autour de la confirmation d’arrêtés de pouvoirs spéciaux sont assez formels »[18], ce qui signifie qu’ils font très rarement l’objet d’un intérêt et de discussions très importantes : la fragilité démocratique qu’induit le fait qu’il s’agisse ici d’un gouvernement en affaires courantes (ce qui n’assure donc pas aux choix du gouvernement Wilmès une confiance future automatique) est elle-même fortement contrebalancée par l’étendue des représentants politiques ayant voté la « confiance » aux pouvoirs spéciaux.
Ces informations fournies, il nous semble qu’elles nous autorisent à proposer une analogie avec une forme beaucoup plus ancienne de « pouvoir d’exception » dont nous pensons qu’elle éclaire singulièrement ce que nous affrontons aujourd’hui un peu partout dans le monde. Ce type de dispositifs politiques ne peut en effet, à nos yeux, manquer d’évoquer ce qui dans la République romaine antique se nommait, dans un sens bien plus restreint que dans son sens actuel, dictature (ou magistrature dictaroriale). Nous soutenons cette hypothèse dans la continuité des thèses défendues par Maurice Duverger[19]et, après lui, par la juriste Marie-Laure Basilien-Gainche, statuant que
[d]ictature antique et états d’exception répondent à une même définition juridique : une institution extraordinaire légalement établie, dans des situations de périls imminents, attribue provisoirement tous les pouvoirs à un unique magistrat légitime, afin d’assurer la conservation du régime politique en place. Ils partagent une même exceptionnalité qui se conjugue selon trois modes : exceptionnalité des circonstances qui sont regardées comme une menace d’une extrême gravité pour le régime ; exceptionnalité des méthodes qui s’appuient sur une concentration du pouvoir entre les mains du détenteur de l’autorité exécutive ; exceptionnalité des fonctions qui concernent la préservation, voire la restauration du salut public.[20]
Nous ne sommes pas les premiers à penser que la mythologie constituée par les institutions de la Rome antique est essentielle pour comprendre le pouvoir politique contemporain, et les penseurs libéraux de la démocratie au XVIIIème (penseurs dont les conceptions contemporaines de l’État sont fortement tributaires) se référaient eux-mêmes massivement à cette tradition, comme en témoigne tout simplement le Contrat social de Rousseau, un important livre de celui-ci se consacrant à la pensée de cet héritage[21]. Nous ne discuterons pas longuement de toutes les complexités charriées par la magistrature dictatoriale de Rome[22]. Nous nous contenterons d’exposer des traits saillants qui justifient que nous mobilisions, aujourd’hui, ce concept : à nouveau, il nous semble en effet qu’il nous fournit un référent historique important pour penser ce qu’implique un pouvoir exceptionnel.
Outre une similitude dans le critère de la durée limitée dans le temps (généralement 6 mois maximum), les traits distinctifs de la dictature romaine (soit la centralisation temporaire des pouvoirs dans le chef d’un seul magistrat, indépendamment des institutions régulières de la République) sont :
L’exceptionnalité : elle s’impose quand les situations sont extraordinaires et demandent des « méthodes » politiques extraordinaires pour les affronter.
Lorsque la gravité d’une crise est telle que le mode normal de gouvernement s’avère incapable de la juguler, l’impératif de sortir la communauté politique de la crise autorise à développer une modalité inhabituelle de gestion du pouvoir. Cependant, cette singularité même est le soubassement de la légitimité de l’institution. La magistrature déroge à la règle de la collégialité et lui préfère une exception d’unicité, parce qu’une volonté politique claire s’affirme : il s’agit de définir et de diriger une action indispensable avec la célérité nécessaire. Or, la collégialité suppose la discussion, et la discussion induit la lenteur. C’est ainsi que s’impose la reconnaissance d’un magistrat unique.[23]
C’est ainsi que, dès cette République originaire qu’est Rome, on voit s’imposer le lien entre l’idée d’exception et celle du pouvoir d’un seul (ou d’une seule entité).
La légitimité : Bien entendu, l’exigence de rapidité d’intervention doit se justifier d’être à même de conforter le régime de la cité ; elle requiert donc un consentement au moins théorique de tous les membres de celle-ci à se soumettre à une autorité, en tant que celle-ci pourra sauver ce qui les lie politiquement : la préservation de leur liberté et de leur sécurité.
En vue de se prémunir du danger de la destruction définitive de leur liberté, les citoyens envisagent donc la restriction partielle de leur liberté. Les politiques organisent ainsi le recours à un dictateur, à un despote choisi.[24]
De cette façon, les Romains se dotent d’une distinction entre un dictateur, soit un magistrat choisi par les institutions régulières de la République qui pour un temps reçoit le pouvoir d’agir par-delà les normes de fonctionnement de ces mêmes institutions, et un tyran, celui qui « se choisit », tout en se revendiquant de l’acclamation de la masse populaire et de la nécessité de sa personne pour affronter les temps de crise.
Plusieurs constitutions de nations européennes empruntent des traits à la magistrature dictatoriale de Rome, notamment les constitutions françaises post-révolutionnaires (celle du 13 décembre 1799, par exemple) ou les constitutions espagnoles de 1808 et 1812, qui prévoient des dispositifs dictatoriaux, pensés dans la perspective d’une stabilisation des régimes politiques, par-là capables de protéger leur propre constitution politique. Et aujourd’hui encore, les différents « états d’urgence » mobilisables par nos gouvernements sont tributaires par plusieurs aspects d’une conception similaire du pouvoir d’État[25].
Que peut nous dire ce détour par les fondements romains de certains traits de nos constitutions, dont les pouvoirs spéciaux belges que nous mentionnions semblent également emprunter des caractéristiques (sans pour autant s’y assimiler intégralement, ainsi que nous le soulignions en mentionnant l’ensemble des limitations prévues pour encadrer ces pouvoirs) ? Il nous permet de mettre de la distance dans notre appropriation critique des enjeux que portent ces situations auxquelles nous sommes aujourd’hui confronté·e·s en exposant combien, dès les origines, crise et tentation autoritaire doivent politiquement être pensées ensemble. Et d’une certaine façon, il confirme l’hypothèse du Comité Invisible consistant à mettre en exergue le fait que les crises appellent toujours la nécessité de dispositifs visant l’organisation de la défense du système par le peuple et ses dirigeants censés le représenter. Marie-Laure Basilien-Gainche ajoute à ce propos l’élément qui doit retenir notre attention et qui porte sur les « avantages » de ce type de dispositifs.
De l’organisation et de l’utilisation d’une magistrature de type dictatorial, il est en fait attendu de retirer deux avantages : le prestige, dont la référence à l’histoire revêt les mesures présentes ; et la dynamique, que la spécificité de l’instrument fournit aux actions délicates. Les vertus de continuité et d’efficacité, qui sont prêtées à cette magistrature, paraissent de nature à doter d’une légitimité à caractère symbolique les régimes politiques qui cherchent à se construire puis à se maintenir.[26]
L’avantage du prestige renvoie à celui qui nous évoquions en introduction de notre texte : référer une action contemporaine à des choix paradigmatiques des sociétés fondatrices de notre civilisation confère à cette action un poids légitimant et une puissance de mobilisation symbolique importante, alors même que la rhétorique de l’exception voudrait réduire cette action contemporaine à un cas unique ne pouvant être réitéré. Mais le second avantage évoqué est plus intéressant encore, en particulier sur l’effet de continuité qu’imposent les dispositifs de pouvoirs inspirés et/ou hérités de cette magistrature dictatoriale : les pouvoirs d’exception ont pour trait substantiel de participer au maintien durable des institutions qu’ils contribuent à former. Si bien que, ainsi qu’en témoigne l’histoire de la République romaine elle-même, la limitation dans le temps des dictatures s’est toujours vue progressivement instituer des régimes définitifs, l’usage de la dictature se faisant de plus en plus fréquent et de moins en moins exceptionnel, pour finir – à terme – dans l’institution des régimes impériaux de Rome.
Qu’en déduire, très brièvement ? Que s’il y aura certes des éléments des choix politiques qui sont aujourd’hui posés qui seront stoppés en temps voulu, la constitution de ces pouvoirs exceptionnels et les règles qui y correspondent peuvent aussi se stabiliser, devenir régulières, ne pas s’annuler, se maintenir au-delà de la crise qui les justifiait : en d’autres termes, qu’il est légitime de penser qu’elles servent aussi de base et de fondement à des régimes futurs. Nous ne pouvons pas frontalement en déduire qu’ils ont spécifiquement été pensés pour durer, mais nous pouvons anticiper qu’à la tragédie initiale les ayant fondées répond déjà la farce (elle-même tragique) qui s’en déduit logiquement : que le temporaire est tout-à-fait disposé à devenir permanent. À tout le moins, si l’Histoire peut porter des enseignements, elle tend ici à nous dire que « ça s’est déjà vu par le passé » et qu’il y a de sérieuses raisons de douter que « cette fois-ci, ce sera différent ». Et si notre esprit critique rechigne légitimement à nommer « dictature » ces différents régimes spéciaux qui viennent de fleurir sous la pression du coronavirus, nous devons bien admettre qu’ils en ont, pour une part, beaucoup de traits caractéristiques. Et, aurions-nous tort de nous en inquiéter, il nous semble qu’en tant qu’opérateur critique, il nous revient d’encourager tout le monde à s’en interroger, et à choisir les dispositions politiques qui leur reviennent en fonction de leur analyse et de leur orientation propre. Car, si en effet l’évocation de la magistrature dictatoriale romaine ne suffit pas pour conclure quoi que ce soit de la situation présente, nous pensons qu’elle porte en elle un ensemble de questions critiques pertinentes à poser face à la gravité de ce que nous vivons.
Conclusion. Contre l’apocalyptisme
On pourrait espérer qu’à l’avenir, nous aurons tiré les enseignements de ce qui nous arrive, mais ce que nous renseigne l’affaire Buzyn, c’est que, même quand les informations existent, elles ne conjurent pas le fait d’être mis au pied du mur par des événements qui, tout en étant prévisibles, se présentent comme exceptionnels et à traiter par leur urgence. Et dès lors que l’on sait que des événements dramatiques du même genre auront lieu à nouveau, il est plus rationnel de voir que ce qu’ils imposent aujourd’hui appartient bien au registre de la continuité. Que nous prenions, en ce sens, l’exemple de la France ou de la Belgique, qu’a-t-on à craindre d’une telle situation politique ? Dans le même temps où ces pouvoirs d’exception ont un titre et une légitimité (d’ailleurs majoritairement reconnue par la population) à prendre des mesures exceptionnelles pour lutter contre les dangers qu’implique le virus, qu’en sera-t-il des décisions qui portent sur les conséquences de la crise ? En particulier, dès lors que leur contestation sociale est rendue impossible par les conditions imposées par la crise (pas de manifestation, rassemblements réduits, etc.), et dans la mesure où nous pouvons penser qu’elle restera difficile dans un futur relativement long, quelle garantie peut-on avoir sur les mesures exceptionnelles concernant, par exemple, l’extension de la fonction de police et le renforcement de son usage ? Concernant, encore, le droit à la vie privée dans une situation où le traçage numérique devient intégrable au champ de la prévention des maladies et des infections ? Qu’en est-il du droit et de la liberté à se déplacer sans motifs particuliers de justification, dès lors que la fin de la menace sanitaire n’est pas précise ? Quid, enfin, des décisions politiques en matière de choix pour affronter la crise économique : à qui revient l’effort ? Faut-il que les citoyens acceptent une surcharge de travail ? La menace de l’écroulement possible de l’économie de marché doit-elle permettre que soit décidé un nouveau cycle d’austérité ? Qu’en est-il des mesures à prendre quant à la dette des États ? Que penser des choix réalisés en matière de distribution des soutiens financiers aux acteurs du marché (toutes ces matières appartenant de fait aux prérogatives des pouvoirs spéciaux) ? Bien que différentes conditions doivent être respectées pour que ces choix exceptionnels puissent devenir permanents, notre question est : n’y a-t-il pas de sérieuses raisons de s’inquiéter de ce que, parmi toutes ces options temporaires, la menace durable d’un effondrement imminent les rende plus définitives que nécessaire ? Peut-on se permettre de ne pas être extrêmement vigilant quant aux dangers impliqués par de tels dispositifs ? Comme l’a souligné utilement en ce sens la Ligue des droits humains,
si l’écart que nous vivons entre le fonctionnement actuel de nos institutions et la protection de nos droits et libertés est acceptable pour répondre à l’urgence, il faut à tout prix éviter que l’exception ne devienne la règle et qu’il soit ainsi trop facile d’exploiter nos paniques à venir. Si nous voulons que l’État de droit, déjà menacé avant la crise du Covid 19, y survive, il est crucial de réagir en distinguant de manière nette et claire l’urgence de la normalité.[27]
Quelles que soient les dispositions particulières prises en matière de contrôle démocratique des pouvoirs exceptionnels, la mise entre parenthèse de dimensions fondamentales des structures de l’État de droit représente une menace réelle qui nous oblige à nous inquiéter de et à veiller « au respect des droits et libertés et au respect de l’Etat de droit »[28].
La menace apocalyptique de la fin à venir du système est depuis longtemps consubstantielle à l’exercice du pouvoir et à son maintien, sans jamais que l’effectuation de ce pouvoir n’ait produit les changements qu’on pouvait légitimement en attendre. L’illusion de l’événement de rupture absolument singulier hante à ce titre aussi bien une part du marxisme révolutionnaire (et son rêve d’une révolution définitive) que le capitalisme néolibéral qui, dans la menace permanente de l’arrivée des crises futures, trouve les motifs capables d’offrir à son économie des occasions de se réorganiser et de se pérenniser et, par-là, d’organiser dès à présent les façons de gouverner qui lui conviennent.
Rien n’est plus vieux que la fin du monde. La passion apocalyptique n’a cessé d’avoir, depuis la plus haute antiquité, la faveur des impuissants. La nouveauté c’est que nous vivons une époque où l’apocalyptique a été intégralement absorbée par le capital, et mise à son service. L’horizon de la catastrophe est ce à partir de quoi nous sommes présentement gouvernés. Or s’il y a bien une chose vouée à rester inaccomplie, c’est la prophétie apocalyptique, qu’elle soit économique, climatique, terroriste ou nucléaire. Elle n’est énoncée que pour appeler les moyens de la conjurer, c’est-à-dire, le plus souvent, la nécessité du gouvernement. Aucune organisation, ni politique ni religieuse, ne s’est jamais avouée vaincue parce que les faits démentaient ses prophéties. Car le but de la prophétie n’est jamais d’avoir raison sur le futur, mais d’opérer sur le présent : imposer ici et maintenant l’attente, la passivité, la soumission.[29]
Le revers de toute médaille apocalyptique, c’est la promesse d’une paix fantasmée qui lui ferait suite, conduisant, dans la situation qui est la nôtre, les autres comme nous-mêmes à rêver d’un après-confinement qui serait une autre société, peut-être enfin prête à agir et penser différemment. Notre analyse nous conduit à nuancer ces attentes : ce dont il s’agit de se débarrasser, n’est-ce pas d’abord cet « apocalyptisme » latent qui nous fait espérer qu’un jour nos combats politiques et sociaux seront devenus non-nécessaires ? Or, on sait qu’aux premières dictatures romaines allaient nécessairement se succéder de nouveaux autocratismes, de nouvelles reconfigurations du pouvoir arbitraire, et que chaque « dernière » catastrophe n’était jamais que l’ « énième » d’une longue série à venir.
Il n’y aura jamais de paix sur cette terre. Abandonner l’idée de paix est la seule paix véritable. Face à la catastrophe occidentale, la gauche adopte généralement la position de lamentation, de dénonciation et donc d’impuissance qui la rend haïssable aux yeux mêmes de ceux qu’elle prétend défendre. L’état d’exception dans lequel nous vivons n’est pas à dénoncer, il est à retourner contre le pouvoir lui-même.[30]
Le sentiment que nous soyons condamnés à voir se radicaliser sous nos yeux un ordre que, pour notre part, nous dénonçons déjà depuis longtemps ne doit donc pas nous pousser à organiser la paix à venir. Au contraire, ce qui – en fonction des éléments fournis dans notre analyse – nous semble s’apparenter à une nouvelle variation de la dictature doit nous encourager à internaliser l’idée que tous les combats qui étaient déjà les nôtres avant la crise n’en seront que plus importants encore après elle, que la guerre promue par Macron contre un virus doit déjà et devra, encore et davantage, être retournée contre ce qui, partout dans le peuple, y empêche un déploiement de la vie, y empêche la liberté, y susurre l’exigence de contrôle, y produit des abus de pouvoir et de l’inégalité.
La crise présente nous place politiquement, au fond, dans la situation dramatique de Fritz Zorn, cet auteur suisse qui à trente-deux ans affrontait dans le même geste un cancer incurable lui assurant une mort proche et certaine et l’ensemble social et familial qui, selon lui, en était à l’origine. Il luttait donc contre l’inévitable destin qu’impose une maladie mortelle autant que contre ce qui, à son sens, avait rendu inévitable qu’elle lui arrive et lui soit mortelle : son milieu social et la société l’ayant rendu possible. Les dernières lignes de Mars, publié à titre posthume (l’auteur est effectivement mort à trente-deux ans), déclaraient :
Mais pour moi la chose n’est pas réglée et, tant qu’elle ne l’est pas, le Diable est lâché, et j’approuve que Satan soit lâché. Je n’ai pas encore vaincu ce que je combats ; mais je ne suis pas encore vaincu non plus et, ce qui est plus important, je n’ai pas encore capitulé. Je me déclare en état de guerre totale.[31]
Il va de soi que, pour nous aussi, « la chose n’est pas réglée ».
Nicolas MARION
Chargé de recherche à l’ARC asbl
- [1] MARX, K., Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Paris, Flammarion, 2007, p.49
- [2] Ibid., p.50.
- [3] Ibid.
- [4] COMITÉ INVISIBLE, À nos amis, Paris, La Fabrique, 2014, pp.21-41.
- [5] Ibid., p.26.
- [6] Voir en ligne : https://www.cdc.gov/
- [7] Voir https://blogs.cdc.gov/publichealthmatters/2011/05/preparedness-101-zombie-apocalypse/ (consulté le 07/04/2020). (Notre traduction)
- [8] COMITÉ INVISIBLE, À nos amis, Op.Cit, p.27.
- [9] Voir en ligne : https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/17/entre-campagne-municipale-et-crise-du-coronavirus-le-chemin-de-croix-d-agnes-buzyn_6033395_823448.html
- [10] Ibidem.
- [11] Adresse aux français, 13 avril 2020. Transcription officielle de l’Élysée [En ligne] : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/04/13/adresse-aux-francais-13-avril-2020
- [12] Voir MESSOUDI, H., « Gouvernement Wilmès : c’est quoi les pouvoirs spéciaux ? », dans Le Soir [En ligne], 16/03/2020. URL : https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_gouvernement-wilmes-c-est-quoi-les-pouvoirs-speciaux?id=10458611
- [13] Groen, N-VA, Défi, CDH, Écolo, SP.A, PS, Open VLD, MR et CD&V.
- [14] Chambre des représentants, Proposition de loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, n° 1104/1, 21 mars 2020, p.3.
- [15] BOUHON, F., JOUSTEN, A., MINY, X., SLAUTSKY, E., « L’État belge face à la pandémie de COVID-19 : esquisse d’un régime d’exception », dans Courrier hebdomadaire du CRISP, 2020|1, n°2446, p.23.
- [16] Ibid., p.34.
- [17] Ibid., p.24.
- [18] Ibid., p.26.
- [19] Voir DUVERGER, M., De la dictature, Paris, Julliard, 1961.
- [20] BASILIEN-GAINCHE, M-L., État de droit et états d’exception. Une conception de l’État, Paris, Presses Universitaires de France, 2013, p.41.
- [21] Voir le Livre IV dans ROUSSEAU, J-J., Du contrat social, Paris, Flammarion, 2001, pp.143-180.
- [22] Nous renvoyons ici, pour plus d’informations, à BASILIEN-GAINCHE, M-L., État de droit et états d’exception. Une conception de l’État, Op.Cit.
- [23] Ibid., p.49.
- [24] Ibid., pp.51-52.
- [25] Voir PIERRÉ-CAPS, A., « L’État d’exception dans la Rome antique », dans Civitas Europa, vol. 37, no. 2, 2016, pp. 339-349.
- [26] BASILIEN-GAINCHE, M-L., État de droit et états d’exception. Une conception de l’État, Op.Cit., p.46.
- [27] Lettre ouverte publiée en ligne par la LDH le 26 mars 2020, « COVID-19 | Pouvoirs spéciaux : la Ligue des droits humains adresse une lettre aux parlementaires et au gouvernement ». URL : http://www.liguedh.be/covid-19-pouvoirs-speciaux-la-ligue-des-droits-humains-adresse-une-lettre-aux-parlementaires-et-au-gouvernement/
- [28] Ibid.
- [29] COMITÉ INVISIBLE, Op.Cit., p.35.
- [30] Ibid., p.39.
- [31] ZORN, F., Mars, Paris, Gallimard, 1979, p.315.