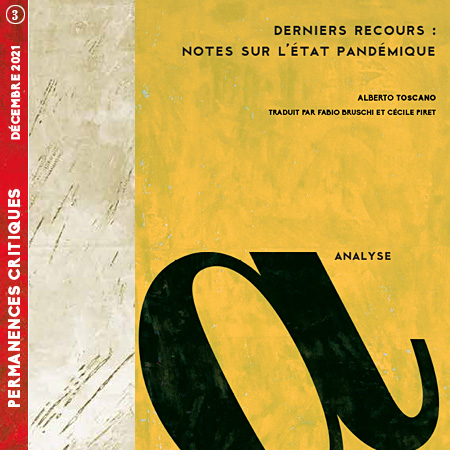D’innombrables commentateurs ont glosé sur les vertus révélatrices de la pandémie en cours qui agit, suivant une métaphore particulièrement heureuse, comme un « élément radioactif injecté dans les veines pour radiographier le flux sanguin »[1]. Si ces derniers mois ont été apocalyptiques, ils l’ont été aussi dans le sens étymologique, biblique d’une découverte de choses non-vues – quand bien même cette découverte aurait souvent concerné ce qui se cachait en pleine vue.
Parmi les dimensions de notre vie matérielle et psychique qui ont été intensément amplifiées par l’urgence prolongée, il y a notre relation à l’État. D’un certain point de vue, c’est très peu surprenant, car la légitimité de l’État moderne s’appuie toujours sur sa capacité (différentielle, exclusive, racialisée, genrée, et parfois létale) d’assurer la reproduction des bases biologiques de la vie politique, une fonction qui a été à plusieurs reprises cristallisée et augmentée par les rencontres historiques avec les pandémies. La légitimité moderne de l’État moderne est en grande partie une légitimité biopolitique et épidémiologique^^ Toscano Alberto, « Par-delà l’État peste », Acta.zone, 25 mai 2020, URL: https://acta.zone/alberto-toscano-par-dela-lÉtat-peste/.. De Cicéron à Hobbes, en passant par un nombre incalculable de documents constitutionnels et régulateurs, on affirme que Salus populi suprema lex esto (le salut du peuple devrait être la loi suprême) – en d’autres termes, l’autorité politique est indissociable de la santé publique. On peut soutenir que cet adage latin est ancré dans notre sens commun lorsqu’il s’agit de justifier la concentration et la centralisation du pouvoir.
Selon les diagnostics les plus sombres de la période actuelle, le SARS-COV-2 est le témoin d’une accélération de nos investissements et complicités avec cette forme biopolitique de légitimité, ainsi que d’une augmentation formidable des pouvoirs étatiques de discipline individuelle et de contrôle dividuel, pour faire allusion à une distinction deleuzienne[2] qui semble largement s’abolir dans le monde technologiquement dense et stratifié des mesures d’(auto-)isolement. Celle-ci serait la « grande transformation » de 2020, dans laquelle les pouvoirs souverains et administratifs auraient saisi l’occasion de l’état d’exception qui imprègne notre atmosphère comme les gouttelettes en suspension dans l’air qu’on craint tant, afin d’initier une mutation globale des paradigmes de notre vie politique – forçant chacun de nous, à travers une « obligation juridico-religieuse » à la santé, à se conformer aux demandes infiniment plastiques et indéniables de la biosécurité[3].
En résonance avec cette vision d’un tournant épochal – dans lequel l’isolement spectaculaire des atomes sociaux dont la seule religion est la santé converge avec un État déterminé à exproprier entièrement tout résidu de capacité d’agir de son simulacre de citoyenneté – on trouve l’idée que la pandémie est le moment de la pleine actualisation des scénarios utopiques propres au pouvoir souverain. Avec un clin d’œil acerbe à la transformation de Macron en Napoléon du Covid, Julien Coupat et ses co-auteurs déclarent :
Nous avons vu le souverain républicain réaliser son rêve de rassembler pour sa messe l’ensemble de ses sujets idéalement séparés devant leur écran entre les quatre murs de leur foyer, et enfin réduits à sa contemplation exclusive. Nous avons vu le Léviathan réalisé[4].
Il vaut la peine de noter qu’Agamben et Coupat écrivent de l’intérieur de régimes d’urgence épidémiologique profondément marqués par des habitudes (et non seulement des raisons) d’État particulières – la tendance de l’État français et italien à militariser l’espace public à chaque occasion, et à imaginer que les mitrailleuses pourraient être une manière appropriée de réguler une réponse de santé publique, jouent sans doute un rôle dans l’orientation de leurs réflexions. Il est difficile de nier une accélération – dans un contexte de conformité rationnelle et en fait même altruiste, sinon sans ambiguïté – de la colonisation de nos mondes de la vie par les manœuvres conjointes de l’État sécuritaire et du capitalisme de surveillance (le « coronopticon »[5]). Une dose de sobriété s’impose toutefois lorsqu’il s’agit de jauger les menaces mais aussi les potentiels impliqués par ce « retour de l’État ». Dans un texte à propos de la pandémie, fustigeant une certaine obsession de la gauche française avec la figure malveillante de Macron, Alain Badiou a souligné que :
Face à une épidémie, ce genre de réflexe étatique est inévitable. C’est pourquoi, contrairement à ce qui se dit, les déclarations de Macron ou de Philippe concernant l’État redevenu soudain « providence », une dépense de soutien aux gens hors travail, ou aux indépendants dont on ferme la boutique, engageant des milliards d’argent de l’État, l’annonce même de « nationalisations » : tout cela n’a rien d’étonnant ni de paradoxal. Et il s’ensuit que la métaphore de Macron, « nous sommes en guerre », est correcte : guerre ou épidémie, l’État est contraint, outrepassant parfois le jeu normal de sa nature de classe, de mettre en œuvre des pratiques à la fois plus autoritaires et à destination plus globale, pour éviter une catastrophe stratégique. (…) Toutes ces rhétoriques sont une conséquence tout à fait logique de la situation, dont le but est de juguler l’épidémie – de gagner la guerre, pour reprendre la métaphore de Macron – le plus sûrement possible, tout en restant dans l’ordre social établi. Ce n’est nullement une comédie, c’est une nécessité imposée par la diffusion d’un processus mortel qui croise la nature (d’où le rôle éminent des scientifiques dans cette affaire) et l’ordre social (d’où l’intervention autoritaire, et elle ne peut être autre chose, de l’État)[6].
On peut aussi ajouter l’important correctif apporté par Marco D’Eramo au cadrage métaphysique des pouvoirs d’exception dans une philosophie de l’histoire unilinéaire proposé par Agamben, à savoir que « tous les états d’exception ne se ressemblent pas », ne fût-ce que parce que, contre Agamben (comme on le verra plus bas), « la domination n’est pas unidimensionnelle. Ce n’est pas juste du contrôle et de la surveillance ; c’est aussi de l’exploitation et de l’extraction ». S’en rendre compte signifie aussi être sensible aux manières à travers lesquelles la pandémie, loin de fonctionner comme une crise heureuse permettant d’adopter une ultérieure monopolisation du (bio)pouvoir, « a pris les classes dominantes au dépourvu », notamment dans la mesure où « elles n’ont pas encore cerné la récession qui nous attend et sa capacité de bouleverser les orthodoxies économiques »[7]. Cela se manifeste aussi dans ce qu’on pourrait appeler la phase dépressive du désir de l’État, le moment où se révèle « la passion triste d’être bien gouverné comme devant être toujours déçue »[8].
Je voudrais explorer brièvement ce réflexe étatiste, dans ses dimensions politiques, économiques mais aussi idéologiques. Contrairement aux interprétations selon lesquelles le moment actuel serait celui de l’affirmation déchaînée d’un biopouvoir invasif sous couvert de santé publique, le rôle de l’État dans notre conjoncture – ainsi que la manière dont il est perçu, repoussé ou invoqué – est marqué par des ambivalences profondes ; on pourrait même dire des contradictions. De nombreux commentateurs ont noté, par exemple, le chiasme idéologique curieux par lequel les porteurs de certaines des tendances autoritaires parmi les plus préoccupantes du présent (Trump, Bolsonaro et leurs coteries) ont été les moins intéressés à transformer une urgence de santé publique en une occasion pour militariser la vie publique, alors que beaucoup de gauchistes et libéraux ont réclamé un plus grand usage des ressources répressives et juridiques de l’État pour assurer le bien-être collectif.
Ceci n’a rien de mystérieux – après tout, les réflexes fascistes contemporains sont enchevêtrés aux instincts les plus anti-démocratiques du néolibéralisme, son darwinisme social (les fascismes de la liberté font fureur), alors que l’expérience et l’idée de l’État-providence demeure un horizon résiduel de la plupart des politiques progressistes. Cela indique toutefois l’intersection de (pour le moins) deux contradictions – à savoir, d’un côté, celle entre le désir de l’État et la (souvent fort justifiée) crainte de l’État et, d’un autre côté, celle entre la primauté (momentanée) de l’État et la primauté (structurante) de l’économique. Avant de prendre en considération ces antinomies, il vaut la peine de mentionner une dimension souvent négligée des contradictions pratiques auxquelles le pouvoir étatique a dû faire face dans la conjoncture de la Covid. Nonobstant ce qui est apparu au début comme une centralisation et une nationalisation de la crise de santé publique, qui contredisait les perspectives d’une gouvernance impériale coordonnée (que certains aurait pu croire revenir, contre les tentations néo-populistes et souverainistes, face à une pandémie globale), la route du virus à travers le système de circulation du corps politique a de plus en plus révélé les lignes de faille internes à l’État-nation.
La légitimité biopolitique s’est révélée profondément controversée à travers différents niveaux de pouvoir administratif et coercitif, et a été monopolisée par le centre exécutif seulement de manière apparente et passagère, et ceci pas seulement dans les États fédéraux. Bourgmestres, gouverneurs, autorités de santé locales, corps d’expertise épidémiologique alternatifs, ou même bandes et milices (comme dans le cas très médiatisé des favelas brésiliennes[9]) ont rivalisé pour le contrôle de la gestion de la réponse de santé publique – quelque chose qui est en conformité avec l’importance pour toute réponse épidémiologique des connaissances et instances locales, de base et communales[10]. En dépit de la pompe et de la parodie du pouvoir souverain, aucun monarque médical n’a surgi. Dans le meilleur des cas, on a assisté à des performances locales et provisoirement persuasives d’une autorité imprégnée de prétentions prudentes d’expertise scientifique (à l’inverse des affirmations grandiloquentes d’Agamben à propos de la « religion » actuelle de l’expertise scientifique et des hérésies qui l’accompagnent, l’autorité des experts de santé publique semble beaucoup trop entourée de précaution et de probabilisme pour être considérée comme une foi).
Alors que quelques États (généralement riches) et leurs leaders ont réussi – à travers un habile exercice d’équilibriste entre les impératifs du soin et du contrôle – à accumuler pour un temps du capital politique sur base de leur gestion de la pandémie, les disputes sur la juridiction[11], l’autorité et l’expertise superposées à l’évidement prolongé de l’investissement de la représentation politique, laissent penser à des visions plus acéphales du Léviathan. Comme Massimo De Carolis l’a judicieusement observé :
Dans aucun cas, une conspiration, un Spectre, ou une personnification plus ou moins cachée du Pouvoir ne dissipera notre doute. Les phénomènes sociaux n’ont pas de metteur en scène, mais sont le résultat d’un nombre indéterminé de forces et impulsions. Il n’y a pas de marionnettiste, mais seulement des marionnettes qui poussent le théâtre, chacune à sa manière, avec plus ou moins de force, dans une direction ou l’autre, souvent malgré leurs intentions conscientes[12].
Si la conjoncture actuelle d’une urgence politique planétaire ne dénote pas simplement un changement de phase monolithique dans la monopolisation (et donc dans l’expropriation ou l’aliénation) du pouvoir social, y a-t-il une meilleure manière pour fonder et comprendre le caractère antinomique à la fois de l’action des États face à la pandémie et de la perception que nous en avons ? Anselm Jappe et ses co-auteurs ont proposé un cadrage fructueux de cette question, qui peut contribuer à élucider notre situation, ainsi que les limites des réponses théoriques existantes. Le point de départ est assez limpide : en reprenant une critique marxienne de l’économie politique, De Virus Illustribus soutient que le principe d’un « retour de l’État » – qu’on l’associe à l’horreur anti-autoritariste ou à l’espoir du retour de l’État-providence – est bien trop souvent basé sur l’idée fallacieuse selon laquelle l’État serait de quelque manière « extérieur » à l’économie et à ses régimes de valorisation. L’antinomie ou oscillation qui caractérise notre conjoncture pandémique – désir de l’État et haine du gouvernement, monopolisation et désistement, etc. – est inscrite dans la structure même de la société capitaliste.
Comme l’écrivent Jappe et al., glosant l’analyse de Kurz de « l’hostilité complémentaire » entre l’État et le marché-production :
En réalité il existe une relation polaire entre la sphère économique et une sphère politico-étatique qui n’est que le subsystème fonctionnel. Le capitalisme ce n’est pas seulement le marché, c’est l’État et le marché-production (ainsi que d’autres sphères dérivées). (…) Les États sont beaucoup plus immergés dans le monde du capital que ne le laisse entendre la vision fétichiste de simple instrument. (…) D’un côté, l’État n’a rien d’un agir de la société sur elle-même autodéterminé à partir de ses bases propres, car ses conditions d’existence et ses capacités sociales dépendent totalement de la saignée sous la forme des impôts qu’il opère sur la sphère économique. (…) De l’autre côté, les États dans leur genèse historique et leur logique de fonctionnement se constituent dans le rôle de « capitaliste collectif idéel ». (…) C’est-à-dire que les États prennent en charge les conditions d’ensemble de reproduction des sociétés capitalistes que la logique concurrentielle de la sphère de l’économie d’entreprise ne peut pas, par sa logique propre, endosser[13].
C’est sur cette base que notre antinomie pandémique est perçue non pas comme l’État récupérant l’espace qu’il avait abandonné au marché mais comme une affaire immanente à une contradiction structurelle, ou mieux une polarité interne, de la société capitaliste.
Plutôt que l’enchâssement de l’économie dans la société par l’État – pour emprunter un jargon polanyen –, nous constatons que « la société capitaliste s’est auto-saisie étatico-politiquement pour se survivre »[14]. Ce qui est unique dans cette crise est que, plutôt que de la considérer comme émergeant de manière endogène de la sphère première et déterminante du marché-production, nous sommes confrontés à une crise économique planétaire qui est politique et étatique par nature. Dans ce contexte de crise, à la fois pour renforcer leur propre légitimité biopolitique résiduelle et pour assurer, après une douloureuse parenthèse, la reprise de l’accumulation, les États ont été contraints de plonger le processus de valorisation dans un coma artificiel – souvent en convergence, quoique de manière contradictoire, avec une certaine résurgence de discours néo-populistes sur la souveraineté nationale productiviste (y compris avec des slogans surréalistes, comme la « nationalisation des salaires » de Macron)[15].
Mais le caractère unique de cette crise est aussi déterminé, en ce sens, par la manière dont elle hérite du legs néfaste des crises financières et du crédit qui se sont succédées à un rythme soutenu à partir des années 1990. Pour Jappe et ses co-auteurs, nous sommes au milieu d’une nouvelle vague d’endettement planétaire massif, marquée – comme une sorte d’héritage de la crise de 2008 – par le rôle écrasant de l’État et des banques centrales pour assurer la production du capital fictif qui complète le déclin séculaire de la productivité du capital. De Virus Illustribus repose donc une grande partie de son analyse critique de la montée du « primat du politique » à travers la pandémie sur son diagnostic du rôle de plus en plus pathologique (du point de vue de la reproductibilité du capital et de sa vulnérabilité aux crises) de l’État dans le processus de valorisation. Si le néolibéralisme, au sens large, dépendait de la substitution du secteur financier comme moteur économique en raison de la stagnation chronique dans le domaine de la production de marchandises, nous sommes en train d’assister à des États qui sont obligés de se substituer au secteur financier lui-même. Après 2008, et de façon exponentielle depuis le contexte du nouveau coronavirus :
Les États et les Banques centrales des pays du centre du capitalisme perdent (…) leur fonction de simple appui au secteur privé dans le cadre de la multiplication du capital fictif, pour endosser définitivement une fonction de substitution à l’industrie financière, et ce afin de renouveler des montagnes de titres de propriétés arrivés à terme et d’assouvir la contrainte interne à l’expansion du capital fictif sur lequel repose l’ensemble du régime d’accumulation contemporain[16].
Avec la Fed américaine, par exemple, qui achète à prix réduit de larges quantités de dettes d’entreprise, nous passons « de l’étatisation partielle de l’avenir capitaliste déjà consumé, à une socialisation du grand procès de crise »[17]. Par conséquent, nous sommes de plus en plus confrontés à une « méga bulle d’État » qui repose en définitive sur l’idée que l’État peut virtuellement s’appuyer sur la promesse d’une croissance économique future. Jappe et al. citent une phrase de la prix Nobel d’économie Esther Duflo, qui parle des dépenses des États durant la crise de la pandémie en termes de milliards qui « viennent du futur »[18] – un exemple frappant de ce fétichisme du temps qui est devenu la seconde nature de la pensée et de la pratique capitalistes. Ils observent que ce qui est en train d’être consumé ici est en réalité un futur sans lendemain, au vu des limites internes et externes (écologiques) du capital.
Si je ne peux pas et n’ai pas l’intention de rendre justice à la théorie de la crise qui structure cette analyse de la « primauté du politique » contemporaine et ses antinomies, je pense que, même dans ses grandes lignes, elle fournit une contribution importante au débat hésitant sur la place de l’État dans la pandémie. Cela nous permet surtout de relier les conflits idéologiques et les attachements passionnés concernant la crainte ou le désir d’un « retour de l’État » aux dynamiques systémiques qui ont transformé l’État en espoir en dernier ressort du capitalisme[19]. Mais que devons-nous penser du fait qu’il peut aussi être un espoir en dernier ressort de l’anti-capitalisme ?
De Virus Illustribus, vraisemblablement en raison de son attention à la reproduction sociale, n’ignore pas les bases matérielles de notre désir de l’État (ou en fait du capital) : le fait que l’économie n’est pas juste une question de profit mais une condition de notre propre reproduction biologique, à présent, en grande partie, dépendante des circuits de la valeur. Les auteurs parlent de manière éloquente du « sentiment ambigu de voir prendre feu la prison où l’on est enfermé, sans savoir si les portes vont s’ouvrir »[20]. Mais, comme souvent dans la théorie critique de la valeur dont héritent Jappe et al., le démantèlement des fétiches politiques immanents à la reproduction du capital laisse les questions de stratégie, au sens large, frappées par une sorte d’interdiction d’image – avec pour seul horizon presque évanescent l’abolition du « sujet automatique » du capital. Si la valeur ne peut être abolie à moitié, comme le soutiennent de nombreux critiques de la valeur, on en vient à soupçonner qu’elle ne pourrait être abolie du tout.
C’est un exercice intéressant sous l’angle d’une lecture marxiste, donc, de confronter De Virus Illustribus avec le plaidoyer d’Andreas Malm en faveur de l’État comme « espoir en dernier ressort » pour l’humanité et l’écologie dans son remarquable La chauve-souris et le capital. Stratégie pour l’urgence chronique. Le livre de Malm est la meilleure synthèse dont nous disposons sur le lien entre la catastrophe climatique continue, la pandémie de Covid en cours, et leur étiologie capitaliste. Je ne vais pas développer ici les connexions entre la pandémie de Covid et le Capitalocène, ou les observations avisées de Malm sur les dissimilarités et les asynchronies entre le changement climatique et la pandémie de coronavirus en tant que phénomènes naturels et sociaux. La provocation éco-léniniste d’un « communisme de guerre » comme le nom de notre politique de l’urgence n’est pas non plus mon sujet de préoccupation[21].
Je voudrais plutôt simplement aborder l’affirmation anti-anarchiste de Malm que c’est vers l’État capitaliste que nous devons nous tourner pour notre confronter à notre urgence chronique. S’agit-il, comme le voudrait la perspective de la critique de la valeur, d’une autre instanciation de l’instrumentalisme comme autre variante de la pensée fétichiste ? J’aurais tendance à répondre par la négative ; ou, plutôt, à voir dans la réutilisation écologique du léninisme de Malm ce que nous pourrions appeler un instrumentalisme tragique. C’est tragique, à mon avis, comme n’importe quelle réflexion sérieuse sur la transition, et davantage encore en considérant la temporalité funeste de la catastrophe climatique. Et sa tragédie est une fonction de son réalisme concernant l’inévitabilité de la coercion dans le domaine politique. Dans les termes de Malm :
Au vu de ces dernières décennies de transition au point mort, rien n’indique qu’ExxonMobil voudra bien se métamorphoser en nettoyeur et en magasinier de carbone invendable, ou que l’industrie de la viande ou celle de l’huile de palme laisseront volontiers leurs pâturages et leurs plantations se faire réensauvager. Il semble tautologiquement vrai qu’une transition réelle nécessitera une forme d’autorité coercitive. Si les anarchistes exercent un jour une influence dans ce processus, ils découvriront vite cette circonstance et, comme tout le monde, devront utiliser l’État[22].
Mais les déterminants temporels du réchauffement de notre planète, la façon dont, pour citer le livre précédent de Malm, « nous ne pouvons jamais être dans le feu du moment, seulement dans le feu du passé en cours » du capital fossile, signifient que le léninisme classique, comme l’anarchie, doivent être abandonnés – un État révolutionnaire, un État-commune ou un État-non-État n’est pas un mot d’ordre pertinent aujourd’hui. À la question de savoir de quel État un léninisme écologique a alors besoin, Malm répond avec cette réflexion :
Nous venons d’affirmer que l’État capitaliste était incapable par nature de prendre ces mesures. Et pourtant il n’y a pas d’autre forme d’État disponible. Aucun État ouvrier fondé sur des soviets ne naîtra miraculeusement en une nuit. Aucun double pouvoir des organes démocratiques du prolétariat ne semble près de se matérialiser de sitôt, ni un jour. Attendre une autre forme d’État serait aussi délirant que criminel et il nous faudra donc tous faire avec le lugubre État bourgeois, attelé comme toujours aux circuits du capital. Il faudra qu’une pression populaire s’exerce sur lui, changeant les rapports de force qu’il condense, contraignant les appareils à rompre l’attelage et à commencer à bouger, en employant toutes les méthodes déjà rapidement évoquées (…). Mais cela reviendra clairement à abandonner le programme classique consistant à démolir l’État pour en construire un autre – un aspect du léninisme parmi d’autres qui semblent bien mériter aussi une nécrologie[23].
Je suis largement sensible à la veine marxienne du réalisme tragique que Malm a insufflé à l’urgence écologique. C’est aussi évident dans son affirmation que, comme l’expérience bolchévique elle-même le suggère, il n’y a jamais aucune « rupture propre » avec l’ancien régime, ainsi que dans sa reconnaissance des potentiels effets boomerang des politiques d’urgence, quelle que soit leur visée émancipatrice – dans sa proposition d’« habiter le dilemme, pour paraphraser Donna Haraway : le dilemme que pose l’application de mesures de contrôle en situation d’urgence sans bafouer les droits démocratiques, en s’efforçant plutôt de les garantir, de s’appuyer sur eux et d’en tirer une force »[24]. Pourtant, à la lumière du diagnostic de Jappe et al. sur l’hostilité complémentaire de l’État et du capital, nous pouvons encore nous demander à quel point pourrait être réaliste le réalisme concernant l’État capitaliste comme espoir en dernier ressort.
Alors que l’horizon actuel du coma artificiel du capital induit par l’État est bel et bien la guérison du patient (avec toutes les contradictions pratiques sur les formes de mitigation ou encore les fantasmes récurrents d’une immunité collective), un État capitaliste forcé par la pression des masses à sortir du capital fossile avec la hâte requise se verrait certainement bientôt contraint de sortir du capital tout court. Tant que la politique économique d’un État est telle qu’elle repose sur la vitalité future du capital pour ses propres revenus et ressources, et donc pour son propre pouvoir, n’importe quelle menace (perçue) concernant ce futur a toutes les chances de se transformer immédiatement en une chute rapide de la puissance matérielle et par conséquent de la légitimité de cet État.
Malm a entièrement raison lorsqu’il soutient qu’au niveau de la vie quotidienne ou encore des valeurs d’usage, une transition radicale pour sortir du capital fossile est bien moins drastique que les privations auxquelles des milliards de personnes se sont largement soumises depuis des mois. Mais ces dernières mesures peuvent être traduites, dans un calcul du futur, en termes de valeur économique (coma économique artificiel versus agonie économique). Étant donnée l’inextricabilité du capital fossile par rapport à notre régime d’accumulation, et de l’État par rapport à ce dernier, combien de temps un État capitaliste resterait-il capitaliste dans une telle transition (et pourrait-il, suivant strictement la logique de la critique de la valeur, rester un État) ? Je suis convaincu par l’affirmation de Malm selon laquelle « pendant la période de transition, on ne peut éluder l’interdiction de la consommation d’animaux sauvages, l’arrêt de l’aviation de masse, l’abandon progressif de la viande et d’autres choses synonymes de belle vie, et ceux qui, dans le mouvement pour le climat et à gauche, prétendent que rien de tout cela n’est nécessaire et que le commun des mortels n’aura rien à sacrifier ne sont pas honnêtes »[25]. Mais la menace claire et actuelle qui pèse à la fois sur le capital productif et sur le capital fictif, la réduction évidente de la valeur future – en particulier dans le contexte de la méga bulle d’État qui se développe rapidement – pourraient-elles forcer rapidement la transition vers l’abandon total du capital fossile ? C’est peut-être un autre dilemme que nous devrons habiter en réfléchissant à travers et au-delà de nos urgences.
- [1] Winant Gabriel, « Coronavirus and Chronopolitics », n+1, n° 37, URL: https://www.nplusonemag.com/issue-37/politics/coronavirus-and-chronopolitics-2/.
- [2] NdT: La distinction se trouve dans Deleuze Gilles, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle » (in L’autre journal, n° 1, mai 1990, URL : http://1libertaire.free.fr/DeleuzePostScriptum.html), pour marquer la différence entre les sociétés disciplinaires qui identifient l’individu pour lui attribuer une position dans la masse et les sociétés de contrôle qui divisent l’individu en échantillons et données.
- [3] Agamben Giorgio, A che punto siamo? L’epidemia come politica, Macerata, Quodlibet, 2020.
- [4] Coupat Julien et al., « Covid : choses vues », Reporterre, 4 septembre 2020, URL : https://reporterre.net/Covid-choses-vues.
- [5] The Economist, « Creating the coronopticon », 28 mars 2020, URL: https://www.economist.com/briefing/2020/03/26/countries-are-using-apps-and-data-networks-to-keep-tabs-on-the-pandemic.
- [6] Badiou Alain, Sur la situation épidémique, Paris, Gallimard, 2020, pp. 9-10.
- [7] D’Eramo Marco, « The Philosopher’s Epidemic », New Left Review, n° 122, Mars/avr. 2020, pp. 25-27. Voir aussi Watkins Susan, « Politics and Pandemic », New Left Review, n° 125, Sept./oct. 2020.
- [8] Coupat J., op. cit.
- [9] Jappe Anselm, Aumercier Sandrine, Homs Clément, Zacarias Gabriel, De Virus Illustribus. Crise du Coronavirus et épuisement structurel du capitalisme, Paris, Crise & Critique, 2020, pp. 57-58.
- [10] Toscano Alberto, « Par-delà l’État peste », op. cit.
- [11] Jappe Anselm et al., De Virus Illustribus, op. cit., p. 58.
- [12] De Carolis Massimo, « The Threat of Contagion », Ill Will, 12 mars 2020, URL: https://illwill.com/the-threat-of-contagion.
- [13] Jappe Anselm et al., De Virus Illustribus, op. cit., pp. 70-71.
- [14] Ibid., p. 74.
- [15] Ibid., p. 107.
- [16] Ibid., p. 106.
- [17] Ibid., p. 107.
- [18] Ibid., p. 30.
- [19] Ibid., p. 105, 113.
- [20] Ibid., p. 197.
- [21] Sur ces questions, voir les observations perspicaces de Dale Gareth, « Global Fever », Spectre, 1e août 2020, URL : https://spectrejournal.com/global-fever/.
- [22] Malm Andreas, La chauve-souris et le capital. Stratégie pour l’urgence chronique, Paris, La Découverte, 2020, pp. 172-173.
- [23] Ibid., p. 173.
- [24] Ibid., p. 190.
- [25] Ibid., p. 188.