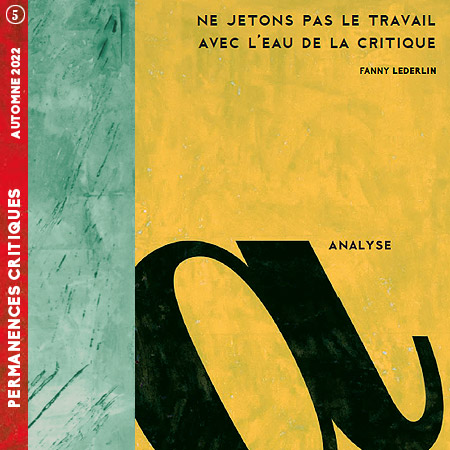Au cours des dernières décennies, le monde du travail a été marqué par la mondialisation, le chômage de masse et l’instauration de nouveaux modes de management liés aux mutations technologiques (en particulier, à la robotisation, à la digitalisation et à l’essor de l’intelligence artificielle). Ces facteurs, associés au triomphe des idéaux de performance, d’indépendance et d’adaptation propres à ce que l’on peut nommer le « néolibéralisme »[1], ont radicalement transformé les conditions de travail de tous les travailleurs – hommes et femmes, ouvriers, paysans et employés, « exécutants » ou « cadres exécutifs », salariés ou non -, partout dans le monde. Si bien qu’il conviendrait peut-être, en ce début de XXIe siècle, d’enrichir la catégorie « travail » du terme de « néotravail » pour désigner les modalités d’un travail qui ne se caractérise plus seulement par une « division sociale »[2] mais aussi par une « atomisation des travailleurs » (la dimension collective du travail tendant à disparaître depuis les années 1990[3]), non plus seulement par le contrôle et la subordination propres au salariat mais aussi par une systématique « tâcheronisation » (le travail à la tâche se généralisant, en particulier chez les travailleurs digitaux[4]), et non plus seulement par une « invisibilisation »[5] mais aussi par une pernicieuse « ludification »[6] (les consommateurs étant désormais mis gratuitement à contribution pour évaluer des prestations ou produire des contenus).
Aussi, à l’heure où le travail de plateforme attire à lui une cohorte de jeunes et de personnes plus ou moins précaires à la recherche d’une illusoire « indépendance » financière et sociale qui prend en fait la forme de petits boulots mal payés et mal protégés par le droit (coursier, chauffeur, « juicer » de trottinette, mais aussi entraîneur d’algorithmes, nettoyeur du web, etc.) ; à l’heure où la généralisation de la sous-traitance des fonctions insuffisamment rentables des entreprises[7](autrefois nommées « services généraux ») provoque une dualisation du marché du travail où certains sont reconnus et protégés, tandis que d’autres – agents d’entretien, commerciaux chargés de l’assistance clientèle en ligne, personnels des services de restauration, de conciergerie ou d’informatique, etc. – se voient contraints d’accepter les conditions dégradées proposées par les entreprises sous-traitantes ou d’intérim qui les emploient ; et à l’heure enfin où les employés de bureau se voient bien souvent réduits, dans leurs open space devenus des « flex office », à l’état de nomades[8] à la recherche d’une chaise où s’asseoir et d’une prise électrique où brancher leur ordinateur, le « néotravail » apparaît à l’évidence, sinon plus dégradant que le travail tel qu’il se pratiquait aux XIXe et XXe siècles, du moins aussi critiquable.
Un moment critique
Et, en effet, le « néotravail » fait l’objet, depuis quelques années, de critiques de plus en plus vives. Des critiques qui ont été amplifiées par la crise consécutive à l’épidémie mondiale de covid-19, l’arrêt brutal de l’économie ayant à la fois donné du recul aux observateurs et l’occasion à de nombreux travailleurs – pas tous, et notamment pas les travailleurs du soin – de réfléchir à leurs conditions de travail. Elle a aussi permis à des cadres, des personnes exerçant des professions intellectuelles et des employés de bureau d’expérimenter, avec le télétravail, un nouveau rapport à l’espace et au temps de travail. Ainsi, la critique du travail s’est récemment enrichie de nouveaux travaux théoriques, et s’est vue traduite en pratique par l’attitude d’une part non négligeable de travailleurs qui, encouragés peut-être par la baisse provisoire du chômage, semblent se placer dans une relation plus distante à leur travail, soit qu’ils en contestent directement les conditions (citons les actions menées par les livreurs Deliveroo dans la plupart des pays d’Europe, ou encore l’emblématique grève des femmes de chambre de l’hôtel Ibis des Batignolles, à Paris), soit qu’ils se désinvestissent de ce qui leur apparaît au mieux comme un simple gagne-pain, au pire comme une « insoutenable subordination »[9].
C’est dans ce contexte que sont apparus des phénomènes tels que la « grande démission »[10] aux États-Unis puis en Europe, ou le mouvement « tang ping »[11] (qui signifie « indolence volontaire ») en Chine. Si leur ampleur reste relative et s’il convient de se méfier d’une interprétation trop naïve (la « grande démission » pouvant s’avérer cacher un « grand licenciement »[12]), ces mouvements témoignent, ne serait-ce que marginalement, d’une mise en cause de la place du travail dans la vie et d’une volonté d’en questionner les modalités. Et c’est sans doute ce contexte qui explique en partie l’engouement que connaissent aussi bien le télétravail – qu’une grande majorité de télétravailleurs, soulagés de rester chez eux quelques jours par semaines, considère aujourd’hui comme un acquis social à part entière – que le travail dit « indépendant » qui s’étend, au-delà des professions libérales, au travail en freelance ou en auto-entreprenariat, et auquel de plus en plus de travailleurs et de travailleuses aspirent, désireux qu’ils sont de rompre avec les contraintes (horaires et hiérarchiques) du salariat.
Ce mouvement signe-t-il pour autant l’avènement d’un nouveau rapport de force entre le Capital et le Travail ? Annonce-t-il l’émergence de modalités de travail émancipatrices ? Peut-être faudrait-il, avant d’en arriver à de telles considérations, observer d’un peu plus près ces phénomènes, les armatures idéologiques qui les sous-tendent et les nouveaux rapports sociaux, politiques, mais aussi existentiels qu’ils pourraient contribuer à établir.
Une critique sans dessein émancipateur
Prenons le télétravail. S’il se présente sans doute comme une modalité de travail confortable qui permet à ceux qui y ont accès de réduire leurs déplacements et de disposer de plus de souplesse dans la gestion de leur temps, il soulève aussi d’importantes questions. Outre celle des inégalités entre les travailleurs exerçant une activité télétravaillable[13] et les autres, comment éviter que le travail à domicile transpose les inégalités sociales – inégalités sexuelles (les femmes ayant une activité domestique supérieure aux hommes) ou générationnelles (les jeunes vivant généralement dans des espaces plus réduits que leurs aînés et ayant davantage besoin d’un accompagnement « en présentiel ») –, comment éviter donc que les inégalités sociales se trouvent transposées aux conditions de travail ? Un tel mécanisme reviendrait à effacer des années de négociations tendues vers les objectifs d’égalité et de lutte contre les discriminations au travail : on fait mieux comme progrès social[14]. En outre, comment éviter qu’en s’immisçant à l’intérieur du domicile des travailleurs le télétravail ne conduise à une indifférenciation néfaste entre les sphères et les temps privés et professionnels ? Si les pratiques peuvent être encadrées par une législation intégrant un « droit à la déconnection », il paraît d’ores et déjà complexe d’en vérifier l’application concrète.
En outre, la convergence de l’engouement pour le télétravail et de la diffusion de l’idéal d’un travail dit « indépendant »[15] pourrait témoigner, non tant d’une critique que d’une mise à distance voire d’un rejet du travail dans sa dimension collective. En effet, le travail indépendant – un travail certes « sans patron » mais aussi, faut-il le rappeler, sans collègues avec qui partager le quotidien, sans la protection sociale du salariat, et sans responsabilité vis-à-vis de la communauté de travail –, de même que le télétravail (qui, s’effectuant « à distance » des corps des autres travailleurs pourrait finir par séparer les travailleurs du reste du monde[16]), ces modalités de travail pourraient s’avérer non seulement « atomisantes » mais aussi « précarisantes ». Et la critique actuelle du travail pourrait, en délaissant la traditionnelle dénonciation des injustices et des mécanismes d’exploitation et d’aliénation du travail dans la perspective d’une émancipation de l’ensemble des travailleurs par eux-mêmes, avoir perdu en chemin sa raison d’être. Comme si théoriciens critiques et travailleurs « éclairés » ne cherchaient plus tant, par leurs réflexions et leurs actions, à permettre aux hommes et aux femmes de se libérer collectivement dans le travail qu’à permettre à chacun, par des « stratégies de sauve-qui-peut individuel »[17], de se libérer personnellement des contraintes collectives du travail.
Retour au rôle social et existentiel du travail
Le problème de cette approche qui tend à « jeter le travail avec l’eau du bain » tient d’abord à ce qu’elle risque, en renforçant les processus qui sont à l’œuvre depuis plus de trente ans (atomisation, tâcheronisation, nomadisation), de maintenir le « néotravail » au lieu de le déstabiliser. Il tient ensuite à ce qu’elle pourrait, au moment où apparaissent les défis écologiques, sociaux et politiques immenses qui se dressent devant nous, affaiblir l’un des rares leviers dont nous disposons collectivement pour tenter de bâtir une société plus juste, plus viable et plus désirable. En effet, la pratique du travail dans sa dimension collective est l’un des rares modes d’agir dont nous disposons pour espérer « changer le monde » (ou tout au moins, tenter de le réparer). C’est bien cela qu’adressait Marx il y a cent cinquante ans lorsqu’il théorisait « l’émancipation universellement humaine » comme la reprise du contrôle, par les travailleurs et les travailleuses, de leurs « forces propres comme forces sociales[18]».
Il se trouve en effet que, loin de se réduire à une manière plus ou moins douloureuse de gagner notre vie, le travail façonne aussi notre rapport à la « nature », aux autres, à nous-mêmes, et finalement au monde. Il façonne notre relation à la nature parce qu’il « médiatise » notre lien à l’environnement (c’est par le travail que nous « métabolisons » la nature, en transformant le bois en table, par exemple) ; il façonne notre relation aux autres, parce qu’il organise nos liens sociaux (nos productions contribuant aux besoins des autres, et la collaboration avec d’autres travailleurs nous conformant à la vie sociale) ; et il façonne notre rapport à nous-mêmes parce qu’il nous confronte au réel (qui résiste), et parce qu’il nous permet, en exerçant nos compétences et nos talents, d’imprimer une action singulière sur le monde. Comment prétendre raisonnablement apporter des réponses à la crise écologique aussi bien qu’aux crises démocratiques, logistiques, démographiques, géopolitiques… auxquelles l’humanité fait face, en prétendant devenir des « travailleurs solitaires » peu à peu délestés des contraintes mais aussi de la puissance collective comme « force sociale » ?
Au-delà, et peut-être plus fondamentalement encore, le travail, qu’Hannah Arendt définit comme l’ensemble des activités humaines qui consistent à maintenir et à prendre soin de la vie biologique[19], est une forme d’agir essentielle à l’exercice de notre faculté de « percevoir » le monde, c’est-à-dire non seulement à notre capacité à « entrer en communication » avec lui, mais aussi, comme l’indique le phénoménologue Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), à notre capacité d’en « prendre possession par notre corps[20]». C’est à côté de ce rapport-là – un rapport incarné au monde, dans lequel chacun peut faire l’expérience de son corps limité et vulnérable en actes, mais aussi celle d’autres corps dont, comme tout autre être vivant, il est interdépendant – c’est à côté de ce rapport-là, qui s’exprime si puissamment dans l’expérience du travail collectif qui nous met quotidiennement en présence de notre corps et du corps des autres, que pourraient être en train de passer les critiques actuelles du travail et les travailleurs eux-mêmes.
Par la reconquête du travail collectif, bâtir un monde plus viable
« La liberté consiste moins (ou de moins en moins) à nous affranchir du travail nécessaire à la vie qu’à nous affranchir de l’hétéronomie, c’est-à-dire à reconquérir des espaces d’autonomie où nous puissions vouloir ce que nous faisons et en répondre[21]» écrivait le philosophe André Gorz (1923-2007) à la fin des années 1980. Voilà l’horizon à l’aune duquel nous devrions aujourd’hui penser et critiquer le travail. Non pas comme une anomalie historique dont nous prétendrions nous débarrasser – nous inscrivant alors sans le savoir dans le sillage des tenants de l’idéologie transhumaniste qui ambitionnent de se débarrasser de l’encombrante fragilité des corps et plus largement de toute forme de nécessité -, mais comme une puissante manière d’agir qui tisse matériellement notre rapport à la nature, aux autres, à nous-mêmes et au monde, et dont nous devons urgemment engager la reconquête.
Or, s’ils présentent sans doute des avantages personnels pour certains travailleurs, ni le télétravail, ni le travail indépendant, ni même la semaine des quatre jours actuellement débattue dans la plupart des pays d’Europe ne sont des revendications à la hauteur des enjeux et des responsabilités colossales qui sont les nôtres. Car ce n’est pas en cherchant à atténuer ou à faire disparaître de nos vies les contraintes collectives du travail ; ce n’est pas en cherchant (illusoirement) à nous libérer du travail que nous réussirons à opposer au productivisme, qui détruit le vivant et réifie les travailleurs, un modèle productif plus viable. Et d’ailleurs, en les faisant disparaître de quelles vies ? Au prix de quelles vies, des vies de quels autres travailleurs, certaines vies pourront-elles s’offrir le luxe de cette soi-disant libération ? C’est au contraire en nous demandant comment rétablir, dans le travail, des liens de coopération et de solidarité, des gestes et des rapports plus vertueux et plus respectueux de la terre, des animaux et de l’ensemble des êtres vivants, mais aussi des objets qui nous entourent, et en questionnant collectivement les finalités de notre travail que nous nous donnerons une chance d’y parvenir.
Aussi, plutôt que de vouloir jeter le travail – et l’émancipation « universellement humaine » dont il peut être porteur – avec l’eau de leur critique, les responsables et militants syndicaux, les responsables politiques et les travailleuses et les travailleurs que nous sommes toutes et tous auraient peut-être intérêt à s’atteler à se réapproprier la puissance collective du travail en se demandant : « comment vouloir ce que nous faisons ? » et « comment être en mesure d’en répondre ? ».
- [1] Par « néolibéralisme », nous nous référons à la forme contemporaine du capitalisme dans les démocraties libérales (une forme dont les origines théoriques remontent aux années 1930, et qui est devenue hégémonique depuis les années 1990). Sur ce concept polymorphe et débattu, voir Audier Serge, Néolibéralisme(s), une archéologie intellectuelle, Paris, Grasset, 2012.
- [2] Dans l’économie capitaliste, le travail fait l’objet selon Marx d’une « division sociale » qui réduit tous les travaux singuliers à une « substance sociale commune » (ce phénomène étant, selon lui, à l’origine du « caractère fétiche de la marchandise »). Cf. Marx, Karl, Le Capital, Livre I, 1867, publié sous la resp. de J.P. Lefebvre, Paris, Puf, coll. Quadrige, 1993, 2ème édition 2006, chap. 4.
- [3] Dans l’économie capitaliste, le travail fait l’objet selon Marx d’une « division sociale » qui réduit tous les travaux singuliers à une « substance sociale commune » (ce phénomène étant, selon lui, à l’origine du « caractère fétiche de la marchandise »). Cf. Marx, Karl, Le Capital, Livre I, 1867, publié sous la resp. de J.P. Lefebvre, Paris, Puf, coll. Quadrige, 1993, 2ème édition 2006, chap. 4.
- [4] Voir sur le sujet : Casilli Antonio A., En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic, Paris, Seuil, 2019.
- [5] Selon Marx, c’est grâce à l’invisibilisation du « sur-travail » non payé que le Capital parvient à transformer la force de travail en valeur (c’est-à-dire, en profits). Cf. Marx Karl, Le Capital, op. cit., chap. VII, « Le taux de survaleur », et chap. VIII, « La journée de travail ».
- [6] Voir sur le sujet : Casilli Antonio A., En attendant les robots, op. cit.
- [7] Voir sur le sujet : Srnicek Nick, Capitalisme de plateforme. L’hégémonie de l’économie numérique, trad. P. Blouin, Montréal, Lux Éditeur, 2018, p. 21 et suiv.
- [8] « Le nouveau salarié, un “Touareg du tertiaire” en perpétuelle transhumance », chronique de Nicolas Santolaria publiée dans Le Monde le 14 mars 2019.
- [9] Linhart Danièle, L’insoutenable subordination des salariés, Toulouse, éditions Érès, 2021.
- [10] Connu outre atlantique sous le terme de « Great Resignation », ce mouvement a vu 38 millions d’Américains quitter leur travail en 2021, dont 4,5 millions pour le seul mois de novembre 2021.
- [11] « La jeunesse chinoise réclame un droit à la paresse », Le Monde, 16 juin 2021.
- [12] « La “grande démission” dégonflée, quid du “grand licenciement” ? », blog de Bruno Coquet, Alternatives Économiques, 29 août 2022.
- [13] Ils représentent à ce jour entre 30 et 40% de la population active en Europe et aux États-Unis.
- [14] Voir sur le sujet : Lederlin Fanny, « Le télétravail est-il un progrès social ? », Le Droit Ouvrier, mars 2021, n°871, pp.109-112.
- [15] Sur les illusions que recouvre cet idéal, voir : Lederlin Fanny, « Travail dit « indépendant » : un inquiétant idéal », Études, mai 2021, pp.43-53.
- [16] Voir sur le sujet : Lederlin Fanny, « Télétravail : un travail à distance du monde », Études, novembre 2020, pp.35-45.
- [17] Linhart Danièle, L’insoutenable subordination des salariés, op. cit., p. 67.
- [18] Marx Karl, Œuvres III, Philosophie, édition établie, présentée et annotée par M. Rubel, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1982, Pour une critique de la philosophie du droit de Hegel, Introduction, 1843, p. 382-397, p. 103.
- [19] Arendt Hannah, L’Humaine Condition, 1958-1972, sous la dir. de P ; Raynaud, trad. G. Fradier, M. Berrane avec la coll. de J-F Hel-Guedj, collectif ; G. Durand, Quatro, Gallimard, 2012, Condition de l’homme moderne, 1958, trad. G. Fradier, p. 51-323. L’auteure distingue le travail (labor) de l’œuvre (work, activité qui consiste à fabriquer des objets, qui peut s’exercer solitairement) et de l’action (politique).
- [20] Merleau-Ponty Maurice, Phénoménologie de la perception, 1945, in Œuvres, Paris, Gallimard, Quarto, 2010, p. 943 : L’auteur décrit phénoménologiquement la faculté de percevoir comme « une certaine possession du monde par mon corps, une certaine prise de mon corps sur le monde ».
- [21] Gorz André, Métamorphoses du travail. Critique de la raison économique (1988), Paris, Galilée, ed. poche Gallimard, 2004, p. 268.