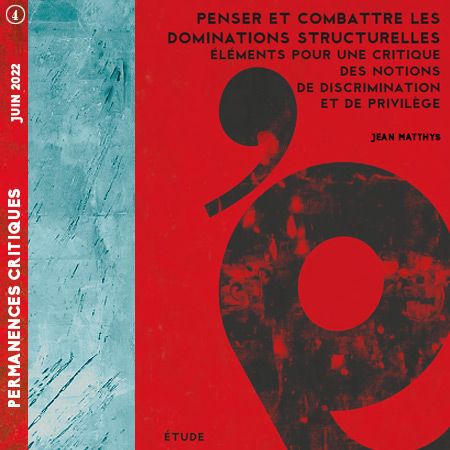Introduction
Lorsque nous pensons au sexisme, au racisme, à l’homophobie ou à la question des inégalités entre les classes sociales, les phénomènes visibles qui viennent le plus spontanément à l’esprit, et qui sont aussi les plus médiatisés (parce que médiatisables), relèvent généralement d’une forme de discrimination plus ou moins directe. Un·e candidat·e pour un emploi n’est pas retenu·e pour un entretien d’embauche en raison des consonances étrangères du nom inscrit sur son CV. Un jeune homme fait l’objet d’un contrôle policier « au faciès », c’est-à-dire en raison de la couleur de sa peau. Un·e élève est contraint·e par le conseil de classe de se tourner vers une filière scolaire professionnalisante car ses parents sont issus d’un milieu ouvrier. Une personne homosexuelle est victime d’une agression en raison de son orientation sexuelle. Une femme voit ses compétences professionnelles remises en cause par son collègue en raison de son genre, ou est licenciée à la suite d’un congé de maternité.
La discrimination est une catégorie qui vise bien un ensemble de phénomènes de ce type, observables – et condamnables – dans notre société, mais nous proposons ici dans un premier temps d’interroger les limites théoriques et politiques de ce concept lorsqu’il est mobilisé pour saisir la nature et les mécanismes des systèmes sociaux d’inégalités et de dominations (racisme, patriarcat, capitalisme, hétérosexisme, etc.). Ceux-ci, en réalité, débordent largement les phénomènes de type discriminatoire, échappent généralement par principe aux instruments usuels de sensibilisation et de répression, et engagent d’autres formes d’action collective en vue de leur suppression que le simple « poliçage »[1] ou que la correction des « préjugés » qui constituent souvent la principale perspective des luttes anti-discrimination. On s’efforcera ici de montrer que la focalisation sur la notion de discrimination tend à privilégier une perspective idéaliste, individualisante et moralisante de la politique, en minimisant par là même la matérialité et l’épaisseur socio-historique des rapports de domination, et participant ainsi d’une sorte de dénégation, voire de stratégie d’évitement face à l’ampleur des tâches collectives, proprement politiques, d’organisation et de transformation sociale qui nous incombent dans la lutte contre les dominations.
Dans un second temps, nous prolongeons ces réflexions en tournant notre attention vers la catégorie de privilège, schème théorique descriptif des dominations qui connaît un certain succès dans les milieux associatifs et militants depuis quelques années – milieux où il en est venu à désigner par surcroît une certaine forme de pratique discursive d’introspection et de déclaration performative[2], voire de confession et d’aveu, dont l’intérêt et l’efficacité proprement politiques ne nous semblent pas aller de soi, et dont il peut être utile de relever certaines limites. Si, comme on le verra, la notion de privilège présente quelques indéniables avantages théoriques par rapport à celle de discrimination, notamment celui de nous mettre sur la voie du caractère systémique et le plus souvent inconscient des dominations, elle n’en reste cependant pas moins à certains égards solidaire du paradigme de la discrimination, avec laquelle elle forme d’ailleurs un couple d’opposition « privilégié/discriminé » dont il est difficile de définir un terme sans faire référence à l’autre[3]. Plus précisément, il nous semble que certains de ses usages discursifs à vocation de transformation éthico-politique immédiate, où il s’agit pour l’individu dominant de « checker ses privilèges » pour « déconstruire » ses représentations et propos « problématiques », continuent à fonctionner au sein du paradigme idéaliste et individualiste qui définit selon nous les limites de l’approche en termes de discrimination.
Nous proposons ainsi dans cette étude d’ébaucher une critique avant tout théorique et épistémologique de ces deux notions, tout en nourrissant la conviction que s’y réfléchissent de réels enjeux pratiques concernant les difficultés autant que les potentialités de nos luttes présentes et à venir contre les rapports sociaux de domination. La manière de penser et poser un problème délimite a priori le champ des solutions que l’on peut élaborer ; la forme d’une question, ainsi que le contenu des concepts qu’elle mobilise, commande les différentes réponses que l’on peut lui apporter. Lutter contre la discrimination, contre des préjugés, contre des « x-phobies », contre l’exclusion, contre des privilèges, contre des systèmes de domination : toutes ces expressions ne sont pas équivalentes, et chacune renvoie à une certaine rationalité, à une certaine manière de penser la société et les conflits sociaux, et porte à envisager un certain type de réponse en termes de lutte politique, tant au niveau des fins que des moyens. Dans un contexte où elles connaissent un intérêt croissant (ce dont on peut pour une part se réjouir), nous voudrions ici souligner à quel point les approches en termes de discrimination/privilège, qui charrient tout un ensemble spécifique de présuppositions théoriques et d’implications pratiques, ne sont ni les seules possibles, ni ne constituent le dernier mot des mouvements d’émancipation.
Première approche critique de la discrimination
Dans son sens neutre et générique, la discrimination désigne l’action ou le « fait de différencier en vue d’un traitement séparé (des éléments) les uns des autres en (les) identifiant comme distincts »[4]. Dans son sens plus spécifiquement péjoratif, politique et critique, qui est celui qui nous intéresse ici, la notion renvoie au « traitement différencié, inégalitaire, appliqué à des personnes sur la base de critères variables »[5]. Si la discrimination au sens générique consiste simplement à distinguer et traiter différemment des choses différentes (je ne me comporte pas de la même manière devant mon chat que devant le volant de mon automobile), son sens proprement critique et politique fait appel à l’idée d’une inégalité, et donc d’une forme d’injustice, consistant à appliquer un traitement différent à des personnes sur la base arbitraire d’une caractéristique supposée constituer une « différence essentielle » (de couleur de peau, d’origine ethnique, de langue, de nationalité, de sexe/genre, de classe sociale, etc.) socialement perçue comme infamante et justifiant une infériorité hiérarchique. Ainsi, en Belgique, Unia, l’institution publique indépendante chargée de lutter contre les discriminations et défendre l’égalité des chances au niveau interfédéral, définit la discrimination comme « le traitement injuste ou inégal d’une personne sur base de caractéristiques personnelles »[6]. La législation anti-discrimination sur laquelle se fonde juridiquement l’action d’Unia définit un ensemble de 19 « critères protégés » qui définissent lesdites « caractéristiques personnelles » sur base desquelles opérer une différenciation de traitement est jugé discriminatoire et donc punissable par la loi[7].
D’emblée, la mobilisation de la catégorie de discrimination ainsi définie semble opérer une double individualisation des rapports d’inégalité et de domination : cette définition, ainsi que les exemples de phénomènes que nous citions dans notre introduction, d’une part se concentrent sur le fait qu’une personne est victime de discrimination « en raison de caractéristiques personnelles », et impliquent, d’autre part, la présence d’une (ou de plusieurs) personne qui, à titre individuel ou inter-individuel, commet, par volonté ou préjugé (c’est-à-dire dans les deux cas en raison de mobiles relevant de son intériorité subjective, nous y reviendrons), un acte de discrimination – sans quoi on ne pourra pas établir de responsabilité juridique. Relevons aussi que l’expression même de « caractéristiques personnelles » dans la définition proposée par Unia est en soi tout à fait questionnable, puisque l’on pourrait au contraire noter que l’ensemble des critères de discrimination sont bien davantage et avant tout des caractéristiques sociales dont l’individu discriminé est perçu comme étant le porteur. En effet, on pourra effectivement parler d’une forme d’inégalité ou d’injustice qu’à la condition de rapporter cette « caractéristique personnelle » à une « communauté » altérisée et minorisée dont l’individu sera socialement considéré comme un exemplaire métonymique (toujours rapporté au tout homogène et essentialisé du groupe social dont il est supposé être une partie stéréotypique), et à la condition de la situer sociologiquement au sein d’une certaine structuration hiérarchique des rapports sociaux entre groupes[8]. Mais cette individualisation de la focale et cet aveuglement aux déterminations sociologiques ne constituent que le premier aspect de ce que l’on peut considérer comme les limites de la notion de discrimination et de ses usages institutionnels « dominants ».
D’un point de vue généalogique, il est intéressant de voir comment le discours contre les discriminations s’est développé. Gérard Noiriel écrivait en 2006 que « la lutte contre les discriminations ethnico-raciales, qui était auparavant l’apanage de la gauche et des organisations antiracistes, est devenue un thème consensuel »[9]. Bien plus, la notion de discrimination n’est pas devenue consensuelle seulement pour désigner les inégalités ethnico-raciales : elle est aussi devenue la catégorie centrale pour appréhender les inégalités de genre, de sexualité, et même certaines formes d’inégalités entre classes sociales (sous la forme de ce que les Américain·es ont baptisé classism, soit une discrimination « classiste »[10]. Mais on peut se demander si la catégorie de discrimination a pu faire l’objet d’un tel consensus idéologique sur l’ensemble du spectre politique sans évincer un ensemble d’autres manières, plus radicales et politiques, d’appréhender les inégalités sociales, les systèmes de dominations et les manières de lutter contre elles. On pourrait alors faire l’hypothèse que ce consensus transcendant les clivages politiques repose sur une certaine innocuité propre au concept de discrimination, mobilisant implicitement une certaine théorie du social elle-même relativement consensuelle et pourtant éminemment critiquable, et reflétant à la manière d’un symptôme un certain état d’impuissance politique, voire de renoncement à se porter à la hauteur des tâche requises par un projet de transformation radicale des rapports sociaux dans le sens d’un projet égalitaire et émancipateur.
On peut en effet considérer que, se substituant à un mouvement proprement politique et organisé luttant en faveur d’une égalité à conquérir et à construire, la montée de la notion de discrimination repose sur l’idée qu’il suffirait de supprimer des discriminations résiduelles pour que la société devienne ce qu’elle est déjà en principe, à savoir égalitaire. C’est ainsi que l’on serait passé de luttes politiques pour l’égalité et contre les systèmes de domination structurels portées par les groupes subalternes eux-mêmes à la lutte contre les discriminations dans la perspective d’une égalité des chances sous l’impulsion et le contrôle principal de l’État (et/ou instances para-étatiques). Or, ce basculement de perspective n’est pas sans conséquences ni présuppositions. Plutôt que de considérer, en accord avec l’idéal politique d’émancipation, le passage – par et pour les groupes dominés eux-mêmes – d’un état de minorité et de domination à un état d’égalité de participation et de maîtrise sur sa propre vie et sur la vie collective[11], on commence par se représenter la société existante comme déjà en droit égalitaire, et comme étant seulement divisée et rendue inégale par une forme d’écart résiduel par rapport à ce qu’elle est déjà en puissance dans ses principes et sa structure fondamentale (politique, économique, juridique, sociale, institutionnelle, etc.). La mobilisation de la catégorie de discrimination tend ainsi à charrier l’image d’une déviation accidentelle, d’une production contingente d’un écart à une norme égalitaire qui existerait au moins à l’état latent ou virtuel dans les rapports sociaux existants. Mais pourquoi cet écart ? D’où proviennent exactement ces préjugés à l’origine des discriminations ? Peuvent-ils être simplement réduits à une forme d’ignorance ? Quel est leur lien avec une certaine structure sociale qui organise de fait une hiérarchisation économique et matérielle aussi bien que symbolique entre différents groupes sociaux ? Voilà autant de questions que la notion de discrimination ne semble par principe pas permettre de poser. C’est que, ne fût-ce pour que formuler de telles questions, il faut précisément partir du fait sociologique de l’existence de rapports sociaux structurellement inégalitaires et hiérarchiques comme étant non pas des déviations plus ou moins contingentes, mais bien des formes structurant l’organisation, les représentations et les pratiques sociales au sein de notre société, celle-ci se définissant structurellement, essentiellement et fonctionnellement comme capitaliste, raciste, patriarcale et hétérosexiste. Cela ne veut certes pas dire que notre société se réduise à n’être que cela (capitaliste, raciste, patriarcale et hétérosexiste) ; mais cela, elle l’est structurellement, au sens où son fonctionnement matériel et symbolique repose sur la reproduction de ces systèmes de domination, d’oppression et d’exploitation[12]. Il y aurait ainsi une manière de parler de discriminations dans notre société qui fait comme si celles-ci étaient des sortes d’aberrations ou d’accidents survenant dans une société où règnerait en principe une norme égalitaire, et qui empêche par là même de saisir en quoi ces actes et paroles discriminatoires particuliers sont la matérialisation de rapports sociaux de domination qui jouent un rôle fonctionnel dans la reproduction de l’ordre social existant et qui, à ce titre, précèdent, dépassent et déterminent les consciences, les représentations et les actions des acteurs sociaux individuels[13].
Notons bien que la perspective anti-discrimination ne postule pas l’existence de fait d’une égalité des chances d’ores et déjà pleinement accomplie dans l’état actuel de la société. Au contraire, ces luttes contre les discriminations se basent sur une certaine conception de systèmes d’inégalités et de préjugés visant des catégories particulières de personnes qui sont alors victimes de discrimination. Mais quelle conception de ces systèmes la notion de discrimination véhicule-t-elle au juste ? Quelle est la théorie des inégalités qui est implicitement mobilisée ? Quelle en est la logique, le schème de causalité sociale ? Et quelles sont par conséquent les voies qui sont proposées pour s’en défaire ?
La théorie du social implicite dans la notion de discrimination
Retournons chez Unia qui, dans une petite vidéo didactique à visée de sensibilisation, nous dévoile « les étapes qui mènent à la discrimination ».
Tout commence avec les stéréotypes. Notre cerveau s’appuie sur eux pour traiter une multitude d’informations. Ils nous permettent par exemple de reconnaître des formes élémentaires ou encore d’associer une image à un groupe de personnes, comme lorsqu’on pense aux Belges. [La vidéo montre un cornet de frites – NdA (Jean Matthys)] Les stéréotypes peuvent mener à des préjugés. Les préjugés sont des réactions émotionnelles qui colorent notre regard et nous préparent à agir. Si vous pensez que les bénéficiaires du CPAS sont des profiteurs ou des fainéants, ces stéréotypes nourrissent les préjugés. En effet, cela vous irrite, vous fâche, et ces préjugés peuvent mener à de la discrimination. Cela signifie que vous allez traiter une personne autrement, ou l’exclure, parce qu’elle est différente […] Refuser une personne de 54 ans [pour un emploi] parce que vous imaginez qu’à cet âge elle n’est plus dans le coup, et que donc qu’elle vous inspire méfiance, c’est de la discrimination. Et c’est interdit par la loi. Alors, changez de regard[14].
Plusieurs éléments nous semblent ici significatifs et dignes d’être relevés de façon critique, à titre de révélateurs, peut-être un peu caricaturaux, de la « théorie sociale » implicitement mobilisée par le paradigme de la lutte contre les discriminations. À tout le moins, il nous importe ici de souligner que ces explications présupposent une certaine vision des phénomènes sociaux d’inégalités et une certaine manière de concevoir la lutte contre ceux-ci qui est loin d’aller de soi.
Psychologisation : On peut d’abord relever le caractère psychologisant de cette explication, c’est-à-dire cette manière de renvoyer la discrimination à un mécanisme fondamental, en quelque sorte « naturel » et en dernière instance indépassable du fonctionnement de tout « cerveau » humain. La thèse de la vidéo est forte : « tout commence par les stéréotypes » – c’est-à-dire que les discriminations ne commencent pas dans la société, dans l’histoire, dans les rapports de forces entre groupes sociaux, dans les institutions, dans les pratiques sociales, ou encore dans l’organisation économique et politique, mais bien au niveau d’un mécanisme psychologique radicalement individuel, localisé dans le cerveau. La vidéo ne dit certes pas que la discrimination elle-même est un mécanisme psychologique naturel et indépassable, mais bien qu’elle trouve son origine et repose en dernière instance sur un tel mécanisme[15].
Idéalisme : Ensuite, même à faire l’hypothèse généreuse que, pour Unia, ces représentations stéréotypiques ne reposent pas entièrement sur des mécanismes profonds, irréductibles et « naturels » de la psychologie humaine mais renvoient, particulièrement dans leurs contenus, à certaines formes spécifiques et historiquement situées d’organisation politique, économique et idéologique de la société (ce dont la vidéo ne dit absolument rien), cette explication véhicule en tout état de cause une conception de l’origine de la domination comme relevant d’idées et de représentations constituant à ce titre la véritable cause des comportements discriminants. Les discriminations sont posées comme le résultat de « préjugés » envers certains groupes sociaux. C’est dire que la discrimination est ici pensée comme un phénomène essentiellement mental et cognitif, au sens où sa source se situe dans la « tête » des personnes, dans les subjectivités, au niveau de leurs représentations de soi, des autres et du corps social. La domination sociale d’un groupe sur un autre est alors conçue comme l’effet des comportements causés par les états mentaux des individus. La mobilisation de la catégorie de discrimination est ainsi sous-tendue par une thèse forte concernant l’origine des inégalités (raciales, de genre, de classe, etc.) : s’il y a des comportements et des rapports sociaux racistes (par exemple), c’est parce qu’il y a de l’idéologie raciste dans la tête des individus. Autrement dit, et de façon générale, les injustices ont une origine subjective, et les dominations persistent dans notre société à cause des états mentaux des individus qui la composent[16].
Individualisme et subjectivisme : On a déjà vu que cette conception repose sur une vision individualisante de la question des dominations et des inégalités sociales. Mais il faut souligner qu’elle véhicule de plus une certaine conception de l’individualité, à savoir celle de l’individu comme sujet autonome, maître et responsable de soi, agissant librement en étant guidé par ses représentations et ses idées, qui sont la cause de ses éventuels comportements « problématiques » (discriminants, non-déconstruits), mais qui sont aussi ce qui peut le rendre capable d’auto-réflexion critique et ainsi de s’auto-émanciper de ses préjugés, voire, comme on dit, de se « déconstruire », et même d’abandonner ses « privilèges » (nous y reviendrons). C’est le fin mot de la petite vidéo d’Unia : « Changez de regard », signalant qu’il s’agit bien avant tout d’une question de « regard », et qu’il suffit d’en changer. Mais, selon un paradoxe typique de toute mobilisation de la catégorie de « sujet », celui-ci n’est considéré maître de soi et de ses idées qu’en étant en même temps voué à être assujetti et discipliné par un ensemble de mesures visant à ajuster ou corriger ses représentations. C’est tout le sens du « et c’est interdit par la loi » qui dans la vidéo, et de manière tout à fait symptomatique, précède immédiatement l’injonction finale à « changer de regard ». Dans la théorie du social ici implicitement véhiculée, c’est en même temps que l’individu est considéré comme doué d’un libre arbitre, rendu entièrement maître et responsable de ses représentations et actes individuels, et qu’il est l’objet d’un continuum de mesures étatiques d’« information » et de « sensibilisation », mais aussi de répression judiciaire, toutes destinées à discipliner les comportements et remplacer les représentations fausses (les « préjugés ») par des vraies, afin que les sujets, ne cessant pas un instant d’agir en toute liberté selon leur conscience, soient déterminés et canalisés de manière à agir dans le sens défini par le pouvoir juridico-étatique[17] (que l’on ne suspectera bien évidemment jamais de jouer un rôle fondamental, quoiqu’ambivalent et affecté par les variations des rapports de forces, dans la reproduction des systèmes de domination…).
Moralisme : Enfin, corrélat de la centration de sa focale sur le sujet et la Loi, l’usage de la notion de discrimination tend alors à inscrire l’appréhension des phénomènes d’inégalités et de dominations sociales dans un cadre inséparablement moral, conduisant à des jugements de l’ordre de la culpabilité et de l’innocence, inséparable du paradigme du sujet supposé individuellement libre et responsable. En dernière analyse, il s’agit toujours dans cette conception de penser la discrimination comme fondée sur un ensemble de représentations, de préjugés portés par des sujets qui sont à l’origine de l’acte discriminant. Les discriminations, autrement dit, ont une cause subjective, représentationnelle, psychologique et cognitive, et, par là même, en dernière instance, individuelle. La discrimination est alors conçue comme un acte individuel déviant, une mauvaise pratique qui peut et doit être modifiée par l’apprentissage d’attitudes et de comportements plus tolérants[18]. À ce titre, elle appelle une correction à caractère à la fois cognitif et moralisateur : il faut sensibiliser et « éduquer » les gens, « débunker » les préjugés, « corriger » les représentations faussées que les « mauvais sujets » se font des groupes discriminés. Une telle perspective « pédagogique » et paternaliste peut souvent conduire au renforcement des formes de mépris (classiste aussi bien que raciste) dont sont victimes certains groupes sociaux objectivement dominés, qui seront pointés comme les groupes les plus susceptibles d’être porteurs de préjugés en vertu de leur ignorance ou de leur immoralité supposées ; d’autre part et par là même, cette approche tend à exempter les groupes sociaux réellement dominants ainsi que les institutions en place de tout soupçon d’être les principaux vecteurs de discriminations objectives et structurelles.
Vous avez dit « domination systémique » ?
S’il peut être fait mention dans certains discours, parfois de manière lancinante et incantatoire (ce qui est sans doute en soi un symptôme et une dénégation de son insuffisante élaboration), du caractère « systémique » desdites discriminations et inégalités, il n’en semble pas moins que cette « systématicité » semble bien souvent être pensée comme se réduisant à la pure et simple somme des individus dont les jugements et les actions sont guidées ou dévoyées par des préjugés, produisant un effet de masse par accumulation quantitative. Or, s’il est un point critique que les sciences sociales peuvent apporter à ce débat, c’est justement celui qui consiste à dire que les phénomènes sociaux ne sont pas mus ou guidés par les idées et les représentations des sujets, pas plus qu’ils ne sont réductibles à la somme de leurs parties individuelles, mais qu’au contraire ils mettent en jeu des institutions, des structures et des pratiques matérielles et symboliques qui sont douées d’une logique propre, héritant d’une histoire épaisse, dictant une certaine rationalité aux actions possibles des agents et guidant ceux-ci à agir dans le sens de la reproduction dudit « fait social » (en l’occurrence l’acte discriminant au service de la hiérarchisation des groupes sociaux). Pour le dire schématiquement, du point de vue d’une sociologie structurale et matérialiste, ce n’est pas parce que beaucoup de personnes ont des préjugés dans la tête qu’il existe un système social raciste (ou sexiste, ou capitaliste, etc.) ; c’est au contraire parce qu’il existe un système social raciste qu’un grand nombre de personnes ont des représentations racistes (plus ou moins conscientes) et commettent des actes (plus ou moins volontaires) de discrimination.
Mais qu’est-ce au juste qu’un système ou une structure sociale ? En sciences sociales, on peut définir une structure comme un mode d’agencement entre éléments caractérisé par une relative (méta)stabilité ; elle définit, autrement dit, une articulation spécifique d’éléments (individus, groupes, représentations, idées, pratiques, etc.) dans un jeu de places et de rapports qui tend à se reproduire, y compris lorsque les éléments eux-mêmes changent. Expliquer un phénomène requiert alors de passer du point de vue individuel de l’élément au point de vue de la totalité sociale au sein de laquelle il évolue et qui le détermine. En effet, une structure définit et délimite pour ses éléments le champ du possible, du visible et du dicible, et exclut corrélativement un contre-champ d’invisible, d’indicible, d’irreprésentable ou d’impensable. Elle est une structure de probabilité forte, d’incitation ou d’impossibilité de ce qui sort de son cadre. La structure définit un espace ou un champ d’(inter)action possible ou probable étant donné la position occupée par l’élément au sein de ses relations.
Par exemple, la structure économique du mode de production capitaliste articule d’une manière spécifique les moyens de production, la force de travail (travailleurs et travailleuses), les rapports de propriété et d’appropriation, le marché et la monnaie de manière à ce qu’il ne soit pas possible, ou du moins littéralement exceptionnel et difficile – c’est-à-dire, d’un point de vue empirique, statistiquement peu probable – pour les prolétaires de subvenir à leurs besoins sans être structurellement contraints de louer au capitaliste leur force de travail qui constitue la seule chose qu’ils possèdent, et à la mettre ainsi au service du procès de valorisation illimitée du capital par l’effectuation d’un travail dont ils ne maîtrisent ni le processus, ni les moyens, ni les conditions, ni les finalités, ni les produits ; mais cette structure capitaliste est aussi bien ce qui contraint de manière quasi vitale les capitalistes individuels à produire toujours plus de valeur et à s’inscrire dans la course au profit, dans une compétition sans répit avec les autres capitalistes ; et elle est aussi ce qui fait que globalement une société capitaliste assure sa reproduction matérielle par une allocation des ressources guidée par le seul marché, lui-même assurant en dernière instance la production et l’échange de biens et services en fonction de la seule profitabilité pour le capital, c’est-à-dire en l’absence de toute maîtrise collective démocratique sur les conditions de satisfaction des besoins individuels et collectifs (en ce compris les conditions écologiques de l’habitabilité humaine de la Terre). Or, c’est à partir de ce point de vue de la totalité sociale et de la position qu’occupe un élément dans la structure que l’on peut rendre compte de ses représentations et comportements, par exemple discriminatoires, en tant qu’ils sont ceux qui sont les plus adéquats à ses intérêts immédiats, ou du moins à la représentation qu’il se fait de ceux-ci – représentation qui n’est jamais tout à fait indemne de la domination idéologique qu’exercent les groupes économiquement et matériellement dominants pour assurer leur hégémonie.
La théorie des privilèges…
Cet aspect proprement structurel des dominations, irréductibles et antérieures aux phénomènes individuels qui les incarnent, tend à être mieux cerné par la notion de privilège que par celle de discrimination. Selon que l’on se trouve à telle ou telle place au sein de l’espace différencié de la structure, on pourra être dit plus ou moins dominé (et donc, en un sens, structurellement « discriminé » par l’ordre social en général) ou au contraire plus ou moins dominant et privilégié. Un privilège peut ainsi être défini dans un premier temps et de manière générique comme un « avantage exclusif réservé à un ou des groupes sociaux et dont sont exclus en conséquence le ou les autres groupes sociaux »[19].
Plus précisément, si l’on résume et se concentre sur le sens plus précis qu’a pris cette notion depuis un article fameux de Peggy McIntosh de 1989[20], il constitue un « avantage immérité du dominant que celui-ci dénie ou dont il est inconscient, et dont la prise de conscience deviendrait la condition sine qua non d’une résistance aux discriminations et aux oppressions qui touchent les dominé·e·s »[21]. Le privilège renvoie ainsi à l’ensemble des avantages qu’un individu tire de facto au sein de certaines situations sociales en vertu du seul fait de son identification ou appartenance au « bon côté » de la norme sociale majoritaire (à la blanchité, au genre masculin, à l’hétérosexualité, à la bourgeoisie) et ce le plus souvent sans que l’individu dominant-privilégié n’identifie consciemment cet avantage comme tel.
Par rapport à l’idéalisme de la notion de discrimination, cette notion de privilège nous semble marquer un net progrès, et ce pour deux raisons principales.
Premièrement, parler de privilège présente l’avantage de signaler que la domination, loin de relever d’une forme d’accident ou de déviation plus ou moins arbitraire ou irrationnelle, repose principalement sur une forme systémique et systématique – et donc douée d’une forme de « rationalité » particulière au service de la reproduction d’une certaine formation sociale – d’extraction d’un « plus » au profit du groupe dominant : extraction de plus-value économique sous la forme du profit dans le cadre de l’exploitation capitaliste du travail ; appropriation et extorsion de travail domestique « gratuit » ou, quand il est payé, structurellement dévalué et surexploité dans le cas de la domination sexiste patriarcale ; extraction de quantité et de qualité de vie de populations définies comme inhumaines au sein des rapports sociaux de race[22]. Si être privilégié c’est être socialement inscrit du côté dominant d’un clivage social hiérarchique, cela veut dire qu’il existe un certain ordre social structuré au sein duquel les individus occupent des positions différenciées qui définissent leurs intérêts objectifs et dont ils tirent soit des avantages, soit des désavantages (matériels, symbolique, d’opportunité, etc.) en termes de pouvoir de faire et de faire faire, et à partir duquel seulement il devient possible de saisir la genèse réelle des actes, discours et représentations discriminatoires qui sont au service de la légitimation et de la reproduction de certains intérêts. À ce titre, comme l’écrit Nicolas Marion, l’acte d’identifier une catégorie de la population comme « privilégiée » constitue « une opération absolument déterminante pour formellement acter une domination qui, dès lors, méritera d’être combattue. Il est d’ailleurs difficile d’identifier, aujourd’hui, une lutte dont l’objet premier n’est pas la dénonciation d’un privilège indu »[23].
Deuxièmement, par rapport à la notion de discrimination, la notion de privilège a le mérite, en principe, de minimiser la centralité de la conscience et des intentions des acteurs sociaux, afin de penser, une fois encore, davantage dans un registre institutionnel et systémique que dans celui des intentions conscientes des individus. En effet, pour jouir de privilèges, il faut vivre dans un système qui nous en accorde, et ce, que l’on en veuille ou non, et que l’on en ait conscience ou non. Cependant, sur le plan pratique, c’est-à-dire saisie non plus comme une théorie descriptive de la domination sociale, mais comme une pratique (micro-)politique et un programme de transformation sociale en vogue dans certains milieux militants, la notion de privilège semble précisément ne pas tirer toutes les conséquences de sa définition, et tombe ainsi sous le coup de la critique que nous faisions plus haut de la notion de discrimination, à savoir de présupposer une conception idéaliste, individualiste et morale du social et des conditions de sa transformation. Il y a là selon nous une véritable contradiction entre d’une part la portée théorique de la notion de privilèges et d’autre part certaines pratiques et usages militants qui s’en revendiquent.
… et ses limites pratiques
On vient de le voir, la théorie des privilèges a essentiellement comme vertu théorique de pointer l’existence d’un groupe de dominants qui tirent collectivement profit de la domination et ce, qu’ils en aient ou non conscience individuellement, qu’ils le veuillent ou non. Mais il est alors tout à fait paradoxal que, passant de la théorie à la pratique, cette perspective des privilèges semble souvent avoir pour principal enjeu pratique et forme d’action politique la prise de conscience par auto-réflexion, la déclaration performative de sa position, de ses attributs sociaux et de ses capitaux (économiques, culturels, sociaux, symboliques, etc.) et l’auto-abandon des privilèges de la part des individus appartenant aux groupes dominants. Il nous semble ici encore nécessaire de diagnostiquer un ensemble de limites du paradigme des privilèges, et particulièrement dans les pratiques dites du privilege checking et de l’auto-abandon des privilèges par les privilégié·es.
Idéalisme : D’après Elsa Dorlin, il y a dans la notion de privilège une tendance à penser « que l’on pourrait renoncer à son privilège, dans l’intimité d’une prise de conscience individuelle : ce qui invisibilise totalement la dimension sociale et politique, institutionnalisée du pouvoir »[24]. Or, outre cette invisibilisation sur laquelle on reviendra dans un instant, à suivre la théorie même du privilège comme avantage non mérité et inconscient, on peut bien se demander ce qu’un supplément de conscience pourrait bien changer, puisque les individus ne cesseront pas de profiter collectivement et structurellement de ces privilèges qui par définition n’ont jamais requis de collaboration active et consciente de leur part[25]. Si les privilèges sont définis comme des avantages sociaux inconscients tirés de rapports de domination matériels et symboliques entre groupes à l’échelle systémique, c’est une conséquence à la fois valide logiquement mais politiquement discutable et profondément idéaliste, que de considérer qu’en prenant conscience de ses privilèges, c’est-à-dire en en faisant, d’avantages inconscients, des avantages conscients, on les supprime de facto comme privilèges[26]. C’est à tout le moins opérer une sorte de renversement de la notion dont l’intérêt principal repose au contraire sur le caractère systémique de la domination qui rend au final sans importance la question de l’inconscience et de la prise de conscience.
Réification des rapports de pouvoir : La perspective des privilèges tend à considérer les privilèges comme des ressources quantifiables, dont la distribution entre les groupes sociaux dominés et dominants définit un jeu à somme nulle. McIntosh parle ainsi des « avantages dont bénéficient les hommes en raison des désavantages qui affectent les femmes » ; ou encore du fait que « en proportion de la mesure dans laquelle mon groupe racial était rendu confiant, confortable et inconscient, d’autres groupes étaient rendus également peu confiants, inconfortables et aliénés » [27]. Plus récemment, Betel Mabille écrit dans le même sens : « il est impossible en tant que personne blanche de lutter contre le racisme sans devoir se séparer d’un certain nombre de ses privilèges. C’est le principe de la balance, s’il y a plus d’un côté il faut partager pour arriver à un équilibre »[28]. Il ne s’agit certes pas de revenir sur ce que nous disions plus haut : qu’il y ait des dominé·es implique bien qu’il y ait des dominant·es qui tirent quelque forme de « profit » de leur domination. Mais cela n’implique pas que ce « profit » ou cet « avantage » soit adéquatement représentable en termes quantifiables de ressources concrètes et tangibles qu’une personne possède et que donc une autre ne possède pas. Il y a là une conception réifiante ou substantialiste du pouvoir, qui consiste à considérer le pouvoir comme une chose que l’on possède ou non, réduit « à une simple ressource, à un attribut pouvant être possédé »[29] ,plutôt que comme quelque chose que l’on exerce sur quelqu’un dans un rapport, dans une relation plus ou moins antagonique et conflictuelle, ouvrant un champ de possibilités en termes de résistances stratégiques, de resignification de la norme dominante et de contre-conduites[30]. Comme l’écrit Elsa Dorlin :
Le concept de privilège renvoie d’abord à quelque chose que l’on possède – par héritage, par naissance, par mérite – quelque chose que l’on transmet, quelque chose qui peut être aboli, auquel on peut renoncer. Analyser ainsi la domination est problématique, dans la mesure où cela ne permet pas de comprendre la nature fondamentalement relationnelle, antagonique du pouvoir : il n’y a pas d’un côté ceux qui le possèdent et, de l’autre, ceux qui en sont dépourvus[31].
Il serait intéressant de retracer l’histoire et les modalités de la reprise militante du vocabulaire bourdieusien des différents « capitaux » (économiques, culturels, symboliques, etc.) qui a pu contribuer à cette lecture réifiante des rapports de pouvoir, dans une réinterprétation tombant en réalité en-deçà de certains acquis et apports essentiels de la sociologie de Bourdieu. Il faudrait ainsi commencer par rappeler que la notion de capital, chez Marx comme chez Bourdieu, se définit en réalité comme un rapport social (et, à ce titre, présuppose déjà toute une distribution structurelle des individus et groupes au sein des rapports de classes, de propriété et de travail) et non pas comme une simple « somme d’argent », ni comme quelque autre forme de « chose » – ce qui semble parfois oublié dans les usages de la notion au sein du secteur associatif et militant. Usages à rebours desquels on pourrait chercher chez Bourdieu une approche qui consiste à situer la lutte politique au niveau de la transformation des mécanismes structuraux qui produisent la hiérarchisation d’un champ social par l’établissement des normes de légitimité de ce qui vaut et de ce qui compte, et non au niveau d’une politique de « redistribution » (ou, a fortiori, de self-destitution individuelle et volontaire) des capitaux et de lutte contre les discriminations qui serait pensée au profit d’une sorte d’« égalité des chances » dans un champ au sein duquel on aurait soigneusement conservé le partage légitime de ce qui vaut, de ce qui compte. Bourdieu ne nous invite-t-il pas à voir qu’il ne s’agit pas, dans les luttes émancipatrices, de simplement (re)distribuer les capitaux, mais de contester et faire valoir d’autres normes de ce qui peut « valoir » socialement et donc prendre la forme d’un « capital » (si l’on souhaite conserver ce terme)[32] ?
Dans le même sens, la sociologue Kaoutar Harchi réfute la possibilité de proposer une sorte de politique de « redistribution » des privilèges conçus comme des ressources :
La réduction des rapports sociaux de pouvoir à un régime de ressources possédées par les uns — et donc à l’origine de la dépossession subie par les autres — confine effectivement à croire que des choses attribuées de telle manière devraient l’être de telle autre. De là découlerait une injustice qu’il conviendrait de réparer par la transformation des modalités originelles d’attribution. Mais comment redistribuer la valeur du travail bien fait en situation de blanchité quand, dans d’autres situations, le travail n’est jamais qu’arabe ? Importe-t-il de redistribuer la valeur construite de la beauté féminine blanche afin que les cheveux à la frisure serrée des femmes racisées cessent d’être associés à la sauvagerie et à la laideur ? Comment redistribuer la valeur sociale et politique des vies blanches quand celles, non-blanches, sont perçues comme un ensemble informe de vécus interchangeables et traités comme de moindre importance ? Comme le suggère la militante communiste, féministe et antiraciste Mélusine, « parler des choses qu’on a, et non des choses qu’on est, empêche de remettre en question l’existence même des catégories ». Pourtant source primordiale des violences[33].
Dans le même sens encore, contre la métaphore de McIntosh qui représente dans son article de 1989 le privilège blanc comme un « sac à dos invisible » et sans poids qui serait rempli de provisions, de cartes, de passeports, de livres de codes, de visas, de vêtements, d’outils et de chèques en blanc qui ne cesseront d’aider les privilégié·es au long de leur vie, Ladelle McWhorter écrit :
La plupart des avantages les plus importants ne sont pas du tout des choses […]. Par exemple, avoir développé ses os et son cerveau dans une maison ou un appartement dans une partie du monde relativement dépourvue de substances toxiques comme le plomb ou le mercure, avoir grandi avec des adultes cultivés qui avaient le loisir de nourrir des intérêts intellectuels, artistiques ou politiques, avoir développé une personnalité dans une société dans laquelle les autres, même les plus étrangers, considèrent clairement que notre vie est précieuse et que notre souffrance est un malheur. Ces exemples, et de nombreux autres « privilèges blancs » ne sont pas des choses que nous, qui avons la chance de les avoir eues, pouvons abandonner, pour la simple et bonne raison que ces choses sont désormais nous – nos corps, nos psychés, nos intellects, notre confiance en soi. Et ce qui est injuste n’est pas que nous ayons eu ces choses ; c’est que de nombreux autres que nous n’ont pas eu et n’auront pas ces choses, à moins que quelque chose de drastique soit fait[34].
C’est alors la perspective pratique d’une fin des dominations par l’abandon (to give up) et la cession (divestiture) des privilèges qui devient profondément problématique, parce que les privilèges ne sont pas « quelque chose » que l’on peut effectivement donner, transférer ou même simplement « laisser tomber »[35]. Zachary Casey écrit dans le même sens à propos du privilège blanc :
La blanchité (whiteness) n’est pas quelque chose que les individus blancs sont capables de manipuler. […] Indépendamment de la croyance ou de l’intention, les Blancs sont eux-mêmes pris dans les logiques culturelles, les discours de pouvoir, les signes et les cadres de la domination présents dans l’édifice phénotypique de la blanchité. Toutes ces choses font des actions individuelles pour “se débarrasser de sa blanchité” (to “rid one’s self of whiteness”) quelque chose de tout à fait impossible parce que la blanchité n’existe pas sur le corps individuel mais sur le corps collectif des personnes blanches, composant un groupe culturel et racial mobile et complexe[36].
Le « corps collectif » des Blanch·es ne désigne pas ici la simple somme des corps individuels blancs, mais renvoie à l’existence d’un groupe social défini par une position et des intérêts au sein de la structure des rapports sociaux de race. Or, en raison du caractère global, collectif et « impersonnel » de ces rapports sociaux, personne ne peut simplement décider de se défaire de ses privilèges.
Centration sur la perspective des dominants : L’autre aspect par lequel la pratique de l’abandon des privilèges pose problème tient au fait qu’il s’agit d’un auto-abandon de ces privilèges par les dominants eux-mêmes. En résulte une étrange focalisation sur la perspective et le rôle des dominant·e·s dans la lutte contre la domination. À rebours de tous les mots d’ordre historiques d’une émancipation (de classe, de race, de genre, de sexualités, etc.) qui ne peut être faite que par et pour les dominé·e·s, cette conception met de facto les dominant·e·s en position d’être les acteurs principaux de l’émancipation des domin·é·s.
La réification du pouvoir prend du même coup un second sens, à savoir : figer les positions, et tendre à présenter les groupes dominés comme les purs perdants, objets passifs du pouvoir et définis par le manque de ce qu’ils n’ont pas – c’est-à-dire uniquement à la lumière de la norme dominante et de leur éloignement vis-à-vis de celle-ci. Véronique Clette-Gakuba écrit en ce sens :
Il n’est pas difficile de sentir que le concept de “privilège blanc” provient d’un milieu social éloigné de la réalité des mondes noirs. Depuis son prisme, l’existence noire est comprise par la négative, par le manque, par l’absence de ce qui, à l’inverse, comble les vies blanches. Il faut à cette théorie une comparaison presque comptable, qui ramène tout à soi, pour arriver à cerner les affres des vies noires. Premier problème donc : la normativité au centre de la théorie des privilèges est blanche et, de ce fait, sa perspective critique tend vers un modèle intégrationniste (promotion d’un alignement sur les privilèges blancs positifs). Cette épistémologie comptable de la blancheur/noirceur n’appréhende rien sur le mode actif, situé, de ce qui fait la race, de ce que la race fait faire[37].
Moralisme : Cette marginalisation du point de vue des subalternes au profit d’une centration sur les dominants est profondément liée à une appréhension morale de ces questions politiques, dans les catégories de la culpabilité et de l’innocence. Toujours selon Clette-Gakuba :
Dans le fait d’énoncer ses privilèges, de vouloir y renoncer un à un, ne réside rien comme réelle force propositionnelle. Ressort plutôt l’impression que, derrière leur énumération, agit un fort sentiment de culpabilité (« des avantages non mérités » [selon la très méritocratique définition de McIntosh, NdA (Jean Matthys)]) assorti d’un manque d’imagination politique quant à la question du « que faire ? ». Très souvent, ce sont les mêmes quelques privilèges qui sont pointés et tout l’enjeu devient obstinément de les citer […] [S]i l’horizon politique est […] celui de la bonne utilisation de ses privilèges (de veiller à la bonne utilisation que les Blancs font de leurs privilèges), force est de se demander si l’on n’est pas en train de glisser vers des préoccupations égocentriques blanches (être un bon allié n’ayant rien à se reprocher, en réponse à la fragilité blanche) »[38].
Il y aurait ainsi un lien essentiel entre le fait de penser les dominations à partir de la notion de privilèges, de continuer à penser du point de vue des dominants, de rejeter le point de vue des subalternes dans le néant et le non-être d’un contre-champ invisible passif et sans consistance propre, et de focaliser les perspectives de l’action politique immédiate sur des questions de positionnement (inter)individuel et moral à des fins de déculpabilisation des dominants « conscients » et « déconstruits ». Selon Sara Ahmed, la déclaration honteuse de ses privilèges devient une performance et une reproduction de ces mêmes privilèges, puisqu’à travers cet aveu honteux, le sujet privilégié atteste de ses bonnes intentions morales, et donc de son innocence, inséparable de l’aveu interminable de sa culpabilité. La culpabilité et l’innocence forment un cercle du vice et de la vertu : la culpabilité autant que le fait de se sentir bien et fier de sa culpabilité sont une performance des privilèges plutôt que leur destitution. La quête d’innocence requiert l’énonciation interminable de sa culpabilité, parce que la honte vécue, déclarée et affichée permet de s’innocenter et de « se sentir mieux », indépendamment de toute transformation effective de ce qui est honteux (la réalité de la domination)[39].
Il faudrait interroger ici ce qu’il en est de l’aspect psychique et désirant des dominant·e·s, en ce compris lorsqu’ils entrent dans un processus de « déconstruction » : n’y a-t-il pas dans la déclaration litanique de ses privilèges une manière, entre narcissisme et masochisme, d’encore jouir de ses privilèges, et d’y tenir ? Sara Ahmed donne des indications en ce sens, en pointant la manière dont la domination se reproduit encore à travers la figure du sujet blanc inquiet de sa propre inquiétude, anxieux « devant les effets qu’il produit sur les autres », et empli de la crainte « de contribuer à priver les autres de quelque chose »[40]. Et n’est-il pas alors nécessaire de penser la forme d’un agencement collectif qui puisse œuvrer à la transformation de ce désir qui, sinon, a toutes les chances de se reproduire indéfiniment sous la forme d’un désir de dominer jusques et y compris dans les tentatives de lutte contre sa propre domination ? (C’est vers cette dimension d’organisation collective que nous nous tournerons dans notre conclusion.)
Individualisme : Arielle Iniko Newton, essayiste et co-organisatrice de Movement for Black Lives a déclaré que « Le privilège est une notion limitante qui accorde la priorité aux comportements individuels au détriment des failles du système, et suggère que changer nos comportements serait une manière suffisante d’éradiquer l’oppression »[40]. McIntosh elle-même reconnaît les limites de cette responsabilisation individuelle portée par la notion de privilège :
La désapprobation du système ne suffira pas à les faire changer. J’ai été amenée à penser que le racisme pourrait finir si les individus blancs changeaient leur attitude. Mais une peau « blanche » aux États-Unis ouvre tant de portes pour les blancs et ce peu importe que nous approuvions ou non la façon dont la domination nous a été conférée. Les actes individuels peuvent pallier mais non arrêter ces problèmes[41].
Selon Ina Kerner, il y a dans cette approche individualisante à la fois une manière pour les dominants qui luttent de se donner de façon illusoire un pouvoir d’action individuel sur les structures, les processus et rapports sociaux qu’ils n’ont, à titre individuel, tout simplement pas ; et d’autre part, une manière elle-même typiquement privilégiée et dominante de surévaluer la centralité de leur point de vue ainsi que leurs capacités subjectives de peser directement sur les processus de transformation sociale à partir de leur propre conscience et volonté (de pureté) morale. Il y a là une confusion portant sur la nature du rapport existant entre domination individuelle et domination structurelle, « fondée sur l’idée que l’individu est responsable des formes d’injustices systémiques » et qu’il s’agit pour les dominants de changer leur propre manière de penser pour abolir la domination. À travers cette confusion, les individus dominants s’attribuent une sorte de pouvoir d’action sur les processus sociétaux dont en réalité ils ne disposent pas, et essayent d’acquérir une pureté morale, à l’aide de mesures d’ordre avant tout psychologique[42]. L’idéalisme serait en ce sens la philosophie ou vision du monde typique des groupes dominants et privilégiés[43]. Elsa Dorlin explicite encore davantage ce nœud :
Le « blanc » désigne plutôt le fait de jouir de ce que l’on pourrait appeler une certaine « transparence sociale ». Cette transparence sociale suppose que l’on n’a pas à endosser de marque infâmante, quelle qu’elle soit (couleur, voile, accent, patronyme…), et qui donne en effet le privilège d’être socialement interpellé comme une personne, plutôt que comme un individu métonymique – constamment ramené à un prétendu groupe, une entité, altérisé, minorisé. Or, c’est précisément le fait de bénéficier d’une forme d’interpellation individualisante (le fait d’être désigné par des caractéristique idiosyncrasiques [relevant de la singularité personnelle, NdA (Jean Matthys)] et non par des traits stéréotypiques, comme le « sexe », la couleur, la religion…), qui a pour conséquence une individualisation et une psychologisation à outrance des dispositifs de lutte contre le racisme. En effet, tout se passe comme si la solution au racisme résidait dans une auto-réflexion sur ses privilèges. Il ne se suffit pas de « se poser » comme, ou de se déclarer, « BlancHE », « bourgeoisE », « hétérosexuelLE », pour en finir avec l’exercice contesté, incriminé, d’un pouvoir[44].
Un certain idéalisme individualiste présent dans la pratique de l’auto-réflexion et dans l’idéal de l’auto-abandon des privilèges de la part des dominants constituerait ainsi précisément un effet typique et non interrogé de ces mêmes privilèges. On pourrait parler ici d’une forme de contradiction performative de la théorie des privilèges, sous la forme d’une contradiction entre d’une part ce qu’elle décrit et explique en tant que théorie, et d’autre part ce qu’elle tend à promouvoir comme type de pratiques (micro)politiques (inter-)individuelles et morales : car cette théorie permet précisément de rendre compte du fait qu’il est typique de la part des individus privilégiés de considérer que la solution à la domination réside dans leur propre auto-réflexion et la simple déclaration de leurs privilèges[45]. Cette contradiction se donne d’ailleurs à voir dans le fait que McIntosh elle-même indique à juste titre dans son article de 1989 que l’éducation des privilégié·es les détermine à se percevoir précisément chacun et chacune comme un « individu dont l’état moral dépend de la volonté morale individuelle »[46].
Mais alors, la perspective de lutte contre les privilèges tend à pratiquement recouvrir la dimension systémique et structurelle des dominations qu’elle permettait pourtant théoriquement de mettre au jour :
la dimension structurelle du racisme semble souvent se traduire exclusivement dans des interactions et des dispositions personnelles ; par conséquent, l’auto-réflexion critique de la part des Blancs et les interactions équitables et efficaces qui auraient lieu de manière personnelle et quotidienne entre les Blancs et les Noirs sont considérées comme étant déjà la solution aux problème de racisme […] [L]e racisme est réduit à des perceptions, des mentalités, des émotions et à l’interaction entre les personnes ; il est présumé que si les personnes blanches arrivent à se débarrasser des stéréotypes et des peurs qu’elles projettent sur les autres, c’est-à-dire sur les personnes qu’elles considèrent comme différentes d’elles-mêmes, le racisme cesserait d’exister[47].
Kerner précise l’intention de sa critique : « je ne cherche pas à remettre en cause le fait que ce genre de pratiques sont importantes et qu’elles peuvent être efficaces ; mais ce que je voudrais souligner c’est que les choses pourraient malheureusement être plus compliquées »[48]. En effet, poursuit-elle, si l’on se donne un concept moins individualisé et plus structurel des dominations, « il devient évident que ces formes d’injustices ne peuvent être déconstruites par le simple fait de les rendre visibles et par les efforts personnels de partage qui peuvent résulter de cette visibilité. Déconstruire cette injustice nécessite plutôt un changement sociétal d’une plus grande ampleur, un changement qui aurait des répercussions sur les institutions, les modèles sociétaux de pensée et de représentation ainsi que les mentalités individuelles »[49]. L’auto-réflexion des dominants ne peut constituer ni le dernier mot, ni l’objectif politique principal des luttes contre les dominations. C’est que les luttes d’émancipation ne peuvent pas reposer uniquement sur ce qui prend parfois, selon l’expression provocatrice de Joao Gabriel, l’aspect d’une « forme politisée de développement personnel » et de « militantisme-performance déclaratif »[50].
Penser structurellement pour repolitiser la lutte contre les dominations
Dans une critique radicale de la notion de privilège blanc, dont elle lie la popularité avec le déploiement du néolibéralisme jusque dans les subjectivités et pratiques militantes, Kaoutar Harchi pointe ce qui fait souvent défaut dans cette approche, à savoir la perspective de l’action collective et de l’organisation.
Le recours intensif au concept de « privilège blanc » signe l’avancement sinueux du néolibéralisme jusqu’au cœur des pratiques politiques de résistance. Il individualise la question politique raciale et, de là, la dépolitise. Plus encore : ce sont les possibilités d’émancipation des groupes dominés que l’on indexe et conditionne, paradoxalement, au bon vouloir autocritique des groupes dominants. Comme il importe de travailler à une société sans classe — entendre sans domination de la classe capitaliste sur le reste de la société —, il importe de travailler à l’édification d’un monde libéré des catégories sociales de race. Cela, seules l’organisation, la mobilisation et l’action collectives le permettront[51].
Il ne peut s’agir selon nous de dire qu’une pratique du privilege checking et de déconstruction individuelle n’est pas souhaitable dans l’absolu ; mais il s’agit d’en délimiter la valeur et le champ d’effectivité, que l’on pourrait situer au niveau d’une forme de morale ou d’éthique individuelle, voire de discipline de groupe (notion désuète qui prêtera à sourire mais qui n’est peut-être pas entièrement absente de la très actuelle recherche d’espaces safe[52]), jouant le rôle d’un moyen dans la lutte, mais ne constituant pas une fin en soi. Il s’agit en somme de dire que cette approche ne peut pas constituer le tout de l’action et de la pensée politique, et particulièrement ne devrait pas prendre la place d’une réflexion sur les stratégies proprement collectives et politiques de transformation des rapports sociaux qui, qu’on le veuille ou non, ne se réduisent pas à une somme de comportements individuels, et ne changent pas par la seule accumulation quantitative de changements individuels[53].
De ce point de vue, la question « “checker les privilèges” ou renverser l’ordre ? »[54] est une fausse alternative. Si l’on pose la question comme suit : faut-il lutter contre les discriminations et les privilèges en invitant les personnes à se « déconstruire », voire, dans l’optique de la lutte anti-discrimination, en les déconstruisant à coup de sensibilisation, d’injonctions morales ou de condamnation judiciaire, ou faut-il plutôt mettre à bas les institutions et structures qui produisent et reproduisent des inégalités systémiques entre groupes sociaux ? on peut dans un premier temps répondre que l’on n’a pas à choisir, car ces deux formes d’actions ne sont pas en soi mutuellement exclusives.
Cependant, une version particulière de cette réponse mérite d’être considérée avec plus de circonspection, en investiguant, une fois encore, la théorie sociale qui en constitue l’arrière-fond théorique. En effet, l’une des manières de résoudre cette alternative consiste à dire : commençons par la déconstruction individuelle et représentationnelle des privilèges et des préjugés qui causent la discrimination, et à force de s’étendre de proche en proche, sur le mode de la « tache d’huile », cela finira par transformer la société au niveau systémique. Cette thèse va parfois, on l’a vu, jusqu’à impliquer que la déconstruction individuelle est en soi une condition nécessaire et suffisante à la transformation sociale. Or, cela repose, une fois encore, sur une certaine idée de ce qu’est une société, ainsi que sur une représentation individualisante du moteur et des causes de la transformation sociale.
On pourrait tout d’abord pointer avec Danièle Kergoat qu’il y a là une confusion entre deux manières de saisir le social dans sa réalité relationnelle : à savoir d’un côté les relations sociales (immanentes aux individus concrets entre lesquels elles apparaissent) et d’autre part les rapports sociaux (abstraits, non observables empiriquement comme tels, en tant qu’ils opposent des groupes sociaux définis par une lutte antagonique autour d’un enjeu, définissant un rapport de production matérielle et idéelle[55]). Si l’on s’en tient à la surface empirique des relations sociales, alors la lecture discrimination/privilèges semble évidente ; or une autre voie est possible, mais qui requiert de passer par une forme d’abstraction théorique. Il s’agit alors d’à la fois « s’élever » au-dessus des rapports interindividuels pour penser les rapports entre classes sociales, leurs fonctions dans la reproduction matérielle et idéologique de la société, au niveau d’une forme de totalité sociale ; mais aussi de « descendre » dans les profondeurs des inconscients qui constituent une sorte de scène cachée où les rapports sociaux déterminent les comportements individuels en-deçà de ce dont ils ont conscience (en termes de représentations et d’objectifs) et de ce dont ils ont la maîtrise (en termes de volonté et de capacité d’action). En effet, selon Luc Boltanski, héritier de la pensée de Pierre Bourdieu, penser une domination depuis une perspective critique implique toujours d’opérer ce double mouvement consistant à 1) s’élever au point de vue systémique de la « totalité sociale » et des structures, à partir d’où seulement il est possible de saisir dans leur efficacité et leur contingence, voire leur arbitraire, les « cadres » des rapports sociaux déterminant nos actions et pensées – cadres qui, vus de l’intérieur, apparaissent comme l’horizon naturel des choses, c’est-à-dire n’apparaissent pas en tant que cadres transformables ; et 2) poser l’existence de quelque dimension inconsciente de la domination, en tout cas irréductible à la seule surface consciente des représentations, mobiles et actions volontaires des agents sociaux[56].
Il importe donc de produire cet autre point de vue, que l’on peut qualifier de proprement critique, au double sens d’une critique des dominations sociales et d’une critique des formes de conscience immédiate des acteurs sociaux, requérant la production d’un discours théorique distinct des représentations conscientes et autres formes d’évidences quotidiennes qui occultent, par la clarté éblouissante de leur évidence même, les mécanismes de la reproduction sociale de la domination. Or, à partir de ce point de vue, on pourrait soutenir une conception de la société et un schème de causalité de transformation sociale inverses à celles de l’individualisme que l’on a diagnostiqué dans la lutte idéaliste contre les discriminations et les privilèges : à savoir justement que le social n’est pas composé par une somme d’individus ou d’(inter)actions individuelles, mais qu’il « existe » quelque chose comme des structures et des rapports sociaux de domination (de classe, de genre, de race, de sexualité) qui, quoique n’étant pas empiriquement visibles (et en partie justement parce qu’ils ne sont pas directement accessibles à la perception immédiate), déterminent les intérêts, les comportements et les représentations des agents et des groupes sociaux ; et que par conséquent, ce n’est pas la somme d’actions individuelles qui peut causer la reproduction ou la transformation « systémique » de la société, mais c’est au contraire les rapports sociaux, leur complexité, leur intrication, leurs contradictions internes et externes, leurs différentes tendances, leurs dynamiques multiples, etc., qui produisent les comportements et représentations individuelles et de groupes correspondant à leur situation dans ces rapports – et leurs éventuelles potentialités de subversion, car ces rapports sont intrinsèquement complexes, contradictoires et dynamiques. Mais en tout cas jamais les individus n’agissent comme des sujets libres et autonomes, dans un vide social, comme indéterminés. Si un individu ou un groupe se trouve à penser ou agir dans un sens qui n’est pas celui qui semblerait adéquat à sa position sociale, cela ne requiert pas de faire appel à un libre-arbitre, à une forme de volonté indéterminée, ou à une capacité subjective de prendre conscience et de se convertir à la Vérité, mais plutôt de saisir en quoi cette situation de transformation ou de non-reproduction met en jeu une surdétermination, c’est-à-dire un surcroît de déterminations, plutôt qu’une indétermination qui ferait la toile de fond blanche sur laquelle un libre arbitre pose souverainement ses choix. Dans une telle perspective, il ne s’agit plus de dire simplement « corrigeons nos préjugés, checkons et abandonnons nos privilèges, déconstruisons-nous individuellement, et si nous sommes suffisamment nombreux à nous déconstruire tout seuls, non seulement nous changerons le monde, mais nous aurons en fait déjà changé le monde » ; on pourrait plutôt soutenir à l’inverse, selon une formule qu’Étienne Balibar a utilisée pour caractériser le projet et la politique communistes, qu’il s’agit de transformer le monde afin de nous transformer nous-mêmes[57].
Conclusion. Conscience et militance, conversion et organisation
Mais cela ne nous fait pas sortir du cercle vicieux : comment transformer le monde si l’on ne s’est pas déjà transformé individuellement, ou à tout le moins déterminé à œuvrer dans le sens d’une telle transformation ? C’est ici la question de l’organisation politique qui peut selon nous venir dépasser le vis-à-vis stérile entre le sujet et le monde, l’individu et la société ; et c’est dans l’espace de cet entre-deux que doit s’inscrire l’organisation collective d’un « travail » des subjectivités qui est selon nous à la fois appelé et occulté par les approches individualisantes des discriminations et privilèges. C’est cette dimension que l’on souhaiterait ici interroger au titre de conclusion programmatique de cette étude.
Si l’on ne peut qu’être d’accord avec l’idée qu’une transformation des rapports sociaux s’accompagne le plus souvent (quoique non mécaniquement) d’une transformation subjective de ses acteurs au cours même de leur action, on ne peut en revanche mettre ce qui apparaît comme une « conversion » préalable de chacune et chacun à l’origine des luttes collectives. À ce titre, on pourrait dire que la perspective de l’auto-abandon des privilèges apparaît en réalité à la fois trop simple et déraisonnablement exigeante ; trop simple, parce que, comme le pointent Kerner et Harchi, elle occulte le long et difficile travail collectif d’organisation et de transformation des institutions politiques, économiques, matérielles et symboliques ; mais aussi bien déraisonnablement exigeante dans la mesure où elle attend des individus d’opérer une véritable « conversion » subjective à rebours des déterminations sociales qui pèsent sur eux. Or une telle conversion ne peut être qu’un événement par définition statistiquement rare, et ne peut comme tel prendre une ampleur de masse, du moins si l’on n’en interroge pas les conditions matérielles et organisationnelles, ainsi que les lieux et les « supports » collectifs plus ou moins institutionnalisés qui peuvent être considérés comme la condition préalable et nécessaire à toute transformation subjective. On ne fait pas de la politique (uniquement) avec des individus héroïques.
Nous voudrions suggérer ici que c’est précisément parce qu’on ne voit pas ou plus très bien comment transformer les structures, ni même ce que cela peut vouloir dire, que par défaut, la politique est rabattue sur le plan de la transformation de soi sur le plan représentationnel et à une échelle individuelle ou micro-politique. Faute de pouvoir articuler stratégiquement au niveau des représentations collectives et des institutions de lutte quelque chose comme un projet orienté et organisé de transformation radicale et conséquente des rapports sociaux, la tentation est grande de se raconter qu’une somme de micro-transformations individuelles s’agrège en transformation systémique ou structurelle. L’idéalisme et l’individualisme que nous avons diagnostiqués au long de cette étude trouvent ici leur cause et leur sens véritable. Comme l’écrivait récemment Fania Noël du collectif afroféministe Mwasi :
Les pièges tendus par la « ruse de la pensée dominante » sont difficiles à éviter lorsque le sentiment d’impuissance individuelle face aux discriminations et la faiblesse politique collective sont des réalités quotidiennes. Dans cette situation reste l’attachement à la sémantique, au pouvoir de nommer et de dire, mais cette première étape libératrice, en étant érigée comme seul horizon politique, se transforme en cul-de-sac :
– déclaratif : militer contre tout revient à avoir une déclaration sur tout ;
– performatif : centraliser la question de la reconnaissance des privilèges comme acte préexistant l’organisation ou l’interaction collective[58].
Ce rapport singulier entre une forme de militance déclarative et l’impuissance relative, voire la démoralisation des mouvements émancipateurs dans la conjoncture actuelle, devrait selon nous être étudiée de manière plus approfondie, en se concentrant notamment sur la place et le rôle qu’occupent les savoirs et signifiants issus de la recherche universitaire critique dans les subjectivations militantes.
Il y aurait en effet tout un travail d’enquête à mener autour de la forme particulière que prend le rapport entre le savoir, le sujet et l’émancipation dans les subjectivités et groupes militants contemporains. À titre d’hypothèse volontairement schématique et quelque peu provocatrice, on voudrait conclure en suggérant que ce rapport prend souvent la forme d’une identification et d’une soumission dogmatique à une certaine vérité théorique – identification rendue possible par une homogénéité forte, sinon une forme d’identité pure et simple entre le milieu académique producteur de théories critiques et certains milieux militants où circulent essentiellement des signifiants critiques construits à l’université (ou dans ses marges immédiates). La tentation d’une approche idéaliste, individualisante et morale des dominations reposerait alors sur l’absence de réflexion sur les conditions organisationnelles et institutionnelles d’une éventuelle opérationnalisation pratique d’intuitions théoriques dont l’efficacité politique hors des milieux intellectuels ne peut être actualisée par leur simple répétition litanique dans des performances déclaratives[59]. De plus, si les conditions de circulation quasi immédiate de ces signifiants reposent sur l’homogénéité sociologique, voire l’identité pure et simple entre certains sujets-militants et certains sujets académiques, c’est alors la question de la possibilité d’une extension à l’échelle proprement politique des « masses » de ces transformations subjectives qui semble hypothéquée, tant elle impliquerait de pouvoir reposer la question d’une organisation de masse comme support d’élaboration et de « travail » collectif sur et par les subjectivités, et non ce jeu de miroir, en face-à-face ou en identité plus ou moins immédiate entre des sujets-militants et un savoir universitaire supposé lui-même pouvoir provoquer et garantir des transformations subjectives qui restent en fin de compte des formes de conversions individuelles à l’aune de la Lumière de la Théorie – ce qui, au vu des déterminations structurelles, ne peut être que le fait d’individus statistiquement exceptionnels.
Il y aurait ainsi dans la pratique de lutte contre les discriminations et les privilèges une espèce de solidarité dialectique et paradoxale entre d’une part un spontanéisme, en ce qu’on suppose que les individus sont (ou devraient être) immédiatement et toujours déjà capables de se transformer subjectivement d’une manière conforme à l’émancipation à laquelle ils aspirent (en corrigeant leurs préjugés, en se dessaisissant de leurs privilèges), et d’autre part une forme de pédagogisme voire d’élitisme scientiste, où l’émancipation consiste à intérioriser et répéter ce qui est énoncé par certains milieux académiques critiques. D’où que l’on pourra d’un côté comme de l’autre (d’autant plus lorsqu’il s’agit des mêmes personnes, ou du moins de milieux tout à fait poreux) réciter la théorie critique comme un mantra, une révélation qui serait supposée se réaliser à force d’être incantée verbalement : où se rejoignent le volontarisme qui suppose donnée la capacité politique des acteurs (au lieu de poser la question de la construction collective d’une telle puissance politique), et le théoricisme qui suppose que la théorie détient la clé de l’émancipation, et peut suffire à elle seule à provoquer les transformations subjectives. On assiste ici au renvoi en jeu de miroir entre deux toutes-puissances idéalistes : toute-puissance de la théorie, et toute-puissance de la volonté morale des sujets de se déconstruire. Deux tentations de toute-puissance qui font en réalité corps avec des formes réelles d’impuissance et de rechutes dépressives, dans une oscillation qui caractérise souvent les cartographies idéologico-psychiques des subjectivités militantes contemporaines.
Ces constats et questions nous semblent particulièrement difficiles à poser, et a fortiori à penser aujourd’hui, et ce, pour des raisons historiques profondes. C’est que c’est la forme du parti qui, au XXe siècle, avait constitué la principale tentative de réponse à la question d’une forme d’organisation qui permette un travail collectif de transformation subjective de soi au cours de la lutte, tout en assurant que cette transformation soit accessible aux masses, c’est-à-dire en refusant la logique sectaire ou de la marginalité. Dans un monde idéologique où nous sommes nombreux·ses à vouloir défaire les effets des privilèges dans les luttes, mais où plus personne ne se réclame publiquement du marxisme-léninisme, c’est le spectre de Lénine qui rôde encore, au sens où, comme l’écrit Andrea Cavazzini, il est celui qui s’est efforcé de poser la nécessité d’un travail de remise en question des identités et des rôles sociaux donnés impliquant la transformation des rapports entre la classe intellectuelle et les classes subalternes.
La tâche de l’organisation politique revient finalement à créer des zones d’indistinction entre des groupes sociaux, des discours et des pratiques – des « contacts » où les identités constituées sont défaites et reconstruites, de manière à produire une certaine indécidabilité quant aux sujets qui possèdent effectivement le savoir et l’initiative : c’est la perspective d’un devenir-autre organisé, par lequel chacun se transforme en apprenant à user des forces et des capacités d’autrui, et la rencontre avec une altérité transformatrice permet à chacun de s’approprier sa propre puissance d’agir[60].
Le parti, la désormais caduque forme-parti d’avant-garde, devait être aussi cela : l’espace d’un travail collectif d’enquête et de transformation des subjectivités des individus en lutte[61]. Que la forme qu’a historiquement prise ce Parti affublé d’une majuscule nous donne toutes les raisons du monde de refuser de la ressusciter telle quelle, c’est une chose ; autre chose serait de refuser de voir que la nécessité d’un « devenir-autre organisé » insiste encore aujourd’hui, en souffrance d’une nouvelle forme à inventer. Si l’on parvient à échapper à la pente idéaliste et individualisante qu’elle tend à nous faire dévaler dans certaines de ses acceptions et usages tombés dans les « pièges de la ruse de la pensée dominante »[62], le principal mérite de la notion de privilège serait de nous amener à réaffronter cette question, pour en inventer de nouveaux espaces collectifs d’expérimentation.
- [1] Nous entendons par ce néologisme un mélange de correction cognitive de perceptions et représentations fausses supposées à l’origine des préjugés (comme on polit un verre optique pour en faire des lunettes « correctrices ») et de maintien de l’ordre par contrôle et répression juridico-étatique (policing, en anglais). La solidarité entre ces deux aspects sera développée plus loin dans la présente étude.
- [2] La dimension performative d’un discours consiste en sa capacité à faire ce qu’il dit en l’énonçant. Comme on le verra plus loin, la performance supposée être en jeu dans la déclaration de ses privilèges est celle d’une auto-abolition de ceux-ci par leur explicitation et leur visibilisation. Mais on verra plus loin que l’on peut au contraire caractériser ces actes d’énonciation par une forme de contradiction performative, de non-performativité ou encore de « performance malheureuse », tenant au fait que « les conditions ne sont pas réunies pour que de telles déclarations fassent ce qu’elles disent » (Ahmed Sara, « Déclarations de blanchité : la non-performativité de l’antiracisme », Mouvements, 14 décembre 2020, consulté le 03 mai 2022).
- [3] Ina Kerner synthétise le caractère inséparable de ces deux concepts par une formule qui frôle la tautologie : « le racisme privilégie ceux qui ne sont pas victime de sa discrimination » (Kerner Ina, « Les défis des Critical Whiteness Studies », in Dorlin Elsa (dir.), Sexe, race, classe, pour une épistémologie de la domination, Paris, PUF, 2009, p. 256). Peggy McIntosh écrit dans le même sens que son travail sur les privilèges « concerne les avantages non mérités, qui peuvent aussi être décrits comme le fait d’être préservé de la discrimination » (McIntosh Peggy, « Some Notes for Facilitators on Presenting My White Privilege Papers », 2010, consulté le 21 avril 2022)
- [4] Définition fournie par le CNRTL, consulté le 21 avril 2022.
- [5] Ibid.
- [6] Unia, « Discrimination : quelques précisions », consulté le 27 avril 2022.
- [7] Les cinq critères dits « raciaux » : prétendue race, couleur de peau, nationalité, ascendance (juive) et origine nationale ou ethnique ; le handicap ; les convictions philosophiques ou religieuses ; l’orientation sexuelle ; l’âge ; la fortune (autrement dit les ressources financières) ; l’état civil ; les convictions politiques ; les convictions syndicales ; l’état de santé ; les caractéristiques physiques ou génétiques ; la naissance ; l’origine sociale ; la composition de ménage. Il est à noter qu’Unia n’est pas compétent pour le critère du sexe/genre : la Belgique s’est dotée d’un organisme spécifique pour traiter les questions d’égalité entre les femmes et les hommes et les discriminations liées au sexe (y compris des personnes transgenres) : l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (Unia, « Quels sont les critères de discrimination ? », consulté le 27 avril 2022).
- [8] Ce point qui dépasse le cadre de la présente analyse mériterait d’être plus amplement développé. On se contentera de relever ici que le caractère générique et abstrait, déconnecté de toute réelle analyse sociale et historique des rapports sociaux existants, de la définition de la discrimination donnée par Unia est tel qu’il permet de penser la possibilité formelle d’une discrimination « classiste » envers une personne en raison de son appartenance à une classe sociale située en haut de l’échelle socio-économique, par exemple la noblesse (ce que Unia n’hésite pas à affirmer explicitement sur son site, à titre d’exemple de discrimination liée à « l’origine sociale ») ; de même qu’elle aboutit à une définition du racisme tout aussi formelle et abstraite qui permet de qualifier certains phénomènes inter-individuels de violence ou d’insulte comme relevant d’une forme de « racisme anti-blanc » – là aussi il y a un pas qu’Unia n’a pas hésité à franchir en se constituant partie civile dans le cadre d’un procès qui a conduit à la condamnation d’un individu pour, entre autres motifs, insultes racistes à l’égard d’une personne blanche (« Le racisme “anti-blancs” est-il un concept valide… ou dangereux ? », Le Soir, 22 juin 2019, consulté le 27 avril 2022). S’il ne semble y avoir là rien à redire du point de vue abstrait du droit qui, par définition, n’a jamais affaire qu’à des individus, c’est depuis une perspective sociologique que ce jugement pose question : comme le rappelle le sociologue Éric Fassin, « le racisme anti-Blancs n’existe pas pour les sciences sociales, ça n’a pas de sens » (Fassin Éric, « Le racisme anti-Blancs existe-t-il? », vidéo sur la chaîne YouTube France Culture, 9 octobre 2018, consulté le 27 avril 2022). Voir également la carte blanche signée par plusieurs universitaires et associations belges dénonçant l’abstraction du cadre d’analyse d’Unia ainsi que la faiblesse de ses solutions « pédagogiques », particulièrement visibles dans l’inaction de l’institut face à des manifestations « folkloriques » négrophobes et antisémites en Belgique : « Unia : un anti-racisme d’État qui pose problème », carte blanche publiée sur le site de Le Vif, 21 novembre 2019, consulté le 27 avril 2022).
- [9] Noiriel Gérard, « “Color blindness” et construction des identités dans l’espace public français », in Fassin Didier et Fassin Éric (dir.), De la question sociale à la question raciale ?, Paris, La Découverte, 2006, p. 175.
- [10] Pour se donner une idée des usages de ce concept et de l’écosystème dans lequel il fleurit, on pourra par exemple se référer au site de Class Action, organisation états-unienne qui propose des workshops, des formations et du consulting en vue de sensibiliser (« raise awareness ») les individus, collectivités et entreprises au « classisme » défini comme « le traitement différentiel basé sur la classe sociale ou la classe sociale supposée » (consulté le 25 avril 2022). L’organisation dit « imaginer et lutter en faveur d’un monde sans classisme » – notez bien : pas un monde sans classes sociales. Le problème du classisme semble ainsi consister dans ce supplément d’inégalité et d’injustice prenant la forme d’une discrimination (subjective et arbitraire) sur base d’inégalités (objectives) de classe qu’il ne s’agit apparemment pas de remettre en cause comme telles. Il faudrait faire un travail généalogique sur l’histoire et le contenu du cadre théorique et politique de cette notion de classism dont la substitution à celle, par exemple, de « lutte des classes » ayant pour horizon l’abolition des classes, n’est pas anodin au sein des référentiels théoriques et politiques de la gauche – et ce d’autant plus que la notion de classisme se voit aujourd’hui mobilisée au sein de certains milieux militants revendiquant par ailleurs une certaine forme de radicalité, notamment anticapitaliste, dans l’analyse critique des dominations. Avec Nancy Fraser, on pourrait diagnostiquer là l’imposition du cadre d’une politique de la reconnaissance culturelle à une problématique qui appelle en réalité avant tout une forme de transformation des rapports économiques en vue de la suppression des rapports d’exploitation. « En souscrivant réellement à une théorie “culturaliste” de la société contemporaine, les tenants de cette perspective supposent que la distribution inique est un simple effet secondaire du déni de reconnaissance. Pour eux, les inégalités économiques sont de simples expressions de hiérarchies culturelles, ce qui signifie que l’oppression de classe est un effet superstructurel de la dépréciation de l’identité prolétarienne (ou, comme on dit aux États-Unis, du classism) » (Fraser Nancy, Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, Paris, La Découverte, 2011, p. 76).
- [11] Si je devais me risquer à formuler une norme positive de justice opposable à l’état de domination, d’oppression et d’exploitation, je renverrais à deux énoncés proposés par le sociologue Erik Olin Wright : « Dans une société juste, toutes les personnes doivent avoir un accès peu ou prou égal aux moyens matériels et sociaux nécessaires pour vivre une vie épanouie » ; « Dans une société pleinement démocratique, toute personne a un accès peu ou prou égal aux moyens nécessaires pour participer de façon significative aux décisions sur les choses qui affectent sa vie » (Wright Erik Olin, Stratégies anticapitalistes pour le XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2020, p. 21 et p. 27). Sur l’idéal de justice comme principe de parité de participation, voir Fraser Nancy, op. cit., pp. 79-83 et pp. 120-125.
- [12] Federici Silvia, Le capitalisme patriarcal, Paris, La Fabrique, 2019 ; Delphy Christine ; L’ennemi principal. Tome 1 : Économie politique du patriarcat, Paris, Syllepse, 2013 ; Vogel Lise, Marxism and the Oppression of Women. Toward a Unitary Theory, Chicago, Haymarket, 2013 ; Robinson Cedric J., Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition, Chapel Hill & London, University of North Carolina Press, 2000 ; Balibar Étienne et Wallerstein Immanuel, Race, nation classe. Les identités ambiguës, Paris, La Découverte, 1988. Quant à la question de savoir comment et dans quelle mesure l’oppression des minorités de genre et de sexualité jouent un rôle directement fonctionnel au sein de l’économie capitaliste, nous nous permettons de renvoyer au débat passionnant entre Nancy Fraser et Judith Butler repris dans la revue Social Text en 1997 : Butler Judith, « Merely cultural », Social Text, n° 52/53, 1997, pp. 265-277 ; Fraser Nancy, « Heterosexism, Misrecognition, and Capitalism: A Response to Judith Butler », Social Text, n° 52/53, 1997, pp. 279-289.
- [13] Dans son texte déjà cité, Sara Ahmed critique le rapport Mcpherson de 1999, document officiel publié au Royaume-Uni reconnaissant pour la première fois la réalité du « racisme institutionnel », mais d’une manière qui continue à faire du racisme une forme de déviation et d’échec des institutions, au lieu de voir en quoi, dans un système social raciste, c’est en vertu de leur fonctionnement normal et « réussi » que les institutions produisent des actes et des représentations racistes (Ahmed Sara, op. cit.).
- [14] « Comment fonctionne la discrimination ? », vidéo sur la chaîne YouTube Unia, 23 avril 2019, consulté le 21 avril 2022.
- [15] Notons qu’une semblable psychologisation peut être impliquée lorsque l’on mobilise la catégorie de la « phobie » (xénophobie, homophobie, etc.) : tout en renvoyant à une malheureusement bien réelle dimension affective de répulsion à l’égard d’un groupe social catégorisé et infériorisé comme « autre » et « différent », certains usages de cette catégorie peuvent consister à renvoyer ces formes de domination à une abstraite « peur de l’Autre » plus ou moins naturelle et d’ainsi occulter les déterminants sociaux, politiques et historiques spécifiques qui sont à l’origine de cet affect qui n’a rien de naturel (Balibar Étienne, « Y a-t-il un néoracisme ? », in Balibar Étienne et Wallerstein Immanuel, op. cit.).
- [16] McWhorter Ladelle, « Racism and Responsibility », in Sullivan Shannon et Schmidt Dennis J., Difficulties of Ethical Life, New York, Fordham University Press, 2008, p. 149.
- [17] Nous faisons ici allusion à la thèse foucaldienne d’une réversibilité entre la subjectivation et l’assujettissement : être sujet des normes, c’est toujours à la fois y être soumis et être en position d’en jouer, de les infléchir, voire les transformer. Mais cette réversibilité peut toujours être lue dans les deux sens : là où l’analyse proposée par Ghaliya Djelloul dans le dossier du présent numéro insiste sur le fait qu’il existe toujours pour le sujet une puissance de résistance et de « desserrement » des normes au moment même où il y est soumis, nous soulignons au contraire ici combien la « liberté » du jeu d’appropriation des normes par le sujet est encore une manière pour le pouvoir de l’État de s’exercer, et ce d’autant plus efficacement qu’il s’exerce dès lors insensiblement, sous les apparences de l’autonomie.
- [18] Ahmed Sara, op. cit.
- [19] Bouamama Saïd, « Privilège », in Collectif Manouchian, Dictionnaire des dominations de sexe, de race, de classe, Paris, Syllepse, 2012, p. 285. Pour une analyse un peu plus poussée de l’histoire et de l’étymologie de la notion de privilège, voir Marion Nicolas, « Privilèges pour tous ! Du problème de l’orientation de la lutte », analyse ARC, 2019, consulté le 29 mars 2022.
- [20] McIntosh Peggy, « White Privilege : Unpacking the Invisible Knapsack », Peace and Freedom Magazine, July/August, 1989, pp. 10-12, consulté le 02 mai 2022.
- [21] Marion Nicolas, op. cit.
- [22] Sur cette dernière idée, voir l’analyse de Norman Ajari dans le dossier du présent numéro.
- [23] Marion Nicolas, op. cit.
- [24] Dorlin Elsa « Introduction. Vers une épistémologie des résistances », in Dorlin Elsa (dir.), op. cit., p. 13.
- [25] « De nombreuses façons, les lois, les structures sociales et les institutions dans la société occidentale ont fonctionné dans le sens de la perpétuation et la continuation des héritages historiques des inégalités raciales, avec ou sans l’intention des individus et des groupes dans la société. Par le seul fait de maintenir les structures, lois et normes sociales existantes, la société peut imposer des coûts sociaux, économiques et de santé sur les minorités raciales en empiétant sur leur bien-être et leur dignité humaine » (Elias Amanuel et Paradies Yin, « The Costs of Institutional Racism and its Ethical Implications for Healthcare », Journal of Bioethical Inquiry, n° 18, 2021, pp. 45-58, consulté le 02 mai 2022).
- [26] Sara Ahmed parle quant à elle d’un « fantasme de transcendance » – typique de la blanchité, on le verra – présent dans la conception « performative » de l’auto-abandon des privilèges par simple déclaration de ceux-ci. Ce fantasme consiste à s’imaginer que ce que l’on reconnaît dans la déclaration est par là même transcendé (dépassé, aboli) : « par exemple, si l’on dit que nous sommes racistes, alors nous ne sommes pas racistes, car les racistes ne savent pas qu’ils sont racistes », ou encore « si je vois la blanchité, alors je ne suis pas blanc, puisque les blancs ne voient pas leur blanchité » (Ahmed Sara, op. cit.). Ahmed va jusqu’à soutenir que ce fantasme de transcendance n’est pas simplement illusoire ou inefficace, mais qu’il est même politiquement contreproductif : non seulement les privilèges ne sont aucunement abolis ou suspendus par leur « déclaration », mais ils sont en réalité reproduits par cette déclaration même.
- [27] McIntosh, op. cit. C’est nous qui soulignons.
- [28] Mabille Betel, « Les allié·e·s de la lutte antiraciste : partie 1 », publication BePax, juin 2019, pp. 4-5, consulté le 02 mai 2022.
- [29] Kerner Ina, op. cit., p. 256.
- [30] Voir l’analyse de Ghaliya Djelloul dans le dossier du présent numéro.
- [31] Dorlin Elsa, op. cit., p. 13.
- [32] Notons que même dans le cas de la domination de classe, qui semble pourtant la plus littéralement « économique », une approche purement quantitative qui se limite à saisir les groupes à partir de la distribution inégale de revenus, patrimoine et autres capitaux (économiques mais aussi culturels et symboliques) échoue à saisir ce qui est véritablement en jeu dans ces rapports de domination. Selon Cécile Piret, le problème d’une telle approche purement quantitative est « d’en arriver à définir uniquement ces groupes sociaux par une position et des caractéristiques socio-économiques dominées sans jamais identifier les mécanismes sociaux qui produisent un espace social hiérarchisé ». Cette approche « stratificationniste » est notamment véhiculée à chaque fois que l’on mobilise l’expression de « classes ou milieux populaires » : « Dans cette formule, le concept de classe sociale, en passant du singulier au pluriel (comme dans le passage de la classe ouvrière aux classes populaires), perd de sa plus-value explicative : l’espace social est envisagé comme structuré par des dimensions inégalitaires, mais rien n’est dit sur les relations de production qui configurent cet espace social, contrairement à ce que permet le concept de lutte de classe. Autrement dit, la dimension politique inscrite dans le concept de classe ouvrière s’est étiolée ». D’où découlent deux conséquences politiques très problématiques : 1) une euphémisation des conflits sociaux « alors que ceux-ci sont toujours constitutifs des conditions d’existences des milieux populaires et de leur champ des possibles, indépendamment du fait que ces groupes sociaux soient ou non activement engagés dans les luttes sociales ; et 2) « une conception passive du public populaire, celui-ci n’étant pas envisagé comme étant partie prenante et donc comme pouvant prendre parti dans les dynamiques sociales » (Piret Cécile, « Du sujet politique en éducation permanente. Quelle définition pour quels enjeux ? », analyse ARC, 2019, consulté le 27 avril 2022).
- [33] Harchi Kaoutar, « “Checker les privilèges” ou renverser l’ordre ? », Ballast, 15 juin 2020, consulté le 02 mai 2022.
- [34] McWhorter, op. cit., p. 154. Nous traduisons.
- [35] Ibid., pp. 152-154.
- [36] Casey Zachary A., Pedagogy of Anticapitalist Antiracism: Whiteness, Neoliberalism, and Resistance in Education, 2016, pp. 79-80. Nous traduisons ; c’est nous qui soulignons.
- [37] Clette-Gakuba Véronique, « Réflexions et problèmes sur la question des allié.es blanch.es », billet de blog hébergé sur Le Club de Mediapart, 1er décembre 2021, URL : https://blogs.mediapart.fr/plis/blog/011221/reflexions-et-problemes-sur-la-question-des-alliees-blanches, consulté le 19 avril 2022
- [38] Ibid.
- [39] Ahmed Sara, op. cit.
- [40] « Why “Privilege” Is Counter-Productive Social Justice Jargon », citée et traduite par Harchi Kaoutar, op. cit.
- [41] McIntosh Peggy, op. cit., traduction de Nicolas Marion.
- [42] Kerner Ina, op. cit., p. 262.
- [43] C’est d’ailleurs la thèse déjà défendue en 1845 par Marx Karl et Engels Friedrich, L’idéologie allemande, Paris, Éditions Sociales, 1976.
- [44] Dorlin Elsa, op. cit., pp. 13-14.
- [45] Sara Ahmed a proposé dans le même sens une critique puissante de six modes de « déclaration de la blanchité » en montrant qu’elles ne sont pas performatives, c’est-à-dire qu’elles ne font pas ce qu’elles disent : non seulement ces déclarations de privilège blanc ne modifient en rien les conditions réelles de production et de reproduction du racisme, mais elles vont même jusqu’à assurer la reproduction des privilèges par la production d’un sujet prétendument « éduqué, déconstruit et conscient, qui s’arrogerait de fait une supériorité incontestable sur les autres […] et qui pourrait bien n’être en somme qu’une forme nouvelle et pernicieuse de privilège » (Ahmed Sara, op. cit.).
- [46] McIntosh Peggy, op. cit.
- [47] Kerner Ina, op. cit., p. 263
- [48] Ibid.
- [49] Ibid., p. 265.
- [50] Gabriel Joao, cité in Harchi Kaoutar, op. cit.
- [51] Harchi Kaoutar, op. cit.
- [52] Voir l’analyse d’Aurore Koechlin dans le dossier du présent numéro, ainsi que Koechlin Aurore, La révolution féministe, Paris, Amsterdam, 2019, pp. 125-147. Cette section de l’ouvrage est consultable en ligne : Koechlin Aurore, « Woke et déconstruit·e, critique d’une posture », Les Guérillères, 01 octobre 2020, URL : https://lesguerilleres.wordpress.com/2020/10/01/woke-et-deconstruit-e/, consulté le 29 mars 2022. Le livre d’Aurore Koechlin a fait l’objet d’une recension parue dans notre revue : Feron Pauline, « A propos de “La révolution féministe” d’Aurore Koechlin », Permanences critiques, juin 2021, consulté le 27 avril 2022.
- [53] Mauzé Grégory, « Démasquons nos privilèges… Et ensuite ? », Politique, 3 août 2019, consulté le 21 avril 2022.
- [54] Titre de l’article de Kaoutar Harchi, op. cit.
- [55] Kergoat Danièle, « Dynamique et consubstantialité des rapports sociaux », in Dorlin Elsa (dir.), op. cit., pp. 112-113.
- [56] Boltanski Luc, « La sociologie est toujours critique », conférence mise en ligne sur la chaîne YouTube NantesUniv, 28 octobre 2013, consulté le 02 mai 2022.
- [57] « Les communistes, nous les communistes, désirons changer le monde de manière à nous transformer nous-mêmes » (Balibar Étienne, « Communism as Commitment, Imagination and Politics », in Žižek Slavoj (éd.), The Idea of Communism, London/New York, Verso, 2013, p. 14. Nous traduisons). Ce qui, note Balibar, distingue le « désir communiste » d’une éthique chrétienne de l’homme nouveau autant que l’idéal nietzschéen et foucaldien du « souci de soi » (Balibar Étienne, « The Communist Desire to Change the World – and Ourselves », Viewpoint Magazine, 18 janvier 2017, consulté le 21 avril 2022).
- [58] Fania Noël, « Intersectionnalité », in Dorlin Elsa (coord.), Feu ! Abécédaire des féminismes présents, Paris, Libertalia, 2021, pp. 330-331.
- [59] « Notre tâche n’est pas de répéter un discours antiraciste dans l’espoir qu’il acquière une certaine performativité. […] L’antiracisme exige des interventions dans l’économie politique de la race et dans la manière dont le racisme distribue inégalement les ressources et les capacités » (Ahmed Sara, op. cit.).
- [60] Cavazzini Andrea, « Éditorial », Cahiers du GRM, n° 16, 2020, consulté le 21 avril 2022.
- [61] Matthys Jean, « Vingt thèses sur l’actualité intempestive de l’enquête ouvrière », Permanences critiques, n° 2, septembre 2021, pp. 45-54, consulté le 02 mai 2022.
- [62] Noël Fania, op. cit.