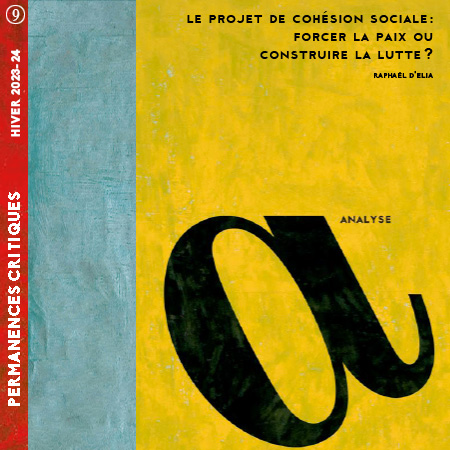Introduction
Aujourd’hui, il y a plus de 50 000 ménages bruxellois inscrits sur les listes d’attente pour un logement social, attente qui peut aller de 12 à 20 ans[1]. De plus, un·e Bruxellois·e sur deux pourrait prétendre à un logement social[2], mais tou·te·s ne recourent pas à ce droit. Il y a un consensus général pour dire que l’offre de logements sociaux peine cruellement à répondre à la demande, et en attendant d’avoir une place, il y a un renvoi par défaut au marché du logement privé. Là où le reste de ce dossier s’intéresse davantage à ce marché privé et à ce qu’il produit (ou pas) comme résistances, cet entretien nous donne un certain éclairage sur la situation dans les logements sociaux bruxellois, à travers un regard situé : celui d’un ancien assistant social qui travaillait dans un projet de cohésion sociale (PCS). Les PCS, nés dans la fin des années 90 suite aux émeutes dans les quartiers populaires bruxellois[3], sont des dispositifs d’accompagnement social qui visent à rendre plus harmonieuse la cohabitation, dans des espaces parfois trop exigus et insuffisamment rénovés, de locataires précaires et/ou d’origine immigrée[4]. Un PCS est géré par une ASBL spécialisée dans le logement et rattaché à une ou plusieurs Sociétés Immobilières de Service Public (SISP), à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) et parfois à la commune. Ce dispositif s’appuie sur le travail social communautaire afin d’atteindre ses objectifs. On en dénombre 32 à Bruxelles, répartis sur les différents logements sociaux existant. Cet entretien interroge le potentiel mobilisateur d’un tel dispositif et montre les obstacles à la politisation des locataires, même dans un cas de figure où la propriété est concentrée et où les risques d’expulsion sont minimes.
Mona Malak : Pouvez-vous retracer brièvement l’histoire des PCS ?
Raphaël D’Elia : Dans les années 90, il y avait une criminalité assez élevée à Bruxelles et les pouvoirs publics ont identifié que les logements sociaux en généraient pas mal. On se souviendra par exemple des grosses émeutes à Forest et Anderlecht suite à des violences policières[5]. Le dispositif des PCS a été mis en place pour pacifier les quartiers populaires et aussi pour rediriger l’attention sur ces endroits.
Au niveau des habitants des logements sociaux, on peut dire qu’il y a deux types de profils. D’abord, l’ancienne génération, principalement composée de « belgo-belges » blancs, plutôt issus de la classe moyenne inférieure, à qui on a donné une place dans les logements sociaux quand ils étaient, par exemple, petits fonctionnaires pour la commune. Parce qu’à l’époque, avant les années 90, il n’y avait pas de critères clairs pour l’attribution des logements, donc c’était un peu clientéliste. Certains bourgmestres distribuaient les places en guise de cadeaux. Ensuite, le dispositif a été mis sous tutelle de la Région et à partir de là, il fallait répondre à certains critères objectifs. Et c’est à ce moment-là que des populations plutôt issues de l’immigration, parce qu’elles répondaient aux critères, se sont installées dans les logements sociaux. On a alors vu apparaître un problème de cohabitation entre ces deux populations – celle issue de l’immigration et celle qui ne l’était pas – et l’un des objectifs derrière la création des PCS était d’essayer de créer du lien entre elles.
M.M : Quelles sont les activités concrètes d’un PCS ?
R.D : Il peut s’agir de choses très différentes, le but principal étant de développer des projets avec les habitants. Par exemple, là où j’étais, on a travaillé au développement d’une école de devoirs, parce qu’il y avait beaucoup d’enfants et donc c’était un besoin qu’on avait identifié. Mais c’était aussi une porte pour entrer en contact avec les parents et ensuite développer des projets avec eux. Ça a abouti, par exemple, à des ateliers d’alphabétisation, destinés principalement aux femmes pour qu’elles s’en sortent sur le plan de leur insertion socio-professionnelle ou, tout simplement, dans leur vie quotidienne.
Un autre besoin qui avait été identifié était celui d’avoir une laverie à un tarif abordable, parce que le bâtiment où se situent les logements sociaux n’était pas bien insonorisé et que si chacun commençait à utiliser sa propre machine à laver, les nuisances sonores devenaient rapidement ingérables. Il y avait aussi un service d’aides-ménagères qui permettait aux personnes devenues dépendantes avec l’âge d’avoir accès à un service de ce type sans débourser trop d’argent. La dernière chose qu’on avait mise en place avant que je parte, c’était une sorte de cybercafé à destination des personnes plus âgées, pour leur apprendre à utiliser les outils numériques et pour effectuer leurs démarches administratives. L’idée, c’était de ne pas juste les faire à leur place, mais de les accompagner pour qu’elles puissent elles-mêmes le faire ensuite à la maison. Pendant le Covid, on a développé des projets avec des jeunes qui trainaient dans le quartier et qu’on sentait un peu désœuvrés. Ils étaient clairement en demande d’activités. On a alors mis en place un système pour qu’ils aident les voisins plus âgés à faire leurs courses, ou pour qu’ils accompagnent les sorties avec les enfants, histoire qu’ils puissent se sentir investis dans la vie de leur quartier et, en bonus, recevoir un peu d’argent.
M.M : Quelles problématiques revenaient le plus souvent lors de vos permanences sociales ?
R.D : On était vraiment en première ligne par rapport à tous les problèmes que les gens pouvaient rencontrer. On les redirigeait souvent vers l’un ou l’autre service mais dès qu’une personne avait un problème quelconque, elle venait s’adresser à nous. On venait nous voir autant pour une fiche d’impôt que pour une télévision en panne.
Un problème qui revenait beaucoup était celui de l’insonorisation. L’immeuble est quand même assez conséquent avec, dans mes souvenirs, plus ou moins 400 habitations. Ça fait beaucoup de monde. Étant donné qu’à l’époque de sa construction, il n’était pas destiné à de très grandes familles, les constructeurs n’ont pas trop travaillé sur l’insonorisation ni sur la taille des habitations. Du coup, le bruit que pouvaient faire les familles avec enfants logées dans ces espaces trop exigus pour elles était souvent perçu comme une nuisance pour le voisinage.
Les gens se plaignaient beaucoup de la saleté aussi, en remettant la faute sur leurs voisins. Mais le problème de base, c’est qu’il n’y avait pas assez de personnel pour bien nettoyer l’entièreté de l’immeuble. Le manque de jeux pour les enfants et le manque d’espaces verts étaient aussi parfois décriés.
M.M : Est-ce que vous faisiez remonter ces problèmes au Foyer, à savoir la société de logements sociaux, en charge de l’immeuble ?
R.D : Oui, on avait des réunions régulières avec les personnes du Foyer. Mais les réclamations étaient seulement prises en compte quand ça l’arrangeait, c’est-à-dire quand les solutions étaient faciles à mettre en place et ne demandaient pas d’argent. On n’était pas considérés non plus comme des interlocuteurs très importants et notre avis était purement consultatif. En plus, sur notre site, ça se passait plutôt bien, il n’y avait pas de gros problèmes d’insécurité et les habitants accrochaient bien au PCS. Donc sous prétexte que ça se passait bien, on ne nous accordait pas plus de subsides. Alors que, normalement, on n’est pas un dispositif qui répond à l’urgence : notre action est bien davantage préventive.
M.M : Est-ce que vous avez pu observer ou même organiser des actions collectives dans le but de mettre pression sur le foyer pour régler les problèmes soulevés ?
R.D : Objectivement, le seul souvenir du genre qui me revienne en mémoire, c’était un locataire qui, de sa propre initiative, a lancé des pétitions et des actions en justice. Mais on avait implicitement consigne de ne pas trop le suivre. Ce n’est pas une force d’action collective, un PCS. Parce que ceux contre qui on est censé porter des revendications, c’est ceux qui nous paient. On avait plutôt un rôle de courroie de transmission, en quelque sorte : on pouvait par exemple aider les habitants à formuler des demandes ou à rédiger des lettres à propos des problèmes qu’ils pouvaient rencontrer. Mais ça n’allait vraiment pas plus loin que ça, parce qu’il n’est clairement pas question de mordre la main qui nous nourrit. Ce n’est pas comme un syndicat, où les affiliés payent des cotisations qui servent, entre autres, à rémunérer les gens qui vont les défendre et les représenter. Avec un PCS, on n’est pas du tout dans cette logique-là.
Ce qui est problématique, c’est que tous les habitants ne perçoivent pas ça. Certains peuvent croire qu’on s’inscrit dans un vrai rapport de force, qu’on est là pour les défendre ; d’autres nous voient comme un relais intéressant entre les habitant·e·s et le foyer. D’autres encore ne comprennent pas qu’on est différent du foyer, qu’on n’est pas l’État ni le logement social, mais simplement des employés d’ASBL. Il reste cette ambiguïté qui, je pense, est contre-productive pour beaucoup de gens. Au-delà de ça, le travail accompli par les PCS est, je pense, absolument nécessaire et devrait à mon avis être mis en place partout où il y a du logement collectif. Mais l’ambiguïté qui accompagne notre statut et notre rôle sape la mise en place d’un vrai rapport de force, ce qui limite considérablement notre champ d’action.
M.M : Quels sont, selon-vous, les autres freins à l’organisation collective dans le contexte d’un logement social ?
R.D : On entendait beaucoup de discours du type : « Nous, de toute façon, on est privilégiés d’être là, dans un logement social. Parce que si on était dans le privé, ce ne serait pas tenable. » Et donc les gens se sentent en quelque sorte redevables envers l’État qui « offre » ce logement, à un prix plus abordable que le marché locatif, même si parfois les logements sont pratiquement inhabitables ou suroccupés.
La peur de perdre ce « privilège » génère donc des réticences à l’idée d’entamer des actions collectives, voire une forme d’autocensure, Ceci dit, cette peur vient aussi de ce que les gens ne connaissent pas leurs droits, parce que, en réalité, personne ne peut expulser un locataire de logement social sous prétexte qu’il a réclamé quelque chose. Dans la grande majorité des cas, les gens qui émettent des revendications conservent leur logement, parfois pendant des décennies. Il y a des critères clairs pour pouvoir expulser quelqu’un de son logement social, comme des problèmes de nuisance extrême, des plaintes d’autres habitants, le non-paiement du loyer, ce genre de choses. C’est vraiment rare.
Ensuite, je dirais qu’il y a les problèmes de cohabitation entre des populations issues de divers horizons, qui font que les gens se querellent entre eux plutôt que d’engager le conflit avec le propriétaire qui, lui, pourrait éventuellement prendre des mesures concrètes pour fluidifier cette cohabitation. C’est un classique : c’est plus facile de s’en prendre à la personne qui est juste en dessous de soi dans la hiérarchie sociale que de s’attaquer réellement à la source du problème.
M.M : Est-ce que le PCS où tu travaillais, sans pour autant faire de l’action politique directe, faisait néanmoins partie d’un groupe militant plus large ?
R.D : Oui, notre relais militant et politique était le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH) qui rassemble la quasi-totalité des associations actives dans le logement. On n’avait pas de contact récurrent avec eux mais on assistait parfois aux formations qu’ils organisaient et on faisait remonter certaines informations. Vu qu’ils sont moins souvent sur le terrain, ils nous demandaient de produire des chiffres sur les candidat·e·s locataires. Parce que l’ASBL pilotant le PCS pour laquelle je travaillais aide aussi les personnes qui cherchent un logement social. Donc on transmettait les statistiques sur le nombre de gens qui venaient chercher un logement, pour donner un ordre d’idée du nombre de candidat·e·s locataires à transmettre aux politiques.
La stratégie de l’ASBL consiste à inviter les gens à faire une demande pour un logement social, même si on sait qu’il faut en moyenne dix ans (!) pour qu’une demande aboutisse. L’idée est de donner un signal aux politiques. Mais ça se limite un peu à ça, il n’y a jamais eu d’action collective plus importante : on n’allait jamais à des manifestations, on n’organisait pas d’événements plus larges qu’à l’échelle du quartier. Je crois qu’on recevait annuellement une invitation pour une manif’ autour de ces problèmes-là mais il n’y avait pas de mobilisation de l’ASBL ou de nos bénéficiaires pour y aller.
En résumé : un PCS, c’est très institutionnel mais le RBDH peut être un bon relais de plaidoyer. Pour le reste, on ne s’impliquait pas dans la politique en tant que telle – on n’était ni une force d’opposition, ni un contre-pouvoir, mais on peut dire qu’on s’impliquait à un niveau local, en créant du lien avec les habitant·e·s. Il y a toujours eu ce grand récit du milieu associatif selon lequel une action à l’origine militante perd sa force d’impact dans le processus qui la voit devenir une activité professionnelle – son institutionnalisation, en d’autres termes.
M.M : Quels liens faites-vous entre le syndicalisme dans le milieu du travail et les luttes pour le logement ?
R.D : À la base, je viens du syndicalisme, que ce soit le syndicalisme étudiant ou professionnel. Je suis donc entré dans les PCS avec l’espoir de pouvoir faire du syndicalisme dans le logement. J’ai été un peu déçu, notamment à cause de toutes les difficultés que j’ai énumérées plus tôt. On pourrait croire que le fait d’avoir un seul propriétaire pour des milliers de personnes faciliterait les mobilisations, mais c’est malgré tout compliqué de faire bouger les gens sur la question du logement. Alors quand on se retrouve confronté à une multitude de propriétaires, chacun d’entre eux ayant un profil différent, ça devient d’autant plus compliqué… Je sais qu’il y a pas mal de gens qui espèrent faire de l’action collective dans ce domaine-là, mais moi, je ne peux pas m’empêcher d’être un peu sceptique.
En tout cas, je pense qu’il y a d’autres domaines où le rapport de force est plus clairement défini, notamment dans le travail. À un moment donné, j’étais actif dans l’animation/création d’un syndicat de livreurs à vélo au sein de Deliveroo. Et les gens disaient que c’était impossible de syndiquer ces gens-là, de les organiser, etc. On a quand même réussi à créer un syndicat et à faire grève, à faire bouger un peu les lignes. Peut-être qu’il faut juste trouver la bonne formule et surtout jouer en dehors des règles du jeu qui sont imposées par l’État. En tout cas, ce n’est pas avec des dispositifs comme le PCS, ni même, à mon sens, avec toutes les ASBL actuellement actives dans le domaine qu’on va y arriver. C’est clairement en dehors de ça qu’il faut construire.
- [1] Pour plus d’infos, voir : https://logementbruxellois.be/candidat-locataire/ consultée le 6 décembre 2023.
- [2] Voir le « Plan Urgence Logement » 2020-2024 de la secrétaire d’Etat au logement, Nawal Ben Hamou. URL : https://nawalbenhamou.brussels/wp-content/uploads/2021/01/Plan-Urgence-Logement_DEF.pdf, consultée le 12 novembre 2023.
- [3] Pour aller plus loin, voir :
:https://www.ulac-huvak.be/projet-cohesion-sociale-goujons/ et https://www.habitatetrenovation.be/publication-vivre-ensemble/ consultées le 12 novembre 2023.
- [4] Voir : « L’accompagnement des dynamiques de cohésion sociale. Vingt ans d’actions au sein des cités de logements sociaux de Bruxelles » dans « Habitat et Rénovation », novembre 2022. URL : https://www.habitatetrenovation.be/app/uploads/2022/12/Vivre-ensemble_Habitat-Renovation_2022_web.pdf consultée le 6 novembre 2023.
- [5] Ce que l’on appelle communément les « émeutes de Forest » ont démarré en 1991 dans le quartier Saint-Antoine, suite à un contrôle de police. Pour un retour critique sur les événements : « Forest 1991 : les raisons de la colère », revue Alter Echos, n°493. URL : https://www.alterechos.be/forest-1991-les-raisons-de-la-colere/ consultée le 6 novembre 2023.