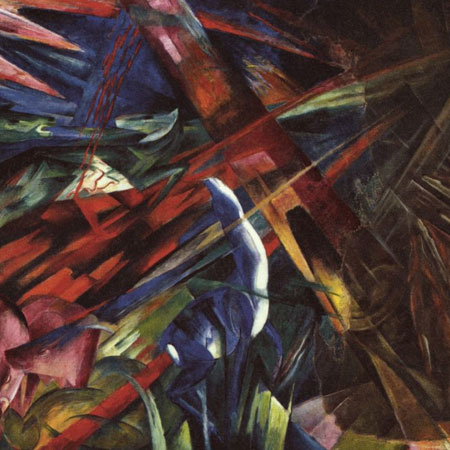Dans un article publié en 2006, la sociologue Stéphanie Vermeersch analysait comment la classe moyenne s’aidait des associations pour se valoriser dans une idéologie de la « mixité sociale » et aller à la rencontre des quartiers populaires et des autres classes sociales. Créer des socialités interculturelles, interclassistes et diversifiées, en plus d’être aujourd’hui une recommandation systématique de tous les appels à projets, est devenu le motif récurrent de toutes les luttes associatives. Vermeersch, non contente de souligner que – paradoxalement – ces populations gentrificatrices (les travailleurs et bénévoles des associations) cultivent souvent un certain esprit d’entre-soi, montrait combien l’« exotisme » de ces quartiers populaires était fantasmé : « cosmopolitisme », « diversité », « authenticité » sont devenus les mots clés d’une doxa très caractéristique de cette « classe d’alternative » associative. Or, qui forme cette classe ? « Il s’agit largement de membres des couches moyennes et supérieures, dotés d’un niveau culturel élevé, de formation universitaire, exerçant des professions liées aux milieux intellectuels, à l’enseignement, à l’animation, au travail social et à la santé… »[1]. La mixité est-elle donc le reflet du désir des classes populaires, ou bien l’univers fantasmé des classes moyennes qui travaillent dans ces quartiers populaires ?
Compte tenu de ce fait observable et expérimentable dans les associations comme ailleurs, n’y a-t-il pas lieu d’interroger de façon critique ces injonctions sans cesse réitérées par les pouvoirs publics : « créez de la mixité ! », « faites se rencontrer des publics qui ne se rencontrent pas d’habitude ! », « ayez de la diversité dans vos publics ! », autant de déclinaisons de cette même idéologie que nous évoquions ci-dessus ? Précisément, derrière un aspect « positif » et « émancipatoire » de la diversité, ne se cache-t-il pas une énième oppression de l’idéologie dominante où, pour chaque denier public investi, on aimerait voir autant de personnes minoritaires rejoindre la norme sociale et bourgeoise où « mixité » et « diversité » forment l’alpha et l’oméga de l’intégration ? Sans porter de réponses hâtives à cette problématique, la question mérite certainement d’être posée. En particulier dans le contexte de l’éducation permanente, dont – rappelons-le – les objectifs visent l’émancipation et l’esprit critique des personnes, non leur normalisation dans un cadre idéologique, fut-il cosmopolite et empreint de mixité.
Polysémie de la mixité
Une catégorie comme celle de « mixité » avait toutes les chances de devenir un mot d’ordre consensuel des axes de travail politiques et sociaux : présentant une polysémie très dense, elle peut s’intégrer dans à peu près tous les contextes, sans jamais avoir à prescrire une explicitation très précise de ses intentions. Ceci est montré très brillamment par Philippe Genestier qui, dans son article « La mixité : mot d’ordre, vœu pieux ou simple argument ? »[2], relève pas moins de six connotations différentes et souvent contradictoires de cet idéal-type : la mixité comme approche statistique (1), expression d’un idéal (2), proclamation d’un principe régulateur (3), énoncé utopique (4), prégnance d’un mythe (5), pure rhétorique (6)[3]. Ce type d’élasticité conceptuelle est absolument courant et, en un sens, utile à l’action associative : la capacité de louvoyer dans les prescriptions étatiques est, en réalité, l’une des nombreuses façons pour une association de conserver sa singularité et son originalité. Organiser l’action socio-culturelle avec ce genre de catégories présente donc, au premier abord, un double avantage : enjoindre les acteurs de terrain à se conformer à une norme fonctionnant comme idéal-type, sans que ces prescriptions n’aient la rigidité et la violence d’une injonction purement hétéronome. En revanche, là où le bât blesse, c’est quand il devient oppressif, inutile, contraignant voire générateur de domination de conditionner toute initiative sous cette injonction : c’est-à-dire quand l’agenda politique, relayé par les actions associatives, devient une façon de refuser aux populations qui en sont les sujets les plus fragilisés une liberté et une autonomie quant au choix de leurs valeurs propres.
De la liberté à s’autodéterminer
En effet, différents arguments indiquent que derrière la bien-pensance consensuelle d’un tel idéal de mixité se jouent des stéréotypes et des inégalités importantes. À titre d’exemple : dans quelle mesure la mixité est-elle un objectif explicite pour les quartiers et zones urbaines favorisés ? Alors que la diversité et la mixité sont presque toujours présentées comme bénéfiques à toutes les couches de la population, il appert que – structurellement – ce sont toujours les mêmes populations – précarisées – qui sont amenées à devoir se mélanger, aimer la diversité, s’intégrer dans un tissu social « ouvert » : on imagine mal, en effet, un appel à projet encourager le développement d’initiatives de diversification sociale dans le quartier européen ou dans les quartiers nantis de Uccle.
De la même façon, la liaison caricaturale entre proximité spatiale et proximité sociale (cf. les recettes événementielles du type « un peu de blanc, un peu de beur et un zeste de quartier »), d’évidence, est largement discutable. Effectivement, le fait que certains groupes sociaux soient prédominants dans des zones et des quartiers spécifiques de la ville n’indique pas qu’il y a, alors, nécessairement exclusion, marginalisation, communautarisme, etc.
La séparation spatiale peut au contraire permettre aux divers milieux sociaux des modes propres d’habiter, dont ils ont la maîtrise, tandis que le mélange spatial risquerait d’aboutir à une situation où les formes légitimes d’habiter sont déterminées par le groupe doté de la légitimité dominante – à moins de faire l’hypothèse de l’individu moyen, c’est-à-dire d’une société où les règles d’occupation des espaces seraient les mêmes pour tous les milieux et seraient orientées vers un même type de ressource et une même forme de sociabilité.[4]
Le travail de la mixité sous ce jour n’est-il pas une manière de ne pas respecter l’autonomie supposée fondamentale à toute personne inscrite dans le système sociétal ? Derrière un objectif déclaré d’émancipation peut, on le voit, très bien se nicher un déni de la capacité de certaines populations à s’autodéterminer : cette capacité demeure, d’une façon ou d’une autre, un privilège des populations dominantes. Reprenons Genestier : « Le mot « mixité » témoigne d’un ethnocentrisme qui interdit de percevoir en quoi une faiblesse de capital économique empêchant de résider dans un quartier convoité par des couches plus aisées ne correspond pas nécessairement à une absence de capital social et relationnel »[5]. Du moins, il s’agit d’un implicite effectif dans les discours de la mixité. Il reproduit ce que nous annoncions en début de ce texte : « mixifier » revient souvent à gentrifier, c’est à dire amener d’autorité des personnes plus aisées dans les quartiers pauvres, en supposant que leurs habitants d’origine n’ont pas les capacités à déterminer par eux-mêmes la forme de mixité qui leur convient. De nombreux exemples pourraient être mobilisés : nous nous contentons juste – ici – d’indiquer des voies critiques pour les évaluer.
Une mixité émancipée est-elle possible ?
À notre question inaugurale, demandant si toute mixité est bonne à prendre, nous devons donc répondre par la négative. A l’inverse, elle nous conduit à demander quelle mixité peut être défendue, laquelle porte un véritable processus émancipatoire.
Une première piste pourrait être celle d’une promotion de la mixité qui soit, non plus requise et formulée comme un objectif à atteindre, mais simplement valorisante de celle qui, en acte et en l’état, existe déjà dans tous les quartiers. Par-delà l’ethnocentrisme nourri de stéréotypes qui fait de tout quartier populaire une masse indistincte de « cultures minoritaires », il s’agit de prendre acte de la diversité intrinsèque qui s’y déploie : multiplicité culturelle, diversité des modes de vies et d’habiter, superpositions de pratiques sociales différentes et de secteurs professionnels, variété des modes d’appropriation du patrimoine culturel en sont les dimensions effectives auxquelles ne manque, comme telles, aucune mixité supplémentaire. Un travail associatif dans ce contexte pourrait, alors, être celui d’une prise de conscience de cette diversité, celui d’une appropriation de l’impact significatif qu’ont toutes ces cultures et pratiques dans le tissu urbain et ses singularités. Dans cette perspective, il s’agirait de s’approprier de façon critique les dynamiques socio-culturelles en jeu dans notre environnement proche afin de mesurer combien nous y avons, qui que nous soyons, de puissance d’agir. Aux modalités discrètes de la gentrification des quartiers populaires, il convient d’opposer l’appropriation d’un espace à la fois physico-géographique, social et symbolique dont la mixité constitutive fonde la richesse et qui est, en fait, déjà disponible et réelle.
La célébration de la diversité effective, c’est-à-dire des mixités vécues et non des mixités voulues, est peut-être une piste pour, conformément au prescrit de décret de l’éducation permanente à partir duquel de nombreuses associations comprennent le sens de leurs actions, travailler « l’analyse critique de la société, la stimulation d’initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l’exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans une perspective d’émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l’expression culturelle »[6]. L’élargissement de cette diversité à un champ plus large et global doit, quant à lui, dépendre d’une volonté effective et exprimée comme telle par les populations concernées. Telle est notre seconde piste pour une mixité émancipée : le travail des associations peut être celui d’inviter leurs publics à définir, exprimer et défendre ce qui leur est nécessaire, enviable et/ou vital en mesurant ce qu’on suppose être bon pour eux. Nous pourrions imaginer la mise en place d’ateliers d’analyse collective où sont lues et discutées les recommandations officielles de l’État les concernant et qui sont disponibles dans les appels à projet impactant leurs quartiers. Ces ateliers pourraient alors contribuer à opposer aux feuilles de route hétéronormatives de l’État des exigences construites sur base autonome, informées et représentatives de la mixité effective des populations en question.
En d’autres termes : toute mixité est-elle bonne à prendre ? Non. Sauf à renverser le sens de la question et à dire que ce sont toutes les mixités en acte qui sont bonnes à prendre : telles qu’elles se donnent, ou telles qu’elles forment le socle d’un désir exprimé de changement et d’ouverture.
Nicolas MARION
Chargé de recherche à l’ARC
- [1] VERMEERSCH, S., « Liens territoriaux, liens sociaux : le territoire, support ou prétexte ? », dans Espaces et sociétés, 2006/3 (n°126), p.56.
- [2] GENESTIER, P., « La mixité : mot d’ordre, voeu pieux ou simple argument ? », Espaces et sociétés 2010/1 (n° 140-141), p. 21-35. [En ligne] : https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2010-1-page-21.htm
- [3] Nous renvoyons nos lecteurs désireux d’en lire les spécifications détaillées à la lecture de l’article en ligne (voir lien dans la note supra).
- [4] REMY, J., VOYÉ, L. Ville, ordre et violence, Paris, PUF, 1981, p.152.
- [5] GENESTIER, P., « La mixité : mot d’ordre, voeu pieux ou simple argument ? », Op.Cit., p. 34.
- [6] Cf. le « Décret relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’Education permanente » de 2003, consultable en ligne à l’adresse suivante : http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=e4896644ae1020f1bb76e1d450370936ac57053e&file=fileadmin/sites/edup/upload/edup_super_editor/edup_editor/documents/Judith/Decret_17.07.2003_coordonne.pdf