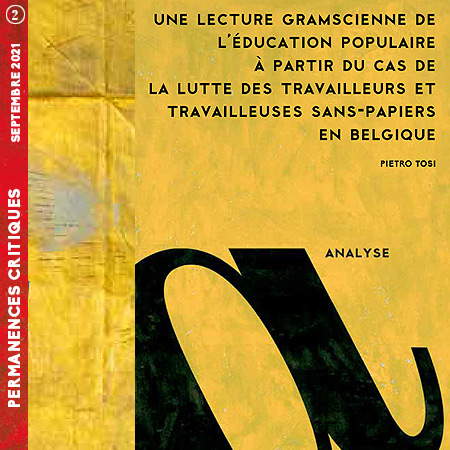Les organisations traditionnelles du mouvement ouvrier sont en déclin. La fin du compromis fordiste et l’époque néolibérale nous ont laissé une société fondée sur le repli sur soi. La social-démocratie s’est pliée à cette forme contemporaine du capitalisme et a contribué à construire une société qui n’est qu’un agrégat d’individus. Pour « faire société », il ne nous resterait rien d’autre à faire que négocier des compromis. C’est une sorte de calcul qui devient de plus en plus intenable si sa base matérielle permettant de tirer profit des compromis s’effondre.
Cela fait déjà longtemps que le mouvement social n’a pas obtenu des grandes victoires et il est de plus en plus difficile de passer à l’action. Les routines militantes des organisations traditionnelles sont considérées par certains comme inefficaces et trop fermées sur une société salariale dont beaucoup de « nouveaux militants », qui n’ont connu que le néolibéralisme, ont déjà fait le deuil. Du « vieux monde », celui du compromis fordiste et de la solidarité instituée, à la « fabrique des précaires » où il faut soit être « entrepreneur de soi-même », soit être responsable de ses propres échecs, la question se pose : comment inventer de nouveaux modes de luttes et des nouvelles pratiques à la fois efficaces et transformatrices ?
Beaucoup de solutions, de méthodes, de pratiques sont proposées sans toujours rompre avec l’air du temps néolibéral. D’autant plus qu’adapter nos méthodes au néolibéralisme ambiant comporte le risque d’abandonner toute perspective de le dépasser, de renoncer à considérer la réalité des rapports sociaux d’oppression et d’exploitation comme transformable.
Selon nous, la crise du covid-19 a toutefois ouvert les portes pour une refondation critique des pratiques d’éducation permanente dans ce cadre. Les conditions de travail et de vie particulières des travailleuses et travailleurs sans-papiers dans cette conjoncture ont notamment permis de libérer des pratiques de conflictualités nouvelles dans l’espace public.
Dans cette analyse, nous mettrons d’abord en exergue les limites d’une vision « classique » de l’éducation permanente, telle qu’elle tend à se déployer dans le cadre des décrets qui ont formalisé cette pratique. Ensuite, nous présenterons quelques catégories interprétatives de la pensée gramscienne, notamment en remettant au centre le concept de lutte de classe, qui, aujourd’hui, semble être devenu secondaire et en le liant à sa conception de l’éducation des adultes qui dépend du concept d’hégémonie culturelle. Enfin, nous questionnerons nos pratiques d’éducation permanente à partir de notre expérience d’accompagnement des travailleurs et travailleuses sans-papiers dans leur chemin de conquête d’un espace d’organisation collective.
De nos jours, les espaces politiques et collectifs s’effritent toujours plus. À cause des nouvelles pratiques gouvernementales de management de la pauvreté, des politiques de sous-traitance et de la précarité généralisée à des larges couches de la société, l’éducation populaire nécessite de se réinventer et de se restructurer. D’autant plus lorsque le syndicalisme se réduit principalement à un cadre de défense pour les salarié·es des grandes entreprises, notamment pour celles et ceux qui ont des « statuts » normés ; tandis que les autres en sont exclus.
Le malaise est profond. La volonté de transformation sociale est forte, mais elle a perdu ses anciennes boussoles et peine à s’en reconstruire de nouvelles. Comme Gramsci le dit dans les Cahiers de prison : « l’ancien monde s’effondre, le nouveau monde tarde à naitre et entre les deux, surgissent les monstres »[1].
- L’éducation permanente en Belgique et son institutionnalisation
La clef de compréhension de l’éducation permanente en Belgique tient d’abord dans la trajectoire du mouvement ouvrier et dans son rapport au savoir. Héritière de différents courants idéologiques, l’éducation permanente a une longue histoire institutionnelle[2]. Plusieurs décrets ont défini ses missions depuis 1921. Inspiré par le Mouvement Ouvrier Chrétien et le Mouvement Ouvrier Socialiste, le décret du 8 avril 1976 pérennisera le soutien aux associations, en reconnaissant « d’utilité publique » des actions d’éducation permanente. Plusieurs centaines d’organismes d’éducation permanente seront ainsi reconnus et auront pour mission l’éducation permanente du public et pour finalité la démocratie culturelle.
Par la suite, le nouveau décret de 2003 insufflera une approche « critériologique » au secteur de l’éducation permanente. La reconnaissance des associations se réalisera en effet de manière plus technique, moins politique. À partir de là, cette pratique devra être structurée professionnellement. Ce processus a mené à des impasses et surtout à trop de « subsidiologie » (quête continue de financements via des subsides au détriment de l’action de terrain) : le décret, résultat d’un compromis entre une approche sociale-démocrate visant la participation de la population à la vie démocratique et une approche néolibérale de la société axée sur l’évaluation continue par la création de quasi-marchés ne correspondait plus aux réels besoins du secteur[3].
La social-démocratie et les familles politiques traditionnelles instrumentalisent l’éducation permanente pour se donner bonne conscience. Elles ont alimenté la machine à financement des piliers (libéral, socialiste, chrétien) sur lesquels la société belge s’était fondée. Elles ont aussi permis à ces piliers de maintenir un lien avec la base de la société dans un contexte de détachement des liens entre les partis traditionnels et la société civile. Cela leur a également permis de garder un lien avec leur base électorale qui se dispersait de plus en plus dans une vision du monde antipolitique et post-idéologique. Dans les premières décennies du nouveau millénaire, l’éducation permanente a été l’outil des partis traditionnels pour essayer de combler ce vide, de plus en plus profond, entre la politique au sens institutionnel du terme et la société civile.
C’est à partir de ces constats que nous voulons réinterpréter et surtout réorganiser les pratiques d’éducation permanente. Pour cela, nous préférons la formulation d’éducation populaire, surtout utilisée dans le contexte français, pour souligner la visée de cette pratique d’organisation collective des classes subalternes en tant qu’outil de changement radical de la société.
- Gramsci et l’éducation populaire
Dans ses écrits sporadiques et souvent cryptiques, Antonio Gramsci propose des éléments pour une analyse de l’« éducation des adultes » et la définition d’une stratégie éducative globale. Pour comprendre la pertinence du discours gramscien sur l’éducation des adultes, il est nécessaire de mettre en évidence quelques concepts-clés de sa théorie sociale.
Les œuvres de Gramsci sont enracinées dans une vision du monde marxiste, fondée sur l’hypothèse que « [l]es pensées dominantes ne sont pas autre chose que l’expression idéale des rapports matériels dominants, elles sont ces rapports matériels dominants saisis sous forme d’idées, donc l’expression des rapports qui font d’une classe la classe dominante ; autrement dit, ce sont les idées de sa domination »[4]. Il n’y a pas que la classe dirigeante qui génère des idées dominantes dans la perspective de son contrôle sur les moyens de production intellectuelle[5] : les classes dominées génèrent aussi des idées qui ne servent pas nécessairement leurs intérêts. Ces dernières « n’ont pas les moyens de production intellectuelle et sont plongé[e]s dans des rapports de production qu'[elles] ne contrôlent pas »[6] : elles ont donc tendance à reproduire des idées qui expriment les relations matérielles dominantes.
L’éducation, dans son concept et son contexte plus vaste, est donc au cœur de l’hégémonie d’une classe sociale sur une autre, soit sa domination et sa direction à la fois matérielle et idéologique sur la société. Tout projet politique est ainsi en même temps un projet éducatif. Les institutions idéologiques de la société civile, comme le droit, l’éducation, les médias de masse et la religion, s’engagent tous dans cette relation éducative. L’éducation joue un rôle important dans la construction des relations de pouvoir. Pour le système en place, il est essentiel d’assurer le consentement de la population au mode de vie dominant et imposé. Mais Gramsci propose des alternatives qui se situent dans ce qu’il appelle l’éducation pour les adultes. Nous l’appelons, en Belgique, l’éducation permanente.
Pour Gramsci, le terrain sur lequel la contestation de l’hégémonie est possible est le même terrain qui la soutient, à savoir celui de la société civile conçue comme un lieu conflictuel de la production de savoirs. Certes, Gramsci estime d’un côté qu’« on ne peut pas proposer, avant la conquête de l’État, de changer complètement la conscience de l’ensemble de la classe ouvrière ; il serait utopique, car la conscience de toute la classe en tant que telle ne change que lorsque le mode de vie de la classe elle-même a changé, c’est-à-dire lorsque le prolétariat sera devenu la classe dirigeante et disposera de l’appareil de production, d’échange et du pouvoir d’État »[7]. D’un autre côté toutefois, il est nécessaire de travailler la conscience de la classe en amont.
« Cela signifie que chaque révolution a été précédée d’un intense travail de critique, de pénétration culturelle, d’imprégnation des idées à travers les agrégats d’hommes avant réfractaires et seulement pensant à résoudre au jour le jour, heure par heure, leur propre problème économique et politique pour eux-mêmes, sans lien de solidarité avec d’autres qui se trouvent dans les mêmes conditions »[8].
L’éducation des adultes joue un rôle fondamental dans cette « guerre de position »[9]. Les éducateurs d’adultes engagés dans une activité d’éducation contre-hégémonique doivent être considérés, selon Gramsci, comme des intellectuels organiques aux groupes subalternes qui aspirent au pouvoir. C’est-à-dire qu’ils doivent s’engager politiquement dans ce qu’ils enseignent. Si cette situation ne se produit pas, il n’y aura pas d’apprentissage efficace. Gramsci affirme l’importance de l’activité culturelle : « C’est à travers la critique de la civilisation capitaliste que s’est formée la conscience unitaire et critique du prolétariat. Cela est le sens de la culture, et non une évolution spontanée et naturaliste »[10]. Se référant à la troisième des « Thèses sur Feuerbach » de Marx[11], il invoque « une relation active, de relations réciproques », où « chaque enseignant est toujours un élève et chaque élève un enseignant »[12]. C’est pourquoi le rapport pédagogique ne peut pas être limité aux rapports spécifiquement « scolaires », qui régissent l’apprentissage dans les écoles, mais se déploie également dans les syndicats, les partis politiques, les églises, etc. La relation éducative est « la première relation hégémonique (donc de pouvoir) que l’être humain éprouve dans sa propre existence sociale »[13].
Tous ces éléments sont cruciaux pour comprendre l’impact de la pandémie sur le bouleversement des pratiques d’éducation permanente et son impact sur la mobilisation des travailleurs et travailleuses sans-papiers en Belgique.
- La lutte des travailleurs et des travailleuses sans-papiers dans la pandémie
La pandémie de Covid-19 a déstabilisé la société dans son ensemble, à la manière « d’un fait social total »[14]. Elle nous oblige à modifier notre regard sur les mouvements sociaux en prenant la mesure du contexte et des changements qui les traversent. Dans ce sens, il nous semble important d’analyser l’impact de la pandémie sur la conscience et sur les conditions de vie et de travail des travailleurs et des travailleuses sans-papiers car elle a aggravé toutes les contradictions présentes auparavant. Celles-ci se sont notamment exacerbées dans le décalage entre les mesures urgentes (arrêt des contrôles et de l’activation des chômeur·euses, mise en place de mesures de chômage temporaire ou encore de droit passerelle pour les indépendant·es) prises dans le cadre d’un état d’exception et le délaissement des personnes sans-papiers, seule exception non normée par l’État de droit. Cette position de marginalité a créé une dialectique qui a permis de « déconfiner » l’action collective des travailleurs et travailleuses sans-papiers.
Des occupations sont devenues des lieux d’organisation collective avec une véritable finalité politique. L’utilisation stratégique de l’occupation reflète une avancée dans la conscientisation du mouvement des travailleurs et travailleuses sans-papiers, dont la racine se situe du côté de la crise qui a frappé durement l’économie informelle pendant la pandémie. Les sans-papiers ont toujours travaillé dans les circuits informels, surexploités et abandonnés par les autorités au chantage des patrons qui les exploitent. Certains employeurs profitent de cette dépendance : salaires de misère, flexibilité à outrance, absence totale de couverture sociale, pression continuelle, concurrence entre travailleurs·euses, etc. Il et elles sont payé·es majoritairement entre 3 et 8€ de l’heure et travaillent jusqu’à 14 heures par jour. Ils et elles ont, dans ce cadre, formulé de revendications nouvelles liant régularisation et accès au travail et au marché de l’emploi.
Le contexte défavorable de la pandémie a donc aussi permis un renouvellement de pratiques d’éducation permanente : des groupes de solidarité se sont organisés et ont distribué des colis alimentaires, cousu des masques, assisté celles et ceux qui étaient abandonné·es par les autorités publiques et qui ne pouvaient plus payer leur loyer. Ce sont ceux et celles qui sont au plus bas de la chaîne d’exploitation qui se mettent en lutte en premier, ceux et celles qui n’ont rien à perdre et qui sont les plus précaires et les plus exposé.es au virus.
Leur colère s’est exprimée une première fois le 20 avril 2020, avec une action dans l’espace public en plein confinement, afin d’attirer l’attention du public sur leur réalité. Les organisations syndicales FGTB-CSC et les associations de soutien aux migrant·es ont décidé de se joindre à cette protestation et de lancer une campagne sur les réseaux sociaux intitulée : « Contre le virus, la régularisation c’est maintenant ! ». Cette campagne visait à « rendre visibles les invisibles » et mettre en avant que la sécurité sanitaire collective doit passer par l’inclusion des sans-papiers. La revendication principale était la mise en place d’une procédure de régularisation avec des critères clairs et permanents inscrits dans la loi et une commission indépendante hors du pouvoir discrétionnaire du secrétaire d’État à l’asile et à la migration. Dans la deuxième vague de la pandémie, les mêmes acteurs ont proposé une pétition nationale[15] pour parrainer les 150 000 sans-papiers de Belgique et changer la loi de 1980 (qui règle l’accès au séjour en Belgique). Cette campagne a été le résultat d’un dialogue avec la Coordination des sans-papiers de Belgique, qui regroupe, depuis 2014, les différents collectifs des sans-papiers et qui a construit des liens avec les composantes institutionnelles du mouvement.
Si la Coordination a mené un combat de longue haleine et un travail important de plaidoyer politique ces dernières années, l’élan de la mobilisation a été freiné après une période d’actions régulières, et ceci notamment à cause de son institutionnalisation. La pire chose à faire lorsque le contexte change, c’est d’utiliser les mêmes méthodes qu’avant. Or, il s’est avéré que les méthodes de l’éducation permanente « classique » de négociations, plaidoyer, pétition, etc. n’étaient plus suffisantes pour répondre aux nouveaux enjeux.
Après un an de « régime sanitaire », une nouvelle phase s’est donc ouverte. Des centaines de sans-papiers ont décidé de se regrouper au sein d’un nouveau collectif : l’Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR). Ils ont relancé un mouvement d’occupation de lieux emblématiques, comme l’église du Béguinage, l’ULB et la VUB à Bruxelles. Leur énergie a permis une accélération du mouvement et a remis au centre du débat public la question des sans-papiers en Belgique.
Des assemblées citoyennes se sont déroulées tous les mardis pour renforcer le soutien logistique dans les lieux et pour élargir la solidarité. Pour faire cela, il fallait bousculer les soutiens classiques comme les organisations syndicales avec des actions plus fortes. Par exemple, l’USPR a décidé d’occuper des locaux syndicaux de la CSC-Bruxelles afin d’imposer au syndicat sa ligne politique et l’obliger à s’impliquer davantage. Ce nouvel élan a également permis l’organisation d’une couche plus large de personnes sans-papiers. Plus de 1000 sont inscrites sur les listes d’attente des occupations. Beaucoup d’entre elles vivent en Belgique depuis plus de dix ans.
Après de nombreuses actions, rassemblements, occupations, conférences de presse, une grève de la faim est entamée par 430 sans-papiers dans l’église du Béguinage en rentrant dans l’Histoire comme l’un des moments les plus forts du mouvement depuis 2009.
Deux défis majeurs sont à relever pour faire avancer la demande de régularisation : le premier est le manque de volonté politique des partis politiques traditionnels, même du côté de la gauche socialiste et écologiste, le second porte sur la reconfiguration interne aux différentes composantes du mouvement.
- Nouveau contexte – nouvelles pratiques
La crise que nous connaissons actuellement a remis et continue à remettre en question un nombre de certitudes que nous avions sur notre société. Si nous voulons tracer des réflexions sur la société post-coronavirus, il est impératif de le faire avec ceux et celles qui payent le plus cette crise sanitaire et économique : les travailleurs et les travailleuses, les précaires, les femmes, les migrant·es. Il s’agit d’une période qui remet profondément en cause les méthodes classiques des pratiques de l’éducation permanente. En effet, nos pratiques classiques ont payé le prix du confinement. Il était interdit de réunir des groupes de personnes, c’est-à-dire d’être sur le « terrain » pour écouter les nouveaux vécus, les angoisses et les difficultés, pouvoir faire jouer l’intelligence collective, et donner une perspective collective et politique à la réalité du confinement. Il nous fallait réinventer nos pratiques et les repenser à partir de la réalité nouvelle.
Pour conclure, nous voudrions montrer comment nous avons essayé d’appliquer, dans un contexte si difficile, les principes de base de l’éducation permanente liés à la tradition du Mouvement Ouvrier Chrétien : voir – juger – agir.
Voir – La première finalité était de rester en contact avec nos publics, de repérer leurs besoins les plus importants et de construire des réseaux de solidarité. Une phase que nous pourrions également qualifier de « mutualiste », au sens militant du terme. L’objectif était de politiser l’acte de solidarité afin de s’écarter d’une approche passive et caritative.
Juger – La deuxième finalité a été d’essayer de réunir ces personnes pour leur permettre de s’exprimer. Nous avons organisé des groupes de discussions sur les réseaux sociaux, des réunions en ligne pour discuter de ce que chacun·e était en train de vivre. L’objectif était de clarifier via la discussion collective les interrogations individuelles, en essayant de développer une lecture sociale et politique de leurs vécus.
Agir – La troisième finalité a été de lancer des actions collectives, des campagnes d’interpellation politique et d’agitation sociale. L’objectif était de trouver un espace d’action collective dans un contexte inédit comme celui de la pandémie, en passant de la discussion à l’organisation.
Nous avons décidé d’utiliser une ancienne pratique pour lier les trois principes de base : l’enquête ouvrière. L’enquête ouvrière comme outil de description du réel d’une part, mais aussi comme pratique de formation militante[16]. Il s’agissait donc de mener une enquête avec un groupe de militant·es sans-papiers concernant leur réalité sociale.
Ce processus collectif de description de réalité permet à l’individu interrogé et interrogeant de concevoir comment et où modifier une réalité sociale. Cette méthode nous semble ainsi mettre en pratique des éléments au cœur de l’éducation politique selon Gramsci : elle permet de déconstruire les idées dominantes intériorisées par les classes dominées et de défaire les relations de pouvoir entre l’animateur et l’apprenant, l’enquêteur et l’enquêté.
- [1] Gramsci Antonio, Cahiers de prison, Cahier 3, Paris, Éditions Gallimard, 1978, §34, p. 283.
- [2] Voir l’étude de Cécile Piret dans ce numéro.
- [3] Moulaert Thibauld, Reman Pierre, « Où en est l’éducation permanente ? », La Revue Nouvelle, n°11, 2007. En ligne : https://www.revuenouvelle.be/Ou-en-est-l-education-permanente. Consulté le 27/07/2021.
- [4] Marx Karl, Engels Friedrich, L’idéologie allemande. Première partie : Feuerbach, 1845, pp. 31-32, URL : http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_Marx/ideologie_allemande/Ideologie_allemande.pdf, consulté le 16 août 2021.
- [5] Ibid.
- [6] Ibid.
- [7] Gramsci Antonio, Cahiers de prison, Cahier 3, Paris, Éditions Gallimard, 1978, §38, p. 302.
- [8] Ibid
- [9] Gramsci Antonio, Guerre de mouvement et guerre de position. Textes choisis et présentés par Razmig Keucheyan, Paris, La Fabrique, 2012.
- [10] Gramsci Antonio, Cahiers de prison, Cahier 3, Paris, Éditions Gallimard,1978, §38, p. 303.
- [11] Marx Karl, Engels Friedrich, Thèses sur Feuerbarch,1845, URL : https://www.marxists.org/francais/marx/works/1845/00/kmfe18450001.htm, consulté le 16/08/2021.
- [12] Gramsci Antonio, Cahiers de prison, Cahier 3, Paris, Éditions Gallimard,1978, §38, p. 312.
- [13] Ibid.
- [14] Wendling Thierry, « Us et abus de la notion de fait social total. Turbulences critiques », Revue du Mauss, n°36, pp. 87-99, 2010.
- [15] Pétition disponible sur www.wearebelgiumtoo.be : l’objectif de la campagne est de récolter 150.000 signatures. En avril 2020 nous en avions déjà récolté 20.000.
- [16] Voir l’analyse de Jean Matthys dans ce numéro.